Un cours d’eau divisé

La rivière Petitcodiac, au Nouveau-Brunswick, a une deuxième chance, mais son avenir fait encore bien remous.
Pendant que les travailleurs du gouvernement se préparent à démolir un pont-chaussée qui bloque l’écoulement de la rivière mal en point depuis des décennies, la controverse entourant l’avenir de la Petitcodiac demeure trouble.
Construit par le gouvernement provincial en 1968, le pont-chaussée est décrit par les environnementalistes comme une mauvaise solution aux inondations. L’ouvrage a gravement endommagé la rivière Petitcodiac, stoppant son écoulement, créant des dépôts de sédiments excessifs et entravant la migration des poissons. Pour eux, l’enlèvement du barrage constitue une victoire pour laquelle ils se sont battus longtemps.
Mais les résidents qui vivent en bordure du lac artificiel formé en amont du pont-chaussée sont aux abois. Eux aussi font des pressions depuis des années, mais pour protéger leur « lac Petitcodiac ». Les propriétaires riverains craignent que l’élimination du barrage n’entraîne une baisse de la valeur de leur propriété, en détruisant le lac, un joyau récréatif.
D’autres craintes surgissent relativement à la libération de cette rivière, notamment une hausse possible de la contamination issue d’un site d’enfouissement et d’une usine de traitement des eaux usées en aval du pont-chaussée, et la menace pour une attraction touristique locale.
Mark Reid explore le passé, le présent et l’avenir complexes de la rivière Petitcodiac dans un article intitulé A River Divided (un cours d’eau divisé), publié dans le numéro d’avril-mai de Canada’s History.
Peinture de David Thompson

Par Neil Babaluk
Don McMaster peint ce qu’il voit quand il regarde par la fenêtre de sa maison dans le sud du Manitoba. Pendant des années, il a reproduit les verts luxuriants, les jaunes vibrants et les bruns profonds qui composent le paysage des Prairies. Et plus récemment, il a inclus un personnage historique connu dans ce paysage.
McMaster, qui vit dans la vallée de l’Assiniboine, juste au sud du Portage la Prairie, a décidé en 2006 de s’éloigner de ses paysages habituels en créant une série de peintures qui relateraient les voyages de l’explorateur David Thompson dans le nord-est de l’Ontario et les Prairies.
Thompson a cartographié plus de 3,9 millions de kilomètres carrés de l’ouest de l’Amérique du Nord pour la Compagnie du Nord-Ouest, à partir de 1797. Il a traversé les prairies canadiennes puis les montagnes Rocheuses à plusieurs reprises et a été le premier Européen à naviguer sur la totalité du fleuve Columbia dans les états du Nord-Ouest américain bordés par le Pacifique. Thompson est généralement reconnu comme étant l’un des plus grands géographes terrestres à avoir jamais vécu.
On a demandé à McMaster de créer une peinture pour coïncider avec le centenaire de David Thompson, qui a commencé en 2007. Après avoir fait des recherches exhaustives sur les voyages du cartographe partout dans l’Ouest canadien, McMaster a décidé que son œuvre méritait plus qu’une simple peinture. C’est ainsi que le Projet David Thompson a vu le jour.
« J’ai réalisé que non seulement ses réalisations étaient peu connues, mais aussi qu’il n’y avait pratiquement aucune œuvre d’art ni d’illustration sur le sujet », a déclaré McMaster en entrevue.
McMaster a parcouru le Manitoba, la Saskatchewan, la région du lac des Bois de l’Ontario, les Dakotas et le Montana pour faire des recherches pour ses peintures. Les carnets d’exploration de Thompson ont été la meilleure source de renseignements. C’est pourquoi McMaster a fondé sa série de peintures sur des événements qui y sont relatés.
« J’ai décidé de choisir quelques événements spéciaux, qui ont eu lieu dans ce qui est décrit dans les carnets de Thompson comme étant actuellement le nord-ouest de l’Ontario et les Prairies, soit le Manitoba et la Saskatchewan », explique McMaster.
La transition à partir de la représentation de paysages a été facile pour McMaster, puisqu’il s’agit de la composante dominante de toutes les peintures sur Thompson.
« Je peignais d’abord les paysages, raconte McMaster, puis je plaçais les personnages dans les différents lieux, en tenant compte des conditions, de la saison et de l’heure décrites par Thompson. »
Après que les peintures eurent initialement été présentées lors du symposium du commerce des fourrures de 2007 à Rocky Mountain House, en Alberta, McMaster les a affichées dans des galeries et des musées partout au Manitoba. Elles ont récemment été achetées par Ron Peniuk, un collectionneur qui souhaite les montrer au public.
Elles font partie de l’exposition Diaries of a Map-Maker [Carnets d’un cartographe] qui sera présentée en avril et en mai 2010 au Sam Waller Museum à The Pas, au Manitoba.
A Perfect Storm [Une tempête parfaite]

Thompson voyageait dans le Dakota du Nord, près de Turtle Hill (maintenant appelé Killdeer Mountains), quand une tempête s’est le levée le 10 décembre 1797.
The Rescue of Frances Houle [Le sauvetage de Frances Houle]

Dans cette peinture, les hommes de Thompson traînent jusqu’à un campement un homme disparu dans la tempête du 10 décembre.
A Tolerable Good Bull [Une assez bonne prise]

Ayant épuisé leurs vivres, Thompson, ses hommes et ses chiens souffrent de la faim et d’épuisement lorsqu’ils parviennent à abattre un buffle le 12 décembre 1797.
Close Call at Dog Tent Hill [Incident évité de justesse à Dog Tent Hill]

À Dog Tent Hill (maintenant appelé Dog Den Butte, dans le Dakota du Nord), le groupe de Thompson se tient à l’écart d’un groupe de Sioux hostiles le 24 décembre 1797.
The Great Village [Le grand village]

Thompson accueille le chef d’un village mandan le 30 décembre 1797.
This Day I Married Charlotte Small [Aujourd’hui, j’ai épousé Charlotte Small]

Le 10 juin 1799, Thompson épouse Charlotte Small, d’ascendance crie et écossaise. Elle a été sa femme dévouée pendant 59 ans, l’accompagnant dans bon nombre de ses voyages et lui donnant 13 enfants.
The Toll Takers [Les percepteurs]
.aspx)
Une brigade à canot traversant le lac des Bois est interceptée par des autochtones locaux qui leur demandent un droit de passage sur leur territoire.
Running the Dalles [Passage obligé]

Des rapides turbulents rendent le canotage dangereux pour les commerçants de fourrures qui doivent emprunter une section étroite de la rivière Winnipeg.
Monument Bay [Monument Bay]

Le 31 juillet 1824, Thompson et son groupe posent une balise de pierre pour indiquer l’extrémité nord-ouest du lac des Bois.
Une amitié naufragée
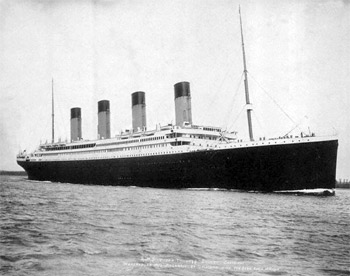
RMS Titanic
par Beverley Tallon
Le RMS Titanic était un navire de grand luxe, surpassant tous les autres de son époque. On y trouvait une piscine, un gymnase, trois ascenseurs électriques en première classe et un en seconde. Les chambres ordinaires de première classe étaient décorées de panneaux faits de bois rares et coûteux, et même les chambres de troisième classe étaient agrémentées de panneaux de pin et de meubles de teck. Mais aussi, les créateurs de cet opulent palace se targuaient d’avoir construit un navire insubmersible.
Dès septembre 1910, la White Star Line publia une brochure sur le Titanic et sa « grande soeur », l’Olympic, où l’on pouvait lire la phrase suivante « dans la mesure où cela est techniquement possible, ces deux navires ont été conçus pour ne jamais couler ». Les articles dans les journaux, les agents de voyage et même Edward Smith, le capitaine du Titanic, contribuèrent à perpétuer ce mythe. Le grand navire quitta le port de Southampton, en Angleterre, le 10 avril 1912, avec 2 223 passagers à son bord et seulement vingt canots de sauvetage.
Trois hommes d’affaires canadiens participèrent à ce premier voyage du Titanic, soit John Hugo Ross, Thomson Beattie et Thomas Francis McCaffry. (Image below: John Ross Hugo, Unknown, McCaffry, Mark Fortune, et Thomson Beattie se nourrissent les pigeons de la place Saint-Marc, Venise, Mars 1912 - Encyclopédie Titanica).
 John Hugo Ross est né dans le comté Glengarry, en Ontario, en 1875. Il déménagea avec sa famille à Winnipeg à l’âge de deux ans. Son père, Arthur Wellington Ross, un agent immobilier, réussit à obtenir un poste pour son fils adolescent au service du lieutenant gouverneur du Manitoba. Après un an, John Hugo Ross partit pour Toronto et lança son entreprise de courtage en exploitation minière. Il fait faillite en 1902 et prit le chemin du Klondike avec seulement 25 cents en poche. À la mort de son père, il hérita de la fortune familiale et retourna à Winnipeg pour prendre soin de sa mère. Il y fonda la Hugo Ross Realty Company Ltd. et la Winnipeg Real Estate Board. Il devint membre du Manitoba Club et y fit la connaissance du courtier Thomson Beattie, qui avait un bureau en face du sien, dans le Merchants Bank Building.
John Hugo Ross est né dans le comté Glengarry, en Ontario, en 1875. Il déménagea avec sa famille à Winnipeg à l’âge de deux ans. Son père, Arthur Wellington Ross, un agent immobilier, réussit à obtenir un poste pour son fils adolescent au service du lieutenant gouverneur du Manitoba. Après un an, John Hugo Ross partit pour Toronto et lança son entreprise de courtage en exploitation minière. Il fait faillite en 1902 et prit le chemin du Klondike avec seulement 25 cents en poche. À la mort de son père, il hérita de la fortune familiale et retourna à Winnipeg pour prendre soin de sa mère. Il y fonda la Hugo Ross Realty Company Ltd. et la Winnipeg Real Estate Board. Il devint membre du Manitoba Club et y fit la connaissance du courtier Thomson Beattie, qui avait un bureau en face du sien, dans le Merchants Bank Building.
Né la même année que Ross, Thomson Beattie grandit dans la petite ville de Fergus, en Ontario; il était le plus jeune de onze enfants. À la mort de son père, en 1897, Thomson et son frère Charles partirent pour Winnipeg, avec leur héritage. Thomson Beattie lança avec succès une agence immobilière, la Haslam Land Company, avec son partenaire, Richard Waugh. Lorsque Waugh fut élu maire de Winnipeg en 1911, Thomson Beattie resta seul pour diriger l’entreprise. Thomas McCaffry et lui devinrent de grands amis et le Winnipeg Free Press les décrivait alors comme « les deux (presque) inséparables ».
Thomas Francis McCaffry avait 13 ans de plus de Beattie. Né en 1866 à Trois-Rivières, au Québec, il fut élevé à Montréal avec ses deux soeurs. Il entama sa carrière de banquier à la Three River’s Union Bank of Canada, devint commis à Montréal et fut ensuite promu directeur de la banque de Neepawa, au Manitoba. En 1897, il déménagea à Winnipeg pour diriger une succursale de la Union Bank. C’est là qu’il fit la connaissance de Thomson Beattie et les deux amis devinrent de grands compagnons de voyage.
Même si McCaffry déménagea à Vancouver, les trois amis ne perdirent pas le contact et organisèrent de grandes vacances au début de 1912, prévoyant se rendre au Moyen Orient et en Europe. Cependant, en mars, Beattie et McCaffry durent s’avouer épuisés par ce voyage et Ross, de son côté, avait contracté la dysenterie.
Ils décidèrent de couper court au voyage et Beattie écrivit à sa  mère : « Nous changeons de navire et revenons à la maison à bord d’un nouveau bateau que l’on dit insubmersible. » Le trio réserva une chambre en première classe à bord du Titanic, et s’embarqua à Cherbourg, en France, le 10 avril. Beattie et McCaffry partagèrent une chambre, et payèrent plus de 75 £ pour ces luxueux quartiers.
mère : « Nous changeons de navire et revenons à la maison à bord d’un nouveau bateau que l’on dit insubmersible. » Le trio réserva une chambre en première classe à bord du Titanic, et s’embarqua à Cherbourg, en France, le 10 avril. Beattie et McCaffry partagèrent une chambre, et payèrent plus de 75 £ pour ces luxueux quartiers.
Cependant, une fin tragique les attendait, et à cela, leur fortune n’y pouvait rien. Même si Beattie réussit à prendre place à bord du dernier canot de sauvetage, son corps ne fut retrouvé qu’un mois plus tard, lorsque l’Oceanic retrouva la petite embarcation flottant à la dérive. Dans un article macabre paru dans le St. Paul Daily du 17 mai 1912 on pouvait lire ce qui suit : « Des marques de dents sur le liège et le canot laissent imaginer le pire. Trois corps ont été découverts. Deux de ceux ci étaient attachés aux bancs par des chaînes. Le corps d’un passager a été identifié grâce à ses vêtements. Il s’agit de M. Thomson Beattie. Les deux autres étaient des membres d’équipage. » Les restes de Beattie furent remis à la mer le jour de la fête de sa mère, presque au même endroit où elle-même avait vu le jour, sur un navire en route pour le Canada, 82 ans plus tôt.
Même si on a cru que McCaffry et Beattie se trouvaient sur le toit, McCaffry ne réussit pas à rejoindre le canot. Son corps fut retrouvé plus tard et ramené à Montréal, où il est enterré au cimetière Notre-Dame-des Neiges –– une grande pierre tombale de granite, payée par la banque, marque l’endroit.
Leur ami John Hugo Ross refusait de prendre le désastre au sérieux et affirma « C’est tout? Il faudra plus qu’un iceberg pour me sortir de ce navire. » Son corps ne fut jamais retrouvé, mais on croit qu’il serait mort noyé dans son lit. Hugo Street, à Winnipeg, a été ainsi nommée en son honneur.
Le projet mémoire : Carol Duffus

Carol Duffus, 1944. Image below: Duffus (right) working out naval tactics.
Écoutez Carol Duffus raconter son expérience dans la Marine royale du Canada pendant la Seconde guerre mondiale. Vous pourrez entendre d’autres histoires en visitant le Projet mémoire.
Transcription audio
Je m’appelle Carol Duffus, née Hendrie. Je suis née à Toronto, le 25 septembre 1918. On m’a appelée au service à la fin mars 1943. Et j’y suis restée jusqu’à la fin septembre 1945. Puis j’ai servi comme WREN. On nous appelait les WRENS. Les femmes britanniques dans la Marine s’appelaient les WRENS, donc nous nous sommes baptisées les WRENs avec un C, WRCNS, Women’s Royal Canadian Naval Service. Et nous autres, nous étions une division de la Marine. En Grande-Bretagne ce n’était pas exactement le cas; elles formaient une unité à part.
Après un bout de temps, il y avait un poste à combler dans le bureau de formation : une agente d’entraînement quittait le bureau, donc j’ai pris le poste d’agente d’entraînement d’officiers. Je me suis chargée d’encadrer l’entraînement de tous les équipages de navire qui arrivaient, des bâtiments d’escorte, quand un entraînement s’avérait nécessaire, et des travaux tactiques ou des exercices de poste ou de sémaphore ou d’artillerie. J’ai imposé l’entraînement au poste applicable à chaque candidat qui en avait besoin. C’était intéressant, un bon emploi.
Le tableau tactique servait à enseigner la tactique aux bâtiments d’escorte qui accompagnaient un convoi à travers l’Atlantique. Et six officières WREN se sont chargées d’un tableau tactique; bon ce n’était pas un véritable tableau, c’était plutôt comme un plancher de gymnase. Mais c’était entouré d’un mur qui montait jusqu’à la taille. Et les WRENS, qui s’en chargeaient; il y en avait six pour faire l’escorte de convoi.
Donc nous avions les représentants de six bâtiments d’escorte qui se trouvaient de l’autre côté du mur; ils ne pouvaient pas nous voir mais nous pouvions les voir, eux. Donc chacune de nous était responsable de son propre vaisseau. Et chaque vaisseau dans ce groupe d’escorte envoyait son capitaine et son navigateur, ainsi que le sémaphoriste. Ils se mettaient de l’autre côté du mur; ils ne voyaient pas ce que nous faisions sur le tableau. Et chacune d’entre nous avait son propre vaisseau, avec des instructions pour donner à ce vaisseau, et des échéances différentes. C’était un jeu tactique qu’on donnait aux bâtiments d’escorte; en ce cas-ci, il s’agissait d’un jeu tactique d’assurer l’escorte d’un convoi. Un vaisseau se mettait en tête de convoi et un en arrière; les autres se disposaient autour, aux quarts. Ils étaient là pour protéger le convoi contre les attaques de sous-marin.
Ainsi le jeu se déroulait-il; c’était une espèce de théâtre où des situations se présentaient et les WRENS se mettaient au tableau pour dresser la tactique du tout. Tout était démarqué en sections et nous utilisions des craies pour noter tout détail stratégique que les représentants nous donnaient. Nous avions chacune son propre vaisseau; on nous donnaient des instructions et nous dessinions le tout sur le tableau, qui était en fin de compte le plancher de gymnase. Nous nous mettions à genoux pour cela.
Et le jeu continuait; les situations imaginaires se présentaient; peut-être qu’on annonçait qu’un sous-marin était dans les alentours, ou que quelqu’un avait vu exploser un navire et on savait qu’un sous-marin en était responsable. Ce n’étaient que des scénarios hypothétiques, mais c’était ça le jeu.
Donc nous voilà, et à toutes les deux minutes près nous recevions des notes de notre vaisseau; et chacune allait au tableau tactique pour mettre à jour les détails de son vaisseau. Et cela continuait pendant une heure ou deux, selon les scénarios qui se déroulaient, et le commandant d’entraînement était là pour donner des instructions.
Donc, à la fin du jeu, toutes les personnes qui avaient participé à la tactique, les capitaines aussi, venaient regarder le tableau pour voir le résultat final. Et le commandant d’entraînement faisait le point sur la situation en général, pour résumer ce qu’on avait accompli durant l’exercice, entre les instructions et la représentation graphique de celles-ci; comme les représentants avaient dit je vais faire ceci ou cela pour tel ou tel bout de temps, et nous modifiions le schéma en conséquence.
Donc tout était représenté en craie et quand le jeu avait pris fin, tout le monde se rapprochait du tableau pour écouter les critiques du commandant d’entraînement. Il disait à tout et chacun, bon en ce cas-ci, peut-être c’aurait été mieux de faire ceci ou de faire cela, et ainsi de suite. Donc c’était vraiment excellent comme expérience pédagogique et exercice tactique, et nous en avons beaucoup appris, je pense.
On entend souvent parler de cette notion de mépris envers les femmes tout simplement parce que ce sont des femmes qui sont dans un métier réservé aux hommes. Mais je ne me suis jamais sentie comme ça, jamais. Au contraire, je ne ressentais que du respect et de reconnaissance pour ce que je faisais. Et c’est probablement la raison pour laquelle on m’a promue au poste de responsable d’entraînement des officiers, parce qu’on me respectait et j’avais une bonne maîtrise de mon travail, et je savais pourquoi j’étais là. C’était une belle expérience. Aucun problème en tant que femme dans ce rôle.
Tant de gens n’ont aucune idée de ce que les femmes ont fait dans les différents services durant la guerre. Et je crois qu’il faut parler un peu plus de cela, parce que, sans les contributions des femmes, bien des choses ne se seraient pas réalisées. Bref, j’ai eu la possibilité de faire quelque chose d’utile. C’était bon, et je crois qu’il y a beaucoup d’autres femmes aussi qui ont fait des choses utiles et qui n’auront jamais la reconnaissance qu’elles méritent. J’aimerais que tout le monde se rende compte de comment ces femmes ont servi leur pays; elles ont été tellement importantes.
(fin d’enregistrement)
Le projet mémoire : Tom Reginald Rappel

Tom Rappel received a certificate and medal of Remembrance from the Netherlands. Below left: the HMCS Haida.
Écoutez Tom Rappel raconter son expérience dans la Marine royale du Canada pendant la Seconde guerre mondiale. Vous pourrez entendre d’autres histoires en visitant Le Projet Mémoire.
Transcription audio
Je me suis enrôlé en 1942, aux baraques Donnacona sur la rue Mountain [à Montréal]. J’avais 17 ans mais je leur ai dit que j’en avais 18. Tous mes amis, certains plus vieux et certains plus jeunes que moi, s’enrôlaient alors je me suis dit que moi aussi je tenterais l’expérience.
Et, puis, j’ai été heureux dans ma carrière militaire. Je suis déjà allé en mer mais j’ai été malade comme un chien. (Il rit.) Et, c’était seulement sur le fleuve St-Laurent. Mais ensuite, j’ai été affecté à bord du navire Niagara, le HMCS Niagara. C’était l’un des premiers destroyers à quatre cheminées à être déployé. Je suis resté à bord pour un bout de temps et puis j’ai été affecté outre-mer où je me suis joint à un autre équipage. Il y avait quatre destroyers de classe Tribal : le Haida, le Huron, l’Iroquois et l’Athabaskan.
Nous étions en Russie (l’URSS à l’époque), au temps de Noël, là-bas, à 15 miles au sud de Mourmansk. Une vieille tradition de la Marine veut que le plus jeune à bord soit nommé capitaine d’un jour. On parle des matelots, là. Il y avait aussi le personnel de la salle des machines…mon chauffeur principal s’appelait Bob Scott. Et, il a annoncé, ‘’Ce jeune homme sera officier ingénieur pour la journée !’’ Et, c’est ce qu’ils ont fait, par respect de la tradition mais, à leur façon.
En tous cas, lorsque je suis allé à bord duHaida, nous prononcions ‘’ Héda’’ mais depuis que je suis à Ottawa, c’est devenu le ‘’ Haïda’’. Mais, néanmoins, nous accompagnions l’Athabaskan la nuit que le navire a été coulé. Nous étions au combat. Mon capitaine s’appelait Harry DeWolf. Il était l’un des capitaines les mieux connus de la Marine. Alors, c’est à peu près tout ce que je peux vous raconter là-dessus.
J’ai quitté le Haida et je suis retourné aux chemins de fer où j’ai complété mon apprentissage. Ensuite j’ai fait un autre tour de service avec la Marine. Tout est là sur les certificats et les documents qui sont accrochés à mes murs. Et, lorsque je suis venu ici, à l’hôpital, une dame est venue me dire, ‘’Félicitations !’’ J’ai répondu, ‘’Mais, pourquoi ?’’ ‘’Parce que vous venez d’être mis en nomination pour la vice-présidence du conseil des anciens combattants !’’ Et, effectivement, c’est le poste que j’occupe aujourd’hui.
Le projet mémoire : Cyril H. Roach

Cyril Roach, Gibraltar, 1946. Below left: LST ship on Sword Beach, Normandy, D-Day 1944. Below right: Roach in marching band, second row, middle.
Écoutez Cyril Roach raconter son expérience dans la Marine royale du Canada pendant la Seconde guerre mondiale. Vous pourrez entendre d’autres histoires en visitant le Projet mémoire.
Transcription audio
Je m’appelle Cyril Roach et je suis né le 21 octobre 1924. J’ai suivi l’entraînement militaire suis devenu officier mécanicien à bord d’un LST (bâtiment de débarquement de chars), qui était un bâtiment à deux ponts. Qui était utilisé à l’époque du débarquement en France. Le 5 juin, on devait partir de Portsmouth, avec des troupes. On a débarqué sur les trois plages, qui à l’époque étaient considérées comme faisant partie de la zone britannique.
Le jour J nous sommes arrivés en France, après avoir quitté l’île de Wight pendant la nuit du 5 juin aux environs de 11 heures du soir. Nous sommes arrivés au large du Havre, qui était dans le secteur des environs de Ouistreham. C’était bien-sûr le lieu de débarquement des troupes qui avaient pour objectif la ville de Caen. Pour le débarquement, le navire avait jeté l’ancre à 800 mètres du rivage et ensuite on a foncé vers les plages pour débarquer les troupes ainsi que le matériel léger, dont une parie devait servir à la 6ème division aéroportée ainsi qu’à d’autres contingents de l’armée.
Pendant ce temps on se faisait pilonner depuis la haute corniche au dessus du Havre et il y avait plein de bateaux dans la mer, à perte de vue. Et aussi des milliers d’avions au dessus de nos têtes : des bombardiers, des avions de combat ; et il y avait beaucoup de ces planeurs qui étaient lancés par remorquage, pour aider au débarquement des troupes au sol.
Cependant, à ce moment là, peu après notre arrivée, on a commencé à décharger et trois Messerschmidts se sont mis à mitrailler les plages. Malheureusement nous avons perdu beaucoup d’hommes. Moi aussi j’ai été blessé à ce moment là. Néanmoins j’ai survécu, je suis heureux de le préciser.
J’étais l’officier mécanicien à bord de ce bateau. J’étais un officier supérieur, commandant en second et bien-sûr, nous avions des gens pour alimenter les chaudières dans la salle des machines. Tous les gens de mon équipe était des canadiens originaires de l’ouest du Canada. Et ils ont tous fait un excellent travail, mais évidemment ce qui était le plus important à ce moment là c’était les moteurs diesels de 1500 CV qui faisaient marcher le bateau, avec un moteur à deux hélices. Et moi je devais m’assurer que tout soit opérationnel à 100%, nous les hommes, l’équipement, c’était ça ma responsabilité.
Je vais être très honnête avec vous, au moment où nous avons débarqué, j’ai pensé : qui est la mère dont le fils va mourir aujourd’hui ? Et je pensais pas seulement à nos propres gars mais à nos ennemis aussi. J’avais appris que les jeunesses hitlériennes faisaient leurs classes dans cette zone malheureusement et ces garçons avaient 14,15, 16 ans, juste des gamins. Ils n’ont jamais revu leur patrie. Malgré tout, je peux seulement en parler comme je l’ai vu. Et le temps était, l’action, un, je ne peux pas dire que j’avais peur. Je faisais mon boulot tout simplement. Et mes gars faisaient leur boulot. Et comme tout le reste, au moment de l’action on doit se concentrer sur ce qu’on est en train de faire et aussi s’assurer qu’on va survivre pour s’occuper des gars qu’on est allé chercher. Mais ce n’est pas un jour qu’on peut oublier. Je vous assure.
(fin de la cassette)
Appréciez vous aussi le fond d’écran à l’image de Jolly Roger !


Arrrgh!!! Il n’est jamais trrrop tôt pour célébrrrer la journée parrrle comme un pirate! Téléchargez gratuitement votre fond d’écran à l’image de Jolly Roger dessiné par les mains du maître James Gillespie, notre directeur artistique Web.
Le courriel d’autrefois
À l’ère de la messagerie instantanée, une carte postale écrite à la main et livrée à votre porte est un rappel bien pittoresque d’une époque maintenant révolue. Il n’y a pas si longtemps, l’envoi de cartes postales était un rituel auquel presque tous se prêtaient volontiers en vacances, et à une certaine époque, elle régnait comme mode de communication privilégié. En fait, la carte postale a été l’objet d’une longue histoire d’amour avec le Canada.
-
Visitez notre galerie de cartes postales. Merci à madame Evelyn Theriault pour ses trésors.
-
Dites-nous si vous envoyez et/ou recevez toujours des cartes postales et pourquoi.
-
Faites-nous parvenir vos cartes postales préférées et nous les ajouterons à la galerie.
Required form 'FRFavouritePostcards' does not exist.
Entretien avec un pirate

Luc Nicole-Labrie, guide-interprète à la Commission des champs de bataille nationaux
En complément à l’article portant sur les pirates paru dans l’édition d’août et septembre du magazine Canada’s History, nous avons cru bon fouiller davantage le sujet en rencontrant un homme qui se prétend être un vrai pirate. Sur le site du bassin Brown à Québec, nous avons donc interviewé le pirate Jack Rackham alias Luc Nicole-Labrie, historien et guide-interprète à la Commission des champs de bataille nationaux.
Vous pouvez écouter l’intégralité de l’entrevue accordée par Luc Nicole-Labrie à Histoire Canada (durée 7 minutes, 46 secondes).
Jusqu’au 11 octobre 2010, vous pouvez vous aussi rencontrer le pirate Rackham et ses acolytes sur le site du Bassin Brown, au 615 boulevard Champlain Est à Québec.
Pour en apprendre davantage et pour plus d’information, vous pouvez également parcourir le site Web thématique de la Commission des champs de bataille nationaux.
Vous pouvez aussi visiter l’exposition du Musée virtuel du Canada créée grâce à un partenariat entre le Musée naval de Québec et le Musée maritime du Québec.
Pleins feux sur l’histoire : les légendes francophones du country au Canada
Qu'ont en commun Paul Brunelle, Lévis Bouliane, Willie Lamothe, Patrick Normand et Isabelle Boulay? Ils ont contribué chacun à leur manière à écrire l'histoire de la musique country francophone au Canada.
Benoît L’Herbier, spécialiste de la chanson québécoise, écrivait en 1974 : « le succès du western dans l’histoire musicale du Québec s'explique aisément. Comme les Américains moyens, les Québécois, en majorité cultivateurs, habitent la campagne, près de la terre, éprouvent les mêmes sentiments devant la vie, l'existence et le monde... » .
Les chanteuses et chanteurs que nous vous présentons ci-dessous, ne représentent qu’un petit échantillon puiser dans le panthéon des légendes country francophones. L’histoire du country étant riche au Canada, nous vous invitons aussi à visiter la version anglophone de notre site Web afin d’entendre et découvrir d’autres artistes ayant fait rayonner ce genre musical ailleurs au pays et même hors de nos frontières.
Paul Brunel — Les nouveaux mariés
Paul Brunelle est considéré comme celui ayant établi les bases du country au Québec. Il fut une influence marquante pour toute une génération de chanteurs et musiciens country. Celui qui amorça sa carrière pendant la Seconde Guerre mondiale connu beaucoup de succès avec ses chansons Mon enfant, je te pardonne, Destin cruel et Par une nuit d’étoiles. Brunel contribua à diffuser la musique country au Québec en animant des émissions dédiées à ce genre dans les radios montréalaise CKAC et CKVL.
Lévis Bouliane — Ces belles années auprès de toi
Lévis Bouliane a parcouru pendant 50 ans le Québec, les Maritimes et un bon nombre d’états américains afin de défendre un répertoire comprenant plusieurs centaines de chansons qui furent gravées sur une vingtaine d’albums. En plus d’être chanteur, Lévis Bouliane était aussi un excellent violoniste. Pendant 15 ans, entre 1949 et 1965, il fut l’un des membres du groupe Fives Blue Stars. De plus, il se passionna pour un genre musical appelé Bluegrass qui mettait à l’honneur le banjo. On se souvient de Lévis Bouliane entre autres pour son grand succès Vole colombe, encore interprété par ses contemporains.
Willie Lamothe — Je chante à cheval
Willie Lamothe est considéré comme le roi du Western au Québec. Il se produisit à Nashville et fit même la première partie de Gene Autry au Forum de Montréal. Ses chansons Je suis un cowboy canadien et Je chante à cheval demeurent des classiques de la chanson country francophone. On se souvient de lui pour sa célèbre émission de télévision Le Ranch à Willie et aussi pour ses rôles joués au cinéma dans les films La vraie nature de Bernadette et La mort d’un bûcheron de Gilles Carle. On ne peut penser à Willie Lamothe sans penser aussi à Bobby Hachey, son complice professionnel de toujours.
Marcel et Renée Martel — Nous on aime la musique country
Marcel Martel est considéré par plusieurs comme faisant partie des pionniers de la musique country au Québec. Toute sa vie gravitait autour de l’univers du country. Pendant les 40 années que dura sa carrière, il lança plus de 50 albums en plus d’écrire près de 500 chansons originales. Dans les années 1970, il reçu un disque honorifique pour avoir été l'artiste ayant vendu le plus de disques country et western au Canada. Sa fille Renée, quant à elle, est ni plus ni moins que la reine du country au Québec. Celle qui compte près de 60 ans de carrière a commencé à exercer le métier de chanteuse alors qu’elle n’avait que 7 ans. Après avoir vendu plus de 3 millions d’album et animé diverses émissions radio et télé, la reine du country continue de fouler les planches au grand plaisir de ses nombreux fans.
La famille Daraîche — Que la lune est belle ce soir
Les membres de ce groupe appartiennent tous à la même famille. Paul et Julie Daraîche sont frère et sœur. Ils ont amorcé leur carrière musicale il y a 30 ans. Katia, la fille de Paul, et Dani, la fille de Julie, se sont joints au groupe au fil du temps. Ensemble, il forme un des groupes les plus populaires dédiés à la musique country. Les Daraîche sont de véritables porte-étendards de ce genre musical. Ils préservent un country authentique en dehors des modes commerciales.
Patrick Normand — La guitare de Jérémie
En 1984, Patrick Normand lançait son grand succès Quand on est en amour. Tout le Québec fredonnait cette chanson vendue à plus de 300 000 exemplaires. La popularité du chanteur atteignit alors des sommets, mais son parcours fut dans les années qui suivirent plus difficile. Le country étant moins au goût du jour, et critiqué pour son look, Normand eut a lutté fort pour préserver son image et diffuser sa musique. Heureusement, il pouvait compter sur un noyau de fans fidèles. Patrick Normand gravit de nouveau les échelons un à un sans jamais renier son âme country. En 2007, on lui attribua le trophée hommage à l’ADISQ pour l’ensemble de sa carrière.
Isabelle Boulay — À ma mère (Perce les nuages)
Cette grande interprète originaire de Sainte-Félicité en Gaspésie au Québec a chanté avec les plus grands noms de la chanson française — Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Francis Cabrel, Zacharie Richard, Claude Léveillé — et cela, sur les plus grandes scènes de la Francophonie. La grande chanson française occupe certes une place importante dans le cœur et la carrière d’Isabelle Boulay, mais c’est en chantant des chansons country que l’artiste a fait ses premiers pas dans les bars et restaurants de sa région natale. Fortement imprégnée par ce genre musical, elle a régulièrement ajouté des classiques country à ses tours de chant tant au Québec qu’en Europe. En 2007, alors que la musique country était boudée par les radios commerciales, Isabelle Boulay a fait le pari produire l’album De retour aux sources, exclusivement dédié à ce genre musical. L’artiste a gagné son pari et ses chansons Adrienne et Entre Matane et Baton rouge sont aujourd’hui fredonnées par un large public. Ses rencontres musicales récentes avec Anne Murray et Kenny Rodger laissent croire qu’un nouvel album country, cette fois produit dans la langue de Shakespeare, pourrait voir le jour.
Escapade : Terre de La Vérendrye

Sculpture autochtone le long du Ironwood Trail, Pinawa, Manitoba. Photo: Nancy Bremner.
« Dès qu’on arrive, mon niveau de stress disparaît, littéralement », nous explique Angela, propriétaire d’un chalet, alors qu’on entend les rires des enfants fuser à l’arrière plan. La famille s’est installée dans sa résidence secondaire près de Lac du Bonnet, dans l’est du Manitoba, et les enfants « lâchent leur fou », comme tous les enfants.
Le Lac du Bonnet est un lieu de villégiature depuis le début du siècle dernier. Les berges de la rivière Winnipeg sont parsemées de chalets de toutes sortes, de la modeste cabane à la luxueuse demeure de plusieurs millions de dollars.
C’est cette même rivière que Pierre Gaultier de Varennes de La Vérendrye a parcourue au printemps de 1733. Le voyageur français a baptisé une grande section de la rivière Lac du Bonnet en raison de sa forme particulière. Les preuves d’une présence humaine dans le secteur remontent à au moins huit mille ans. Les Cris firent la rencontre de La Vérendrye à son arrivée, mais en 1800, ils avaient quitté les lieux, remplacés par les Anishinabe (Ojibway) en provenance du lac Supérieur.
Après une après midi passée à bord d’une embarcation à moteur, on ne peut que s’émerveiller devant la force et l’adresse qu’ont dû déployer les voyageurs qui ont parcouru cette même rivière. Jusqu’en 1821, année où la Compagnie du Nord-Ouest, établie à Montréal, fusionna avec la Compagnie de la baie d’Hudson, cette route empruntée pour le commerce de la fourrure fut très fréquentée. En chemin, on nous raconte comment les troupes du colonel Wolseley s’embarquèrent à bord de canots pour étouffer la rébellion menée par Louis Riel, mais également la fin de la grande époque du canot, vers 1870.
Le lendemain matin, nous visitons le village et ses commerces, notamment une boulangerie qui fleure le bon pain frais. Au marché, en ce samedi matin, on nous propose une belle variété de légumes frais, de miel et d’oeuvres d’artisanat local.
« [La Vérendrye] a baptisé une grande section de la rivière Lac du Bonnet en raison de sa forme particulière. »
Ensuite, nous quittons le Lac du Bonnet et nous dirigeons vers la vieille ville de Pinawa. Sur l’autoroute 211E, nous voyons une affiche d’Énergie atomique du Canada limitée. Nous traversons une dense forêt d’épinettes et prenons au nord, sur la route provinciale 520, un chemin de gravier menant à la ville originale de Pinawa et à l’ancien barrage de Pinawa.
C’est ici, en 1906, que la première centrale hydroélectrique du Manitoba fut construite par la Winnipeg Electric Company afin de répondre à la demande croissante de la ville. On y construisit une grande structure de béton afin d’exploiter le courant de la rivière Winnipeg. Même si la production a cessé en 1951, et que le village a depuis été abandonné, les ruines du barrage sont toujours visibles et font maintenant partie du parc provincial du barrage Pinawa. Les voyageurs s’y arrêtent pour un pique-nique, une randonnée et un bain de soleil sur les rochers. Dans la vieille ville, les anciennes maisons, le jardin communautaire, l’hôtel de ville et l’école sont identifiés par des panneaux.
Ensuite, nous reprenons la route en direction de la nouvelle ville de Pinawa. EACL a fondé cette ville en 1963.
Plusieurs chevreuils broutent allègrement sur le boulevard. Ils semblent peu perturbés par l’arrivée des visiteurs. Au bout de cette route se trouve une imposante structure de métal, le Pinawa Heritage Sundial (le cadran solaire patrimonial de Pinawa). Construite dans le cadre d’un projet du Millénaire, cette oeuvre massive intègre douze thèmes liés au patrimoine, notamment les Premières nations, La Vérendrye et l’hydroélectricité.
La marina de la ville nous donne l’impression d’être au bord de la mer et les visiteurs peuvent emprunter le très fréquenté Ironwood Trail (ainsi nommé en raison de la présence rare d’ostryers de Virginie) qui longe la rivière Winnipeg. Du sentier, on peut voir deux îles : French et Furey. Elles portent le nom de deux soldats des grenadiers de Winnipeg, morts au combat pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il y a tant à voir ici et dans la région environnante de Whiteshell, notamment des pétroformes, des monuments, des musées et un sanctuaire d’oies! Mais, tout cela devra faire l’objet d’une autre escapade.
Beverley Tallon est adjointe à la rédaction au magazine Canada’s History. Elle a également contribué à l’ouvrage 100 Photos that Changed Canada, un succès de librairie partout au pays.
L’homme qui désamorçait les bombes du FLQ

Robert Côté, acteur de premier plan, lors des événements d’Octobre 1970 et particulièrement lors de la libération de James Richard Cross.
Écoutez l’intégralité de l’entrevue accordée par Robert Côté à Histoire Canada (durée 23 minutes, 40 secondes). Voyez aussi de quelle manière les événements d'Octobre 1970 furent présentés, interprétés ou commentés dans le cinéma québécois.
Les événements d’Octobre 1970 ont été analysés par bon nombre de journalistes et historiens. Ici, nous vous proposons de revivre ces événements à travers le regard de Robert Côté, ancien commandant de la Police de Montréal responsable de l’équipe chargée de désamorcer les explosifs et les bombes.
Robert Côté s’est joint au Service de police de Montréal en 1959 après avoir servi pendant 6 ans au sein du Royal 22e Régiment. Ses expériences sur le terrain dans diverses régions du Canada, dans l’Arctique et en Allemagne lui ont permis de développer des compétences recherchées à une époque où le FLQ faisait exploser des bombes un peu partout à Montréal.
Retraité du Service de police de Montréal en 1990 avec le grade d’Inspecteur-chef, Robert Côté devint conseiller municipal et maire suppléant de Montréal. Afin de souligner son parcours peu banal, on lui décerna la Médaille de bravoure de la Ville de Montréal et on le décora de l’Ordre du Canada à titre d’officier.
En octobre 2003, il publia un livre intitulé Ma guerre contre le FLQ aux éditions Trait d’Union. Il reçut pour ce livre le Prix Percy-Foy de la Société historique de Montréal.
Les événements d’octobre 1970 au Québec
Il y a 40 ans cette année, la Crise d’octobre débutait au Québec. Les événements de l’automne 1970 marquèrent une génération de citoyens québécois et canadiens. Encore aujourd’hui, certains aspects de cette crise demeurent inexpliqués et énigmatiques. Vous trouverez ici une chronologie des principaux événements ayant marqués l’automne 1970. Vous pourrez mieux comprendre toute l’agitation associée à cette période grâce à des liens menant à des documents d’archives de la radio et de la télévision de Radio-Canada.

5 octobre : Enlèvement du diplomate britannique James Richard Cross par la cellule Libération du FLQ à sa résidence. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]
8 octobre : Lecture du Manifeste du FLQ par le journaliste Gaétan Montreuil à la télévision de Radio-Canada. [ Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]
10 octobre : Le gouvernement canadien accepte que les ravisseurs de Cross reçoivent un sauf conduit pour quitter le pays, mais refuse la libération des prisonniers politiques du FLQ et l’arrêt des activités policières. Pierre Laporte, ministre du Travail et de l’Immigration, est enlevé par la cellule Chénier devant sa maison à Saint-Lambert. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]
13 octobre : Le gouvernement canadien ordonne que des militaires soient déployés à Ottawa afin d’assurer la défense des édifices fédéraux. Pierre Elliott Trudeau déclare son célèbre« Just watch me » à un journaliste qui le questionne sur les solutions envisagées afin de rétablir l'ordre. [Regardez cette vidéo via YouTube]
15 octobre : Le Premier ministre québécois Robert Bourassa demande l'intervention des forces armées afin « d’assurer la sécurité de la population et des édifices publics. » 1000 soldats envahissent les rues de Montréal. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]
16 octobre : Pour une première fois en période de paix, le Premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau impose la loi sur les mesures de guerre. Les libertés civiles sont suspendues partout au pays et le FLQ est mis hors la loi. Près de 500 personnes seront arrêtées arbitrairement à partir de ce moment. [Regardez ces vidéos tirés des archives de Radio-Canada première vidéo et deuxième vidéo.]
17 octobre : Le corps du ministre Pierre Laporte est retrouvé dans le coffre d'une voiture à proximité de l'aéroport militaire de Saint-Hubert. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]
19 octobre : Des mandats d'arrêt sont lancés contre Jacques Rose, Bernard Lortie et Francis Simard, trois membres de la cellule Chénier. On les soupçonne d’être les responsables de l'enlèvement et du meurtre de Pierre Laporte.
3 décembre : James Richard Cross est libéré par ses ravisseurs après 59 jours de captivité. Jacques Lanctôt, son épouse Suzanne et leur fils Boris, Jacques Cossette-Trudel et sa femme Louise Lanctôt, Marc Carbonneau et Yves Langlois (alias Pierre Séguin) obtiendront un sauf-conduit les menant vers Cuba. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]
23 décembre : Pierre Elliott Trudeau confirme que les forces armées seront retirées du Québec à partir du 4 janvier 1971. La Loi sur les mesures de guerre restera quant à elle en vigueur jusqu'au 30 avril 1971.
28 décembre : Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simard, les ravisseurs de Pierre Laporte, sont arrêtés sur la rive sud de Montréal. [Regardez cette vidéo tirée des archives de Radio-Canada]
Octobre 1970 dans le cinéma québécois
La Crise d'octobre de 1970 a marqué une génération de Québécois et de Canadiens tant dans la vie que par sa représentation au grand écran. Histoire Canada vous propose ici une compilation des principaux films (fictions et documentaires) inspirés par les événements qui se sont déroulés au Québec à l'automne 1970. (Ne manquez pas l'entrevue accordée par Robert Côté, ancien commandant de la Police de Montréal et responsable de l'équipe chargée de désamorcer les explosifs et les bombes).
 Bingo
Bingo
113 minutes | 1974 | Fiction | Réalisation : Jean-Claude Lord
Bingo est le premier film inspiré par les événements d’Octobre 70. Le film, qui a connu un grand succès populaire lors de sa sortie, est considéré à la fois comme un film politique, mais aussi comme le premier thriller québécois. Dans Bingo, le personnage principal est un jeune homme idéaliste manipulé et transformé en terroriste par des influences extérieures.
Voir des extraits du film sur telequebec.tv
 Les Ordres
Les Ordres
107 minutes | 1974 | Fiction | Réalisation : Michel Brault Primé à Cannes (1975)
Deuxième œuvre de fiction de Michel Brault, Les Ordres est un film majeur dans l’histoire du cinéma québécois. Il fut directement inspiré par les événements d’Octobre 70. Le récit présenté par Brault se situe à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Le réalisateur fut le premier à présenter sur grand écran l'emprisonnement de citoyens et les mauvais traitements subis lors de l’imposition par le gouvernement canadien de la Loi des mesures de guerre. Pour son film, il recevra le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1975 en plus de quatre Canadian Film Awards. Encore aujourd’hui, Les Ordres se retrouve au sommet des palmarès recensant les films canadiens les plus importants.
Voir des extraits du film sur telequebec.tv
 Les événements d’Octobre 1970
Les événements d’Octobre 1970
87 minutes | 1975 | Documentaire | Réalisation : Robin Spry Primé au festival du film de Chicago, aux Génie de Niagara on the Lake et au Festival de Nyon en Suisse
Les Événements d’Octobre 1970 est intéressant parce qu’il présente le point de vue d’un anglophone en ce qui a trait aux faits saillants qui se sont déroulés au Québec à l’automne 1970. Robin Spry a réalisé ce film en ayant comme objectif d’instruire le public. Il fut lancé dans la controverse alors que le sujet lui-même était controversé. Spry retrace les grandes lignes de l’histoire d’Octobre 1970 avec un souci d'impartialité, à partir de tournages originaux et d'images d'archives.
Voir le film en entier sur le site web de l’Office national du film
 24 heures ou plus…
24 heures ou plus…
113 minutes | 1977 | Documentaire | Réalisation : Gilles Groulx Prix de la critique 1977 – Canada
Jugé trop révolutionnaire au moment de sa réalisation en 1971, le documentaire de Gilles Groulx, produit par l’Office national du film, sera interdit de diffusion jusqu’en 1977. Filmé un an après les événements d’Octobre 70, Groulx veut dénoncer l’aliénation des masses en plus de réveiller les consciences. Pour ce faire, il utilisa une facture visuelle audacieuse alternant la couleur et le noir et blanc, l’utilisation du graffiti, la publicité et l’éditorial.
Voir le film en entier sur le site web de l’Office national du film
 La liberté en colère
La liberté en colère
73 minutes | 1994 | Documentaire | Réalisation : Jean-Daniel Lafond
Ce documentaire réunit quatre anciens militants du Front de libération du Québec – Pierre Vallières, Charles Gagnon, Francis Simard et Robert Comeau – qui partagent leurs réflexions sur l’histoire du mouvement indépendantiste québécois en plus de faire un retour sur leurs actions des années 60 et 70. Jean-Daniel Lafond cherche à découvrir ce qui reste des idées révolutionnaires de ces hommes 25 ans après les événements d’Octobre 70.
Voir le film en entier sur le site web de l’Office national du film
 Octobre
Octobre
97 minutes | 1994 | Fiction | Réalisation : Pierre Falardeau Primé au Rendez-vous du cinéma québécois - Prix L.E. Ouimet-Molson, Prix Guy L'Écuyer, primé au Festival de Blois La Salamandre d'or et au Festival de Rennes.
Octobre a été co-scénarisé par l'ex-felquiste Francis Simard avec qui Falardeau s'était lié d'amitié après l'avoir visité en prison. Le réalisateur propose une interprétation des événements d’Octobre 70 à travers les yeux des ravisseurs du ministre Laporte. L’histoire débute la veille de son enlèvement et se termine au moment de sa mort. Falardeau relate les moments importants de la crise – arrestations arbitraires des sympathisants indépendantistes, proclamation de la Loi des mesures de guerre par le gouvernement fédéral, occupation du Québec par l'armée canadienne – tel qu’ils furent vécus par les plus importants membres du FLQ.
Voir des extraits du film sur telequebec.tv
 Nô
Nô
85 minutes | 1998 | Fiction | Réalisation : Robert Lepage Primé au Festival international du film de Toronto et au Sudbury Cinéfest
Robert Lepage réalise ce film en 1998 alors que les Québécois viennent de dire non pour la seconde fois au projet de souveraineté. L’histoire, qui se déroule en 1970, présente en toile de fond deux événements importants pour l’histoire du pays: la crise d'Octobre au Québec et la participation québécoise à l'exposition universelle d’Osaka au Japon. Sophie, le personnage principal dans le film, évolue dans un cadre où paradoxalement le Québec se replie sur lui-même tout en s’ouvrant sur le monde.
Voir un extrait du film sur telequebec.tv
La compilation a été réalisée par Jean-Philippe Proulx
Jeux olympiques de 1932: L’or d’Hilda Strike à une athlète hermaphrodite?
Lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 1932, la sprinteuse canadienne Hilda Strike se fit coiffer de quelques centimètres au fil d’arrivée du 100 mètres par l’athlète polonaise Stella Walsh. Lors de la mort de cette dernière en 1980, une autopsie confirma qu’elle était hermaphrodite. Dans l’édition décembre 2010 / janvier 2011 du magazine Canada’s History, vous trouverez un article écrit par Ron Hotchkiss portant sur cette histoire. En complément, ci-dessous, vous découvrirez une entrevue accordée par Strike à la journaliste Danielle Levasseur en 1984 pour la télévision française de Radio-Canada.
Voir l'entrevue accordée par Hilda Strike à la journaliste Danielle Levasseur de Radio-Canada.

 Le 1er septembre, naissance à Montréal d’Hilda Strike.
Le 1er septembre, naissance à Montréal d’Hilda Strike.
 Elle cumule quinze coupes et trente médailles lors de diverses compétitions.
Elle cumule quinze coupes et trente médailles lors de diverses compétitions.
 Elle égale le record olympique de 12,2 secondes au 100 mètres sprint établit en 1928 par l’Américaine Elizabeth Robinson.
Elle égale le record olympique de 12,2 secondes au 100 mètres sprint établit en 1928 par l’Américaine Elizabeth Robinson.
♦ Médaillée d’argent sur 100 mètres, Jeux olympiques de Los Angeles.
♦ Médaillée d’argent sur 4 x 100 mètres relais, Jeux olympiques de Los Angeles.
♦ Athlète la plus populaire à Montréal.
♦ Athlète féminine par excellence au Canada.
 Hilda Strike fonde le Mercury Athletic Club.
Hilda Strike fonde le Mercury Athletic Club.
 Jeux du Commonwealth à Londres : médaillée d’argent sur 100 verges et médaillée d’argent sur 4 X 110 verges relais.
Jeux du Commonwealth à Londres : médaillée d’argent sur 100 verges et médaillée d’argent sur 4 X 110 verges relais.
 Mariage avec Fred Sisson et retrait de la compétition.
Mariage avec Fred Sisson et retrait de la compétition.
 Introduction des tests de vérification du sexe aux Jeux olympiques.
Introduction des tests de vérification du sexe aux Jeux olympiques.
 Intronisation au Panthéon des sports canadiens
Intronisation au Panthéon des sports canadiens
 Mort de Stella Walsh. Une autopsie révèle que cette dernière était hermaphrodite.
Mort de Stella Walsh. Une autopsie révèle que cette dernière était hermaphrodite.
 Hilda Strike demande qu’on lui accorde la médaille d’or qu’elle aurait dû obtenir.
Hilda Strike demande qu’on lui accorde la médaille d’or qu’elle aurait dû obtenir.
 Hilda Strike s’éteint le 9 mars à Ottawa.
Hilda Strike s’éteint le 9 mars à Ottawa.
Ruée vers l’or : Charlotte Gray marche sur les pas de Pierre Berton

Charlotte Gray
Charlotte Gray, auteure et historienne reconnue, a récemment publié un ouvrage ayant pour titre Gold Diggers: Striking It Rich in the Klondike. Madame Gray a également partagé son savoir avec des passionnés d’histoire venus l’entendre le 3 novembre dernier à Winnipeg lors d’une conférence organisée conjointement par Histoire Canada et le H. Sanford Riley Centre for Canadian History. Nous vous invitons à lire l’article qu’elle a publié dans l’édition décembre 2010 / janvier 2011 du magazine Canada’s History et qui a pour titre After the Gold Rush.
Charlotte Gray poursuit à sa manière le chemin tracé par l’historien Pierre Berton, lui-même le fils d’un chercheur d’or ayant grandi à Dawson, ville carrefour de la ruée vers l’or.
Nous vous proposons de faire un retour en arrière en images afin de découvrir ou redécouvrir le documentaire La capitale de l’or, réalisé en 1957 par Colin Low et Wolf Koenig. Les souvenirs de l’historien Pierre Berton inspirèrent le récit de ce film produit par l’Office national du film. Il relate les moments forts de la ruée vers l’or en plus de regrouper un bon nombre de photographies d’époque.
Voir le documentaire La capitale de l’or, réalisation Colin Low et Wolf Koenig, Office national du film, 1957 (21 minutes 37 secondes).
Émilie Fortin-Tremblay

Pierre Nolasque Tremblay et Émilie Fortin-Tremblay (à droite). Image : Association franco-yukonnaise.
Cette grande pionnière du Nord, née le 4 janvier 1872 à Saint-Joseph-d’Alma au Québec, prit pour mari un chercheur d’or nommé Nolasque Tremblay le 11 décembre 1893. L’année suivante, la nouvelle mariée s’aventura dans un voyage de noce peu commun. Après avoir parcouru plus de 8 000 km en direction de Miller Creek au Yukon, Émilie Fortin-Tremblay devint la première femme blanche à traverser le col Chilkoot.
Afin de mieux connaître la vie de cette Franco-Yukonnaise, nous vous proposons une entrevue réalisée avec madame Cécile Girard, rédactrice en chef du journal l’Aurore Boréal de Whitehorse. Madame Girard est également co-auteure de l’ouvrage Un jardin sur le toit : la petite histoire des francophones du Yukon publié par l’Association franco-yukonnaise.
Écoutez l’intégralité de l’entrevue accordée par Cécile Girard à Histoire Canada (durée 10 minutes, 11 secondes).
Pour en savoir plus:
Girard, Cécile et Renée Laroche, Un jardin sur le toit. La petite histoire des francophones du Yukon, Whitehorse, Association franco-yukonnaise, 1991.
Serge Bouchard présente un portrait d’Émilie Fortin-Tremblay à l’émission radiophonique De remarquables oubliés diffusée le 2 mars 2009 à la radio de Radio-Canada.
Découvrez la série de reportages radio et télé produits en août 2008 par Radio-Canada alors que deux femmes de Vancouver marchèrent sur les traces des chercheurs d’or.
Amusez-vous grâce au jeu La ruée vers l'or du Klondike du Musée virtuel du Canada
Visitez le site Web de Parc Canada
Wilbert Coffin innocent?

Coffin à la sortie du palais de Justice (Bibliothèque et Archives Canada/PA-166908)
Wilbert Coffin a été pendu le 10 février 1956 après avoir été jugé coupable des meurtres de trois chasseurs américains. À l’époque, des doutes demeuraient quant à la culpabilité de Coffin. L’opinion publique était divisée. Avec certaines irrégularités lors du procès et une preuve déficiente, plusieurs ont affirmé qu’un innocent avait été pendu. Aujourd’hui, presque 50 ans après les événements, des voix s’élèvent afin de réhabiliter la mémoire de l’homme.
Pour en savoir plus sur cette histoire qui a marquée l’histoire judiciaire québécoise et canadienne, nous vous invitons consulter les documents ci-dessous. Vous pouvez également lire l’article Reasonable Doubts de Ray Argyle publié dans l’édition de décembre 2010 / janvier 2011 du magazine Canada’s History.
Lecture :

Clément Fortin, L’Affaire Coffin, une supercherie ? Montréal , Wilson & Lafleur, 2007. 384 pages.

Jacques Hébert, Coffin était innocent. Beloeil, Éditions de l’Homme, 1958. 188 pages.

Jacques Hébert, L'affaire Coffin - J'accuse les assassins de Coffin, précédé de Une petite autopsie de l'affaire, et suivi de, Trois jours en prison, Montréal, Domino, 1980, 261 pages.
Cinéma :

L’Affaire Coffin
Année de réalisation : 1980
Réalisateur : Jean Claude Labrecque
Avec August Schellenberg, Yvon Dufour, Micheline Lanctôt, Jean-Marie Lemieux.
Télévision :
Documentaire Le mystère Coffin par Solveig Miller et Jean-Louis Boudou diffusé le 28 mars 2007 dans le cadre de l’émission Enjeux à la télévision de Radio-Canada.
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
DocumentairePeine de mort: la justice qui tue, réalisé par René Lévesque et diffusé le 17 janvier 1960 dans le cadre de l’émission Premier plan à la télévision de Radio-Canada.
Série d’entrevues réalisées en 1963 par le journaliste Pierre Nadeau avec le coroner Lionel Rioux, le jugeJoseph L. Duguay, l’avocat François B. Gravel et l’avocat Louis Doiron. Les entrevues ont été diffusées le 4 décembre 1963 à la télévision de Radio-Canada.
Web :
Dossier de Radio-Canada.ca intitulé
La peine de mort au Canada. Recherche de Florence Meney,
Les 10 lieux historiques nationaux les plus populaires

L'Anse aux Meadows. / Photo: Parcs Canada
Imaginez-vous parcourir les routes du Canada pour visiter dix lieux historiques nationaux. Lesquels choisiriez vous?
C’est la question que nous nous sommes posée, au magazine Canada’s History. Et quelle question! Il y a tant de sites extraordinaires, plus de 150 en fait. Et ce ne sont là que les sites administrés par Parcs Canada, qui célèbre cette année son 100e anniversaire. Il y a près de 800 autres lieux historiques nationaux, appartenant notamment à des particuliers, des sociétés d’histoire, des entreprises ou d’autres paliers de gouvernement.
Nous avons établi notre palmarès en fonction de la pertinence historique des sites et de la qualité de l’expérience de leurs visiteurs. Nous voulions également couvrir une vaste période historique et représenter le plus de régions possibles.
Si vous deviez entreprendre ce voyage, vous feriez revivre les histoires du Canada de multiples façons : autour du feu, dans une hutte de terre viking à Terre-Neuve, en entendant retentir les canons à Louisbourg, en assistant à une reconstitution de la déportation des Acadiens, en longeant les remparts du Vieux Québec, en pagayant le long du canal Rideau, en préparant les fourrures au poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson de Lower Fort Garry, en jetant un coup d’oeil dans les trous de tirailleurs des Métis, sur le lieu de leur dernière bataille, à Batoche, en lançant le lasso au Bar U Ranch, en suivant les gardiens Haida sur leurs sites sacrés, et en cherchant de l’or au Klondike.
En attendant, parcourez les sections suivantes afin de voir quelques uns des plus beaux lieux historiques canadiens.
- L'Anse aux Meadows, Terre-Neuve-et-Labrador
- Fortifications de Québec, Québec
- Grand-Pré, Nouvelle-Écosse
- Forteresse-de-Louisbourg, Nouvelle-Écosse
- Canal Rideau, Ontario
- Lower Fort Garry, Manitoba
- Batoche, Saskatchewan
- Bar Ranch U, Alberta
- Nan Sdins, Colombie-Britannique
- Dawson, Territoire du Yukon
L’Anse aux Meadows
Le preuve d’une présence des Vikings au Canada.
Ce village viking reconstruit se trouve sur la pointe nord de la péninsule nord de Terre Neuve, isolé du reste de la civilisation. D’anciens récits relatent le passage des Vikings en Amérique du Nord, notamment les sagas du Vinland. On y raconte qu’il y a environ 1 000 ans, Lief Eriksson a accosté sur le continent, qu’il appela Vinland, ou « terre de vin », car les raisins sauvages y poussaient en abondance.
Selon ces sagas, d’autres Vikings le suivirent, mais leur présence n’a été prouvée qu’en 1960, lorsqu’un explorateur norvégien, Helge Ingstad, décida d’entreprendre des recherches plus poussées le long de la côte. George Decker, résident local, le dirigea vers une zone de crêtes et de buttes recouvertes de hautes herbes. Ingstad et sa femme, l’archéologue Anne Stine Ingstad, passèrent huit ans à explorer le site, avec l’aide d’archéologues provenant de partout dans le monde.
Ils découvrirent les ruines de bâtiments, des foyers et une forge. Les archéologues trouvèrent également de plus petits artéfacts, comme un fermoir de bronze, une aiguille en os et un volant de fuseau. Ces deux derniers articles laissent entendre que cette colonie accueillait également des femmes. Il s’agissait sans doute d’un camp saisonnier : on y récoltait le bois et chassait le gibier, que l’on ramenait au Groenland.
Les Vikings ne sont pas demeurés longtemps à L’Anse aux Meadows. Les sagas relatent des échanges houleux entre les Norvégiens et les Autochtones, qu’ils appelaient « Skraelings ». Trop peu nombreux pour se défendre, ils quittèrent la région après quelques années.
Ce lieu est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Période historique : 1 000 ans apr. J.-C.
À faire : Visitez le camp reconstitué des Vikings, où des comédiens en costume d’époque jouent les rôles de divers personnages : le capitaine et sa femme, les membres de l’équipage, etc. Écoutez les sagas dans la hutte de terre du chef. Voyez comment on forgeait le métal et tissait les textiles, apprenez en davantage sur les méthodes de cuisson et d’autres activités du quotidien dans cette colonie d’une autre époque. Admirez le paysage à la fois austère et magnifique de cette terre sauvage.
S’y rendre : L’Anse aux Meadows est à environ quatre à cinq heures de route au nord du parc national du Gros Morne, sur la péninsule nord de Terre Neuve. Il y a un aéroport à Deer Lake, juste au sud de Gros-Morne.
D’autres extras en ligne :
Forteresse de Louisbourg
Le Gibraltar de l’Amérique du Nord.
L’emplacement de la forteresse, sur une pointe brumeuse et isolée du Cap Breton, semble encore aujourd’hui éloigné de tout. Mais au début du 18e siècle, Louisbourg était un des ports les plus achalandés d’Amérique du Nord, en grande partie grâce à la lucrative pêche à la morue dans les Grands Bancs.
Comme il s’agit d’un port en eau profonde, situé à un endroit stratégique permettant de garder l’entrée du fleuve Saint-Laurent, la France a consacré 26 années et des sommes énormes à la construction de ce qui deviendra la forteresse la plus solide et la plus impressionnante du continent.
Lorsque les Britanniques en prirent possession suite au siège de 1758, ils démantelèrent le fort pierre par pierre et brique par brique afin que les Français ne puissent plus jamais s’en resservir comme base fortifiée. Le gouvernement du Canada a commencé à reconstruire un quart de la ville emmurée originale en 1961. Il s’agit du plus important projet de reconstruction historique au Canada, avec ses cinquante bâtiments couvrant plus de cinq hectares. Il faut une journée entière pour tout visiter.
Période : 1720 à 1740
À faire : Assistez à une scène de comédie française dans une taverne de l’époque, participez à des ateliers culinaires, ou sustentez vous dans un des trois restaurants du site. Prenez part à une visite meurtre et mystère ou partez à la recherche de fantômes en compagnie d’interprètes costumés. Allez voir les fouilles archéologiques. Sur les plages près du fort, trempez vos orteils dans l’eau de l’Atlantique et imaginez vous que vous prenez la ville d’assaut, en 1758, vêtu du lourd costume du soldat britannique.
S’y rendre : Sur l’île du Cap-Breton. Un long voyage de six heures, égayé de magnifiques paysages, à partir de Halifax. Environ une demi heure de route à partir de l’aéroport de Sydney.
D’autres extras en ligne :
Grand-Pré
Le coeur de la vieille Acadie bat encore dans ce village.
Grand-Pré fut l’épicentre d’un des événements les plus tragiques de l’histoire acadienne. Le 5 septembre 1755, les hommes et les garçons furent rassemblés à la vieille église, où le lieutenant colonel britannique John Winslow lut à haute voix une ordonnance visant à expulser tous les colons de langue française. Ce fut le début du Grand dérangement, l’expulsion forcée des Acadiens hors des provinces maritimes. Ils furent envoyés en Grande-Bretagne, en France et dans diverses colonies britanniques. Des milliers y laissèrent leur vie.
Grand-Pré disparut et aurait sans doute été oublié, n’eut été de Henry Wadsworth Longfellow, qui publia le poème Evangeline, relatant cette grande tragédie, en 1847. Les touristes américains se rendirent sur les lieux en grand nombre, mais n’y trouvèrent que des marais et de vieux saules. Plus tard, on y érigea une statue d’Évangéline et on bâtit une église en souvenir de la déportation.
Aujourd’hui, Grand-Pré est à la fois un site commémoratif pour les Acadiens et un symbole représentant leur mode de vie d’avant la déportation. Grand-Pré a été désigné lieu historique national en 1961.
Période : 1682–1755.
À faire : Visitez l’église Souvenir et voyez les peintures illustrant la déportation exécutées par Claude Picard. Visitez également le site archéologique. Participez à une pièce de théâtre extérieur interactive sur la vie à Grand Pré avant la déportation. Promenez vous autour des vieux saules, du verger et de la mare aux canards, et admirez ce paysage champêtre. Profitez également des événements organisés lors des journées acadiennes, en juillet.
S’y rendre : Grand-Pré dans la vallée de l’Annapolis Valley, à environ une heure de route de Halifax. À partir de la route 101, prenez la sortie 10 vers Wolfville et suivez la route 1 ouest pendant un kilomètre, ensuite prenez la direction nord pour un autre kilomètre, sur le chemin Grand-Pré.
D’autres extras en ligne :
Fortifications de Québec
La seule ville fortifiée nord américaine sauvée des ruines.
Le Vieux-Québec est un véritable palimpseste : on y retrouve les traces de l’histoire militaire du pays, pendant quatre siècles suivant l’arrivée de Champlain. Ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO, juché au sommet de hautes falaises, a joué un rôle stratégique en matière de défense. Pendant un siècle et demi, Québec était une colonie française florissante, jusqu’à l’invasion des Britanniques en 1759. Sous le règne britannique, le Vieux-Québec faisait toujours office de bastion, cette fois-ci contre la menace permanente d’une invasion en provenance des États-Unis.
La vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent et les environs en fait une attraction touristique toute désignée. Construits sur ce qui restait de l’Habitation originale de Champlain, ces imposants remparts et profondes tranchées rappellent l’époque des villes emmurées construites du 17e au 19e siècle. Au coeur des fortifications se trouve La Citadelle, construite de 1820 à 1831.
Les fortifications étaient vouées à l’abandon lorsque l’armée britannique se retira en 1871. Mais Lord Dufferin, gouverneur général du Canada de 1872 à 1878, aimait le Vieux-Québec et fit de La Citadelle sa résidence secondaire. Il réussit à convaincre les politiciens locaux de sauver les vieux murs de la destruction.
Un des sites historiques les plus visités au Canada, le Vieux-Québec accueille environ 500 000 visiteurs par année.
Période : Du début des années 1600 à la fin des années 1800.
À faire : Participez à une visite guidée bilingue des remparts et des hauteurs de Québec. La visite à pied prévoit un arrêt sur un site archéologique permanent. À La Citadelle, on peut visiter le Musée Royal 22e Régiment — les fameux Van Doos. Vous pouvez organiser votre visite afin de profiter du festival annuel de cinq jours célébrant la vie en Nouvelle-France. Il y a aussi des journées thématiques, des programmes scolaires et divers événements spéciaux, notamment des concerts et des conférences.
S’y rendre : Les fortifications de Québec sont au coeur de la ville de Québec.
D’autres extras en ligne :
Canal Rideau
Une voie navigable au lourd passé
La beauté et la valeur récréative de cette voie navigable de 202 kilomètres de long démentent bien ses origines : au début du 19e siècle, il s’agissait d’une véritable stratégie de défense. Après la guerre de 1812, les relations entre l’Amérique du Nord britannique et les États Unis sont de plus en plus tendues. Le lien navigable vital entre Montréal et les Grands Lacs, dont la majeure partie forme la frontière entre les deux pays, était vulnérable à une fermeture dans l’éventualité d’un conflit.
On décida donc de construire un autre passage, d’Ottawa à Kingston, reliant lacs et rivières grâce à un réseau de canaux et à quarante sept écluses. Il s’agissait d’un ambitieux ouvrage qui a pris cinq ans (1827 à 1832) à compléter et qui a requis des milliers de travailleurs, la plupart de récents immigrants irlandais. Les marécages de la région favorisaient la transmission de la malaria, qui a tué cinq cents de ces travailleurs.
Le prix de cet ouvrage, soit 800 000 livres sterling (60 % de plus que l’estimation initiale), eut l’effet d’un choc au Parlement britannique. Ses beaux jours en tant que voie navigable commerciale furent de courte durée, mais le canal devra sa survie à sa vocation récréative. Il a été nommé site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007.
Période : 1827 à aujourd’hui.
À faire : Parcourez le canal en bateau pour admirer le paysage, les villes historiques et petits villages de l’est de l’Ontario. Assistez aux représentations théâtrales estivales offertes par les comédiens de Parcs Canada afin de revivre l’histoire des villes et villages parsemés le long du canal. Patinez sur une section du canal au centre ville d’Ottawa.
S’y rendre : Le canal débute à Ottawa et se termine à Kingston; on peut y accéder à de nombreux endroits le long de son parcours.
D’autres extras en ligne :
Batoche
Un lieu tranquille témoin de la dernière bataille des Métis.
Ce petit village paisible sur les rives de la rivière Saskatchewan Sud fut un des derniers champs de bataille de la rébellion du Nord-Ouest de 1885. Cette rébellion commença des années plus tôt, lorsque les Métis, des descendants de commerçants de fourrure et d’Autochtones, se virent menacés par les colons qui déferlaient dans la région, en provenance de l’est du Canada. Après l’échec de la rébellion de la rivière Rouge, menée par Louis Riel en 1869, de nombreux Métis s’installèrent plus à l’ouest, en Saskatchewan, pour refaire leur vie.
Lorsqu’ils se virent refuser la protection qu’ils tentaient d’obtenir d’Ottawa, les Métis se tournèrent vers Riel, qui sortit d’exil et fit de Batoche le siège du gouvernement provisoire de la Saskatchewan. Les troupes du Dominion arrivèrent rapidement, grâce au chemin de fer nouvellement construit. Le petit contingent de Métis connut quelques victoires, mais fut finalement entouré à Batoche par les soldats qui étaient beaucoup plus nombreux.
Les Métis n’étaient armés que de carabines, alors que les soldats étaient pourvus de mitrailleuses Gatling et de quatre canons de neuf livres. Malgré ce flagrant déséquilibre, les Métis résistèrent avec ardeur pendant quatre jours avant d’être finalement vaincus. Les deux leaders, Louis Riel et Gabriel Dumont réussirent à s’échapper, mais plus tard, Riel se rendit et fut pendu pour trahison.
Ce qui s’est produit en ce lieu a encore des échos aujourd’hui. Riel est encore un personnage controversé et les droits des Métis demeurent une question d’actualité.
Période : 1860 à 1900.
À faire : Suivez la présentation audiovisuelle primée au centre du visiteur et parcourez le site à votre guise. Visitez les bâtiments restaurés, comme l’église, où l’on peut encore voir les trous creusés par les balles de fusil, preuves concrètes des batailles qui se sont déroulées à cet endroit. Parcourez le sentier qui traverse le cimetière et voyez les trous de mitrailleurs utilisés par les Métis. Organisez votre visite en fonction des événements spéciaux qui s’y tiennent, comme l’événement annuel Back to Batoche Days, un grand festival métis qui a lieu la troisième fin de semaine de juillet.
S’y rendre : Batoche est à environ une heure en voiture au nord-est de Saskatoon.
D’autres extras en ligne :
Lower Fort Garry
Les beaux jours du commerce de la fourrure
Lorsque les inondations de 1826 détruisirent le siège social de la Compagnie de la Baie d’Hudson, à l’endroit même où se trouve aujourd’hui Winnipeg, la compagnie décida de reconstruire ses bases sur un terrain surélevé. C’est à cet endroit que vit le jour Lower Fort Garry, le plus ancien poste de fourrure encore intact en Amérique du Nord.
Construit dans les années 1830, le fort était fait pour durer! Il a été bâti avec des pierres calcaires, plutôt qu’en bois, pour lui assurer une certaine pérennité à titre de centre administratif pour la Terre de Rupert, le vaste empire commercial de la compagnie. Même s’il ne joua ce rôle que quelques années, il eut de nombreuses vocations. Les troupes britanniques y furent postées en 1840 lors du conflit frontalier avec l’Oregon, à une époque où une guerre avec les États Unis semblait imminente. Les opposants du chef métis Louis Riel s’y rassemblèrent en 1871 et la Royale gendarmerie à cheval du Nord-Ouest y forma ses premières recrues. C’est également à Lower Fort Garry que l’on signa le premier de nombreux traités. Cet imposant bâtiment servit plus tard de pénitencier et d’asile d’aliénés.
Les murs, les remparts, les batteries d’armement, les résidences sont demeurés inchangés, et forment ensemble le plus important regroupement de bâtiments originaux du 19e siècle dédiés au commerce de la fourrure au Canada.
Période : 1850.
À faire : Promenez vous sur le site et écoutez les interprètes en costumes d’époque vous raconter la vie des commis de la compagnie, des conducteurs de barges d’York, des commerçants, des trappeurs autochtones et des membres de la haute société de la rivière Rouge. Les enfants peuvent jouer le rôle d’un travailleur de la CBH pendant une journée. En 2011, on y tiendra des journées de commémoration du Traité 1, au début du mois d’août.
S’y rendre : Lower Fort Garry se situe à environ 20 minutes au nord de Winnipeg, sur l’autoroute 9.
D’autres extras en ligne :
Bar U Ranch
Une histoire d’élevage au Canada.
(vidéo en anglais)
L’arrivée du chemin de fer, la disparition du bison et la colonisation de l’Ouest après la Confédération ont contribué à la construction de ranchs immenses, comme le Bar U. Créé en 1881, le ranch est devenu légendaire en raison des personnages colorés qui y ont séjourné.
Par exemple, le cowboy de renom, John Ware, un esclave noir affranchi provenant de Caroline du Sud, a accompli de nombreux exploits au Bar U, notamment le sauvetage d’un troupeau d’une tempête hivernale meurtrière. En outre, le prince de Galles, qui devint plus tard Édouard VIII et renonça au trône, aimait tellement le Bar U qu’il acheta le ranch voisin. Harry Longabaugh, également connu sous le nom de Sundance Kid, y travailla comme éleveur de chevaux jusqu’à ce qu’il réoriente sa carrière et choisisse le métier plus lucratif de voleur de trains!
À la belle époque, le Bar U couvrait 650 km2 (65 000 hectares) de pâturages et pouvait accueillir 30 000 têtes de bétail. Les descendants des chevaux de trait qu’on y élevait, de la race des percherons, ont tiré des chariots et trolleys dans les villes d’Amérique du Nord.
On construisit plus tard au Bar U des abattoirs et des minoteries. Il fut ensuite divisé et vendu. Parcs Canada en acheta 148 hectares en 1991.
Période : 1881 à 1950.
À faire : Participez à une visite guidée à pied ou en chariot tiré par un cheval. Visitez les immeubles patrimoniaux du ranch. Assistez à des démonstrations du travail de cowboy ou apprenez à lancer le lasso et à diriger un équipage de percherons. Parcourez les sentiers au pied des montages et participez à divers événements spéciaux pendant toute la belle saison.
S’y rendre : Le Bar U Ranch est à environ 90 minutes au sud de Calgary, près de Longview sur l’autoroute 22.
D’autres extras en ligne :
Site du patrimoine haïda Gwaii Haanas
Les vestiges de ce village Haida révèlent un passé riche et florissant.
Ce site magnifique sur une île éloignée de la C.-B. raconte l’histoire d’un peuple créatif qui a vécu à Haida Gwaii (îles de la Reine-Charlotte) pendant des milliers d’années. Les Haida, qui trouvaient facilement à se nourrir, puisqu’ils avaient accès à la mer et à la forêt, purent créer une culture complexe et développer leurs talents artistiques.
Lorsque les navires européens apparurent à l’horizon de la côte Ouest dans les années 1700, les peuples du village de Nan Sdins, sur l’île de SGang Gwaay, se convertirent rapidement au commerce des peaux et des fourrures de loutre et d’autres animaux sauvages. Mais les Européens étaient également porteurs d’une maladie mortelle pour les Haida, la variole. Le village passa d’une population de 300 à quelques douzaines avant d’être complètement abandonné en 1888.
Les commerçants en antiquité vidèrent littéralement le village de ses joyaux : mâts totémiques sculptés, boîtes en bois cintré, masques, sculptures et autres articles. Les trente deux mâts totémiques et dix maisons qui restent constituent les plus belles oeuvres d’art de ce genre dans le monde. C’est pour cette raison que l’endroit a été déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981.
Aujourd’hui, les gardiens de Haida Gwaii surveillent le site, qui fait partie de la réserve de parc marin national Gwaii Haanas et du site du patrimoine Haida.
Période : 19e siècle
À faire : Visitez le village en petite embarcation ou en kayak de mer dans le cadre d’une visite guidée et écoutez les histoires des gardiens de Haida Gwaii. Venez admirer les visages mythiques sculptés sur les mâts totémiques de cèdre. Les groupes se limitent à 12 personnes à la fois. Visitez un autre ancien village Haida à Gwaii Haanas.
S’y rendre : Le site est sur l’île de SGang Gwaay (île Anthony) et est accessible en petite embarcation. Les visiteurs indépendants doivent réserver et s’inscrire au bureau de Gwaii Haanas Queen Charlotte ou aux centres de réception des visiteurs à Sandspit et Queen Charlotte.
D’autres extras en ligne :
Dawson
Une ruée vers l’or qui fascine encore.
Le poète Robert Service n’a pas exagéré les difficultés éprouvées par les hommes qui fouillèrent le sol du Klondike en quête d’or. Les rumeurs de cette précieuse découverte atteignirent les villes en pleine période de récession. Des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des chômeurs américains, se ruèrent vers le nord en 1898. Ils escaladèrent les dangereux cols Chilkoot et White à maintes reprises, transportant une demi tonne de fournitures sur leur dos.
En une saison, les vasières au confluent des rivières Yukon et Klondike furent transformées en campements, accueillant jusqu’à 30 000 personnes et faisant de ce village improvisé la plus grande communauté à l’ouest de Winnipeg. Les saloons et bordels y poussaient comme des champignons, menaçant de transformer Dawson en une ville sans foi ni loi. Mais le légendaire Sam Steele, de la police montée, réussit à rétablir l’ordre dans la ville en interdisant le port d’armes de poing.
En 1899, Dawson était une ville digne de ce nom, dotée de l’électricité, du téléphone, de cinémas et d’un secteur commercial appréciable. La folie ne dura que deux saisons. L’exploitation minière s’y poursuivit, mais fut essentiellement laissée entre les mains de grandes entreprises.
Aujourd’hui, Dawson fait partie d’un complexe historique intégré au lieu historique national du Klondike.
Période : Fin des années 1890.
À faire : Passez y quelques jours, il y a de nombreux sites à visiter. Suivez la visite guidée du centre de la ville avec un interprète de Parcs Canada. Écoutez les poèmes de Robert Service, lus deux fois par jour dans sa cabane. Prenez place à bord du S.S. Keno, la plus grande embarcation de bois du genre au monde, et parcourez un sentier qu’empruntaient les mineurs. Hors du site de Parcs Canada, vous trouverez également le Diamond Tooth Gertie’s, un casino restauré datant de 1910 où l’on peut encore assister à un spectacle de french cancan, ainsi que le centre culturel Dänojà Zho.
S’y rendre : À partir de Whitehorse, Dawson est à une heure de distance en avion, ou de cinq à six heures en voiture.
D’autres extras en ligne :
Pour en savoir plus sur la grippe espagnole

Hommes portant un masque durant l'épidémie de grippe espagnole. Alberta, 1918.Credit: Bibliothèque et Archives Canada / PA-025025
Dans le numéro d’avril-mai du magazine Canada’s History, l’anthropologue Paul A. Erickson s’est intéressé à la présence de la grippe espagnole dans la ville d’Halifax en 1918. La pandémie de grippe qui toucha le monde entier à cette époque n’épargna pas les Canadiens. Environ 50 000 personnes perdirent la vie.
En complément à l’article de Paul A. Erickson, nous vous proposons ici deux documents sélectionnés parmi les archives de Radio-Canada. Ils vous permettront de mieux comprendre les conséquences de cette pandémie au Québec. Le premier est un documentaire intitulé Pandémie de 1918 : la grande tueuse. Il fut présenté le 29 juin 2002 dans le cadre de l’émission Histoires Oubliées. Le second document est une entrevue radiophonique réalisée par Lizette Gervais avec le docteur Albert Cholette qui fut diffusée le 1er octobre 1976 dans le cadre de l’émission La vie quotidienne. Le docteur Cholette, qui était jeune praticien à cette époque, évoque ses souvenirs.
Voir le documentaire Pandémie de 1918 : la grande tueuse
Émission Histoire Oubliée, Productions Vic Pelletier inc., Radio-Canada, 2002 (19 minutes 11 secondes).
Écouter l’entrevue radiophonique Médecin au temps de la grippe espagnole
Émission La vie quotidienne, Radio-Canada, 1976 (6 minutes 58 secondes).
Lorsque les premières automobiles sillonnèrent les routes du Québec

Monsieur Guy Thibault, auteur et passionné d'histoire automobile (Photo Éditions GID)
Dans l’édition avril-mai du magazine Canada’s History, James Mays et Ryan Rogers proposent un article portant sur la toute première voiture importée au Canada, à l’Île-du-Prince-Édouard, en 1866.
En complément à cet article, nous vous proposons une baladodiffusion réalisée avec monsieur Guy Thibault, auteur et passionné d’histoire. L’auteur a publié par le passé aux Éditions GID un ouvrage intitulé L’Immatriculation au Québec. On y apprend nottament comment les autorités en place en arrivèrent à obliger que tous les véhicules automobiles soient enregistrés auprès du gouvernement provincial.
En 2011, toujours chez GID, monsieur Thibault publie L’Automobile et ses témoins. Il s’attarde cette fois aux traces laissées par le passage de l’automobile pendant la première moitié du XXe siècle. Dans cette entrevue, nous avons discuté avec lui de l’apparition des premières automobiles au Québec.
Écoutez l’intégralité de l’entrevue accordée par Guy Thibault à Histoire Canada (durée 11 minutes, 36 secondes).
Guy Thibault, L’Automobile et ses témoins, Québec, Les Éditions GID, 2011, 190 pages.
www.leseditionsgid.com

Lorsqu’elle fait son apparition, au début du XXe siècle, l’automobile ne fait pas l’unanimité; surprenante et pétaradante, elle dérange l’ordre établi. On s’interroge sur la pertinence de cette curieuse invention qui fonctionne sans chevaux. Alors qu’on la considère comme un gros jouet destiné aux gens aisés ou en mal de sensations, on est bien loin de se douter que ces machines bizarres révolutionneront les transports et, par le fait même, les mœurs et la vie courante.
En s’imposant de plus en plus, l’automobile donne lieu à de nombreux changements et teinte différentes sphères du quotidien. Le fait d’apprivoiser la machine provoque non seulement des avancements technologiques, mais aussi des transformations dans les mœurs, ainsi des forgerons deviennent mécaniciens et des marchands généraux, marchands de pièces et d’accessoires d’auto de tous genres. Devenue plus performante, l’automobile permet de sortir de la ville, ce qui génère un tout nouveau genre de tourisme et impose des modifications sur les routes et une législation appropriée : signalisation, permis de conduire, immatriculation. Les automobiles sont la fierté de leurs propriétaires et deviennent un mode d’expression qui suscite la créativité des artistes qui produisent, entre autres, des ornements de radiateur somptueux et des publicités à faire rêver. De la même façon que sur les routes, l’automobile s’impose peu à peu dans l’univers des jouets et des jeux, un réel bonheur pour les petits et les grands.
C’est ce large univers de l’automobilisme au Québec que l’auteur vous invite à découvrir grâce à une multitude d’objets, de documents et de photographies anciennes.
ACHETER CHEZ RENAUD BRAY
Cent chandelles pour Parcs Canada

Orchestre de flûtes / Parcs Canada
Franchir le cap des cent ans est sans contredit une étape importante dans un parcours. Parcs Canada, qui célèbre en 2011 son centième anniversaire, organise des célébrations un peu partout au pays à l’intention de la population.
Jeudi le 19 mai 2011, Parcs Canada célèbre son100e anniversaire. Afin de souligner cet événement marquant, l’agence fédérale organise une kyrielle d’activités aux quatre coins du pays à l’intention de la population. Les participants pourront découvrir l’histoire de l’agence à travers différentes activités ludiques et amusantes. Parmi celles-ci, notons des reconstitutions historiques, des ateliers de costume et de maquillage, une grande soirée de camping et la présentation de la nouvelle mascotte. Aussi, des représentants de Parcs Canada seront disponibles afin de vous aider à planifier, avec vos amis ou en famille, votre prochaine escapade dans un lieu historique national canadien.
Au cours des 100 dernières années, près de 1000 sites ont été reconnus comme lieux historiques nationaux et plus de 150 d'entre eux sont actuellement administrés par Parcs Canada. Ces statuts particuliers ont ainsi assuré la protection et la préservation de plusieurs lieux importants en lien avec l'histoire du Canada d'un océan à l'autre. Cliquez ici afin de consulter la liste de tous les lieux historiques nationaux que vous pourriez visiter à l'occasion du 100e anniversaire, ou encore pour découvrir les événements à venir en lien avec la commémoration du centenaire.
Des exclusivités en ligne:
Michel Ducharme se voit décerner le Prix Sir John A. Macdonald

Michel Ducharme lors d'un séjour à Paris, France.
Le concept de liberté et la manière dont les Canadiens la perçoivent et l’exercent, voilà une question au cœur du meilleur ouvrage historique selon la Société historique du Canada en 2011. Le Prix Sir John A. Macdonald, créé afin de récompenser un ouvrage en histoire canadienne, a donc été décerné à Michel Ducharme de l'University of British Columbia. Il reçut le prestigieux prix lors du gala annuel de la SHC pour son livre Le concept de liberté au Canada à l’époque des Révolutions atlantiques (1776-1838), un ouvrage publié en 2010 et disponible en ligne via renaud-bray.com.
Considéré comme un livre à la fois "original et provocateur», la SHC a salué l’ouvrage de Ducharme entre autres pour son analyse réfléchie et nuancée des concepts liés à la liberté au XVIIIe et au XIXe siècle, dans le Bas-Canada et la région de l’Atlantique. Dans un contexte où les révolutions apparaissaient tant en Europe qu’aux États-unis, Ducharme montre que les habitants de l’Est canadien croyaient fermement au concept de liberté, une liberté toutefois différente de celle souhaitée par leurs cousins révolutionnaires américains.
Pour Michel Ducharme, « le livre se voulait une réaction à un mythe fortement répandu dans l’historiographie canadienne voulant que les fondements des États-Unis reposaient sur la liberté alors qu’ils s’ancraient plutôt sur l'ordre au Canada». Dans une entrevue accordée à notre rédacteur en chef Mark Reid, il affirma que « les Canadiens considéraient la notion de liberté, mais une liberté qui était différente.» Ducharme expliqua qu’au Canada, les concepts liés à la liberté « étaient davantage fondés sur les droits individuels que sur les droits politiques. »
Le Prix Sir John A. Macdonald représente une consécration pour les universitaires canadiens. Le prix fut remis avec plusieurs autres récompenses lors de la réunion annuelle de la SHC. Le lauréat 2011 du Prix Sir John A. Macdonald participera également à une cérémonie spéciale organisée à Rideau Hall, à Ottawa, plus tard cet automne, dans le cadre des Prix du Gouverneur général.
Ducharme déclara qu'il était à la fois «transporté et très heureux par cette annonce » en ajoutant « qu’il était très étonné et que la surprise était encore plus grande parce que jamais il n’avait imaginé être en lice. »
Voici la liste complète des gagnants des Prix de la Société historique du Canada:
• CHA Best Article: Mark Osborne Humphries
• Prix Eugene Forsey Prize: Julia Maureen Smith
• Public History Prize: Ronald Rudin
• Political History Group Article Prize: Bradley Miller
• Political History Group Book Prize: Ivana Caccia
• Canadian Committee on Women’s History Prize - lauréate francophone: Maude-Emmanuelle Lambert, lauréate anglophone: Heidi MacDonald
• Aboriginal History Prize: Keith Thor Carlson
• JCHA best article prize: Béatrice Richard
• Prix Bullen Prize: Raul A. Necochea Lopez
• Clio Atlantic: Dean Bavington
• Clio Quebec: Andreé Lévesque
• Clio Ontario: Michelle A. Hamilton
• Clio Prairies: Brenda Macdougall
• Clio North: Vuntut Gwitchin First Nation and Shirleen Smith
• Clio B.C.: Keith Thor Carlson
• Individual Achievement Award: Robert A. J. McDonald
• Ferguson Prize: Nicholas Dew
Lors de la réunion annuelle, on assista un changement de garde à l’exécutif de la SHC. À la présidence, Mary Lynn Stewart de l’Université Simon Fraser a transmis le flambeau à Lyle Dick de Parks Canada West Coast.
Terry Fox: Force, courage et espoir

Photo: The Canadian Press; Montage: Michel Groleau
Dans le numéro de juin/juillet 2011 du magazine Canada’s History, Leslie Scrivener proposait un portrait de la légende sportive canadienne Terry Fox. En complément à cet article, nous vous proposons ici quelques informations supplémentaires sur l’athlète et l’homme de cœur qu’il était.
Terry Fox est né le 28 juillet 1958 à Winnipeg. Il passa une partie de sa vie à Surrey pour déménager finalement à Coquitlam en Colombie-Britanique. Dès son jeune âge, Fox est passionné par le sport et excelle au baseball, au rugby et au basketball. Celui qui rêvait de devenir professeur d’éducation physique voit son rêve basculé le jour où il apprend qu’il est porteur d’une tumeur cancéreuse dans la jambe. Afin de freiner la maladie, les médecins lui amputent une partie de la jambe. Il apprendra alors à marcher avec une jambe artificielle, puis recommencera rapidement la pratique de certains sports comme le golf, le basketball et la course.
Sa passion pour le sport et son envie de combattre la maladie le poussent à imaginer un plan lui permettant de recueillir des fonds au profit de la recherche sur le cancer. L’objectif initial était de parcourir le Canada d’est en ouest afin d’amasser l’équivalent d’un dollar par citoyen. Terry Fox amorce donc le marathon de l’espoir le 12 avril 1980 à Saint-John’s et espère atteindre Vancouver quelques mois plus tard. Le 31 août, près de Thunder Bay en Ontario, après avoir surmonté plusieurs embûches, Fox pense avoir attrapé une grippe. Cette grippe était plutôt une récidive de la maladie cette fois dans les poumons. Il dut renoncer à son marathon.
Pendant qu’il suit une chimiothérapie, Terry reçoit de nombreuses distinctions dont l’Ordre du Canada, The Order of the Dogwoo et le prestigieux trophée Lou Marsh. L’appui de la population s’est confirmé, même après l’arrêt du marathon, ce qui a permis le dépassement de l’objectif du un dollar par citoyen fixé par l’athlète. Terry Fox meurt le 28 juin 1981. En septembre de la même année, une première course Terry Fox est organisée. Aujourd’hui, des courses Terry Fox se déroulent dans soixante pays et des centaines de millions de dollars ont été ramassés jusqu’à présent au profit de la recherche sur le cancer.
Terry Fox aura été un exemple de courage, de persévérance et dévouement. Il aura tissé une toile de solidarité toujours vivante nous permettant d’espérer qu’un jour cette terrible maladie sera éradiquée.
POUR EN SAVOIR PLUS:
Cinéma
 The Terry Fox Story
The Terry Fox Story
(Terry Fox: Le coureur de l’espoir)
Réalisateur : Ralph L. Thomas
Drame, 1983
97 minutes
 Terry
Terry
Réalisateur : Don McBrearty
Drame, 2005
120 minutes
 Into the wind Réalisateurs : Ezra Holland et Steve Nash Documentaire, 2010, 51 minutes Bande annonce du documentaire In the Wind de Steve Nash & Ezra Holland
Into the wind Réalisateurs : Ezra Holland et Steve Nash Documentaire, 2010, 51 minutes Bande annonce du documentaire In the Wind de Steve Nash & Ezra Holland
Suggestion lecture
Maxine Trottier. Le Courage de Terry Fox. Markham, Les Éditions Scholastic, 2010. 30 pages.
 Ce livre, créé en collaboration avec la famille de Terry Fox et la fondation portant son nom, est la première biographie autorisée de Terry Fox écrite pour les jeunes. Des douzaines de photographies éloquentes accompagnées de textes simples relatent l’histoire de Terry Fox et de son héritage. On y raconte sa jeunesse, son amour du sport, l’apparition de son cancer, l’amputation de sa jambe et son entraînement pour réaliser son rêve de traverser le Canada à la course.
Ce livre, créé en collaboration avec la famille de Terry Fox et la fondation portant son nom, est la première biographie autorisée de Terry Fox écrite pour les jeunes. Des douzaines de photographies éloquentes accompagnées de textes simples relatent l’histoire de Terry Fox et de son héritage. On y raconte sa jeunesse, son amour du sport, l’apparition de son cancer, l’amputation de sa jambe et son entraînement pour réaliser son rêve de traverser le Canada à la course.
La Fondation Terry Fox Un seul rêve. Un monde d’espoir.
La Fondation recueille non seulement de l’argent pour la recherche sur le cancer, mais elle continue à diffuser l’histoire de Terry Fox. La Fondation Terry Fox s’efforce de perpétuer les efforts héroïques et l’intégrité incarnés par Terry. À ce jour, plus de 550 millions de dollars ont été amassés dans le monde au nom de Terry pour la recherche sur le cancer. La fondation est responsable d’initiatives comme La Journée Terry Fox, La Journée nationale Terry Fox des écoles et Le Grand Décoiffage contre le cancer.
Télévision
L’abandon de Terry Fox
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Diffusion : 2 septembre 1980
Durée : 40 secondes
Retour de Terry Fox à la maison
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Diffusion : 11 septembre 1980
Durée : 1 minute 43 secondes
Fox : athlète de l’année
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Diffusion : 7 février 1981
Durée : 2 minutes 16 secondes
Le « marathon de l’espoir »
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Diffusion : 20 février 1981
Durée : 3 minutes 6 secondes
Timbres-poste
 Le 13 avril 1982, la Société canadienne des postes émet un premier timbre en l’honneur de Terry Fox. Pour la première fois dans l’histoire,un timbre était émis tout de suite après le décès d’une personne. Auparavant, il fallait attendre 10 ans avant l’émission d’un timbre. Le dessinateur du timbre est Friedrich Peter de Vancouver et au total, 47millions de timbres furent imprimés.
Le 13 avril 1982, la Société canadienne des postes émet un premier timbre en l’honneur de Terry Fox. Pour la première fois dans l’histoire,un timbre était émis tout de suite après le décès d’une personne. Auparavant, il fallait attendre 10 ans avant l’émission d’un timbre. Le dessinateur du timbre est Friedrich Peter de Vancouver et au total, 47millions de timbres furent imprimés.
 Le 17 janvier 2000, Terry Fox est immortalisé de nouveau sur un timbre-poste. Cette fois-ci, on le retrouve dans la prestigieuse collection de timbres du millénaire qui regroupe les Canadiennes et les Canadiens les plus influents. Cette fois-ci, un million de timbre furent imprimés et on doit le design aux artistes Ken Fung, Ken Koo et Samuel Tseng.
Le 17 janvier 2000, Terry Fox est immortalisé de nouveau sur un timbre-poste. Cette fois-ci, on le retrouve dans la prestigieuse collection de timbres du millénaire qui regroupe les Canadiennes et les Canadiens les plus influents. Cette fois-ci, un million de timbre furent imprimés et on doit le design aux artistes Ken Fung, Ken Koo et Samuel Tseng.
Pièce de monnaie
 Le dollar Terry Fox fut émis en 2005 par la Monnaie royale canadienne afin de commémorer le 25e anniversaire du marathon de l’espoir. Il fut dessiné par l’artiste Stan Witten et au total 20 000 pièces furent mises en circulation.
Le dollar Terry Fox fut émis en 2005 par la Monnaie royale canadienne afin de commémorer le 25e anniversaire du marathon de l’espoir. Il fut dessiné par l’artiste Stan Witten et au total 20 000 pièces furent mises en circulation.
En eaux profondes : l’archéologie sous-marine

Nouvelles en provenance du passage du Nord-Ouest. © Parcs Canada
Ce quatrième chapitre de notre série en six épisodes célébrant les 100 ans de Parcs Canada jette un regard sur l'archéologie sous-marine.
Parcs Canada est un chef de file de l'archéologie sous-marine autant sur la scène nationale que sur la scène internationale. Son service d'archéologie subaquatique a été crée en 1964.
La baladodiffusion qui suit est une introduction de Marc-André Bernier, chef du service d'archéologie subaquatique de Parcs Canada. Pour écouter toute la série, consultez Nouvelles en provenance du passage du Nord-Ouest sur le site Web de Parcs Canada.
Écoutez les fichiers balados des archéologues de Parcs Canada pour en apprendre plus sur les recherches sur le terrain qu'ils effectueront dans l'Arctique pendant l’été 2011; ils se rendront d’abord au parc national Aulavik, où ils exploreront le HMS Investigator et étudieront les lieux terrestres associés, puis poursuivront leur recherche des épaves des navires de Franklin, perdus dans les eaux du Nunavut.
Cette série de fichiers balados est aussi disponible sur iTunes, sous « Nouvelles en provenance du passage du Nord-Ouest : Les archéologues de Parcs Canada lèvent le voile sur les mystères entourant les premières explorations de l’Arctique canadien ».
Histoire du Canada publiera plus tard cet automne un magazine spécial en français consacré à Parcs Canada. Pour savoir où et quand vous pourrez obtenir votre copie, abonnez-vous à notre bulletin d’information Histoire à suivre. Vous connaîtrez ainsi tous les détails.
Des pionnières en uniforme rouge

Photo GRC- par Patrik Jandak - Tous droits réservés
En septembre 1974, pour la première fois, 32 femmes amorçaient leur formation au sein de la Troupe 17 de l'École de la Gendarmerie Royale du Canada. Les femmes pouvaient désormais aspirer à des postes normalement réservés aux hommes. Dans l’édition d’août/septembre 2011 du magazine Canada’s History, l'historienne Bonnie Reilly Schmidt fait un retour en arrière pour montrer le chemin parcouru par les femmes depuis 35ans dans la GRC.
En complément à cet article, nous vous invitons à jeter un coup d’œil à ce reportage tiré des archives de la Société Radio-Canada.
Écouter le reportage La GRC engage des femmes
Émission Au jour le jour, 7 avril 1987, Société Radio-Canada, 1987 (2 minutes 50 secondes)
Pour ceux d’entre-vous qui maîtrisez la langue de Shakespeare, nous vous invitons aussi à écouter l’entrevue réalisée par notre rédacteur en chef Mark Reid avec l’historienne Bonnie Reilly Schmidt de l’Université Simon Fraser.

 Création de la Gendarmerie royale du Canada.
Création de la Gendarmerie royale du Canada.
 Des femmes sont employées comme surveillantes dans les prisons de femmes. Au fil du temps, certaines effectuent aussi du travail secret pour la sécurité nationale. Elles ne reçoivent toutefois pas la formation de base de la GRC.
Des femmes sont employées comme surveillantes dans les prisons de femmes. Au fil du temps, certaines effectuent aussi du travail secret pour la sécurité nationale. Elles ne reçoivent toutefois pas la formation de base de la GRC.
 On engage des techniciennes en dactyloscopie et des techniciennes de laboratoire.
On engage des techniciennes en dactyloscopie et des techniciennes de laboratoire.
 Le Dr Frances McGill est la première chirurgienne honoraire de la GRC.
Le Dr Frances McGill est la première chirurgienne honoraire de la GRC.
 Des femmes sont engagées comme gendarmes spéciaux et membres civils. La Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada recommande l'embauche de policières.
Des femmes sont engagées comme gendarmes spéciaux et membres civils. La Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada recommande l'embauche de policières.
 On annonce que désormais la GRC acceptera des femmes pour assumer des fonctions policières.
On annonce que désormais la GRC acceptera des femmes pour assumer des fonctions policières.
 La troupe 17 composée de femmes est diplômée. Comme tenue de cérémonie, elles portaient une tunique rouge, une jupe, des souliers à talons hauts et d'un sac à bandoulière.
La troupe 17 composée de femmes est diplômée. Comme tenue de cérémonie, elles portaient une tunique rouge, une jupe, des souliers à talons hauts et d'un sac à bandoulière.
 Une femme est nommée caporale alors que d’autres deviennent membres du Carrousel.
Une femme est nommée caporale alors que d’autres deviennent membres du Carrousel.
 Première femme pilote dans la Division de l'air.
Première femme pilote dans la Division de l'air.
 Les femmes gendarmes portent désormais le même uniforme que les hommes lors des cérémonies.
Les femmes gendarmes portent désormais le même uniforme que les hommes lors des cérémonies.
 On nomme une femme chef de détachement.
On nomme une femme chef de détachement.
 Première femme sergente.
Première femme sergente.
 Une femme devient la première commissaire adjointe.
Une femme devient la première commissaire adjointe.
 Le 16 décembre 2006, Beverley Ann Busson (qui faisait partie de la Troupe 17 [1974]) devient 21e Commissaire de la GRC.
Le 16 décembre 2006, Beverley Ann Busson (qui faisait partie de la Troupe 17 [1974]) devient 21e Commissaire de la GRC.
 35e anniversaire de l'entrée à la GRC des femmes comme membres réguliers.
35e anniversaire de l'entrée à la GRC des femmes comme membres réguliers.
 La GRC compte 3 890 femmes policières au pays et à l'étranger, ce qui représente 20 % de son effectif de membres réguliers.
La GRC compte 3 890 femmes policières au pays et à l'étranger, ce qui représente 20 % de son effectif de membres réguliers.
Grand bâtisseur: Jack Layton
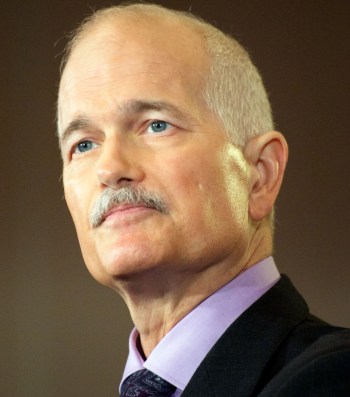
Crédit photo: Matt Jiggins
Le 22 août dernier, le chef du Nouveau Parti démocratique canadien Jack Layton est décédé à son domicile après avoir lutté contre le cancer. L’homme politique passera à l’histoire pour avoir été celui qui mena le NPD pour la toute première fois au rang de l’opposition officielle en remportant 103 sièges lors de la plus récente élection fédérale. Les gains de Layton annonçaient une ère de changement pour le Nouveau Parti démocratique.
Le NPD fut créé en 1961 pour remplacer le Parti social démocratique du Canada. Fondé pendant la Grande Dépression, le PSDC se positionnait comme le défenseur des réformes sociales et économiques. Le NPD a par la suite gardé cet héritage vivant. Le système canadien des soins de santé est attribué à Tommy Douglas, un ancien chef du parti.
Deborah Morrison, présidente de la Société Histoire Canada, a exprimé sa tristesse en apprenant la nouvelle du décès de monsieur Layton. «Jack Layton a apporté une vitalité à la politique canadienne pendant la majeure partie de sa carrière. Nous devons l’admirer pour sa ténacité, son humanité et sa franchise, des qualités saluées lors de la plus récente campagne électorale et qui donnèrent des résultats impressionnants. Malheureusement, nous n’aurons pas le plaisir de le voir à l’œuvre de nouveau lors d’une future campagne. Le Canada a perdu une voix forte. »
La combativité de monsieur Layton et son talent de leader positif ont été remarqués dès son jeune âge alors qu’il militait et s’impliquait au sein de sa communauté d'Hudson, au Québec. Il s’est rapidement forgé une réputation de leader politique fort en siégeant au conseil municipal de Toronto et en assumant la fonction d'adjoint au maire. En 2003, il fit son entrée sur l’échiquier politique fédéral, en remplaçant Alexa McDonough comme chef du parti NPD. Au cours de sa carrière politique, M. Layton aura mis à l’avant scène plusieurs questions sociales importantes notamment la pauvreté, la violence faite les femmes, le sida et l'itinérance.
La nouvelle du décès de monsieur Layton s’est répandue rapidement et des témoignages de sympathie et de tristesse ont inondés les bulletins de nouvelles. La chef Intérimaire du NPD, Nycole Turmel, a exprimé sa peine en déclarant: «Les néo-démocrates ont perdu un grand Canadien. Jack était un homme courageux. Son leadership m'a inspiré, et il a inspiré aussi plusieurs autres politiciens. Nous devons – membres du Parlement, néo-démocrates et Canadiens – nous rassembler pour poursuivre son œuvre et faire de ce pays un monde meilleur. Nous nous souviendrons aussi des paroles de Tommy Douglas que Jack aimait citer dans chacun de ses courriels : « Courage mes amis, il n'est jamais trop tard pour bâtir un monde meilleur».
Les témoignages de sympathie sont venus de toutes parts. Voici quelques-unes des déclarations faites par les collègues de monsieur Layton:
«Au nom de tous les Canadiens, je salue la contribution de Jack à la vie publique, une contribution qui va beaucoup nous manquer. Je sais une chose: Jack a fait tout ce qu’il pouvait pour lutter contre le cancer. En effet, Jack n'a jamais reculé devant un combat. » - Le Premier ministre Stephen Harper
«À la salle du Conseil, Jack Layton, était un débatteur éloquent qui répondait aux besoins de tous les résidents de Toronto. Jack était un combattant et il va nous manquer sur la scène politique canadienne. Au nom des membres du conseil municipal de Toronto, j'offre mes plus sincères condoléances à la femme de Jack, Olivia, à son fils Mike qui siège au conseil, sa fille Sarah, ainsi qu’aux autres membre de sa famille. » - Le maire de Toronto, Rob Ford
«Au nom du Parti libéral du Canada, je tiens à exprimer nos sincères condoléances à la famille d'Olivia et Jack, ainsi qu’à ses collègues et amis du Nouveau Parti démocratique. Il laisse un héritage puissant axé sur la justice sociale .» - Le chef du Parti libéral, Bob Rae
Dans une lettre écrite quelques heures avant sa mort, monsieur Layton a partagé un dernier message aux Canadiens. Son approche politique, sa vie et son combat contre la maladie étaient teintés par les mêmes valeurs et émotions. «Mes amis, l'amour est cent fois meilleur que la haine. L'espoir est meilleur que la peur. L'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors aimons, gardons espoir et restons optimistes. Et nous changerons le monde. »
M. Layton a demandé à la député Nycole Turmel à demeurer la chef intérimaire du NPD jusqu'à ce qu'une ou un successeur(e) soit élu(e). Les Canadiens seront attentifs à la suite de l’histoire du NPD, une histoire où l’apport de Jack Layton est désormais incontestable.

 Le Parti social démocratique du Canada (PSDC) est fondé à Calgary pour répondre à la Grande Dépression. Le PSDC rassemble les forces progressistes, socialistes et travaillistes qui demandent des réformes économiques permettant d’atténuer les effets pervers de la dépression. Un an plus tard, J.S. Woodsworth devient le premier chef du parti.
Le Parti social démocratique du Canada (PSDC) est fondé à Calgary pour répondre à la Grande Dépression. Le PSDC rassemble les forces progressistes, socialistes et travaillistes qui demandent des réformes économiques permettant d’atténuer les effets pervers de la dépression. Un an plus tard, J.S. Woodsworth devient le premier chef du parti.
 Les Canadiens élisent sept députés du parti PSDC, ce qui représente 8,9% du suffrage exprimé. Tommy Douglas, le futur chef du parti et père de l’assurance maladie, remporte l'un de ces sièges.
Les Canadiens élisent sept députés du parti PSDC, ce qui représente 8,9% du suffrage exprimé. Tommy Douglas, le futur chef du parti et père de l’assurance maladie, remporte l'un de ces sièges.
 Le Nouveau Parti démocratique (NPD) est fondé à Ottawa sous la bannière sociale-démocrate. Le NPD naît grâce à l’union des forces du PSDC avec celles du Congrès du travail du Canada. Tommy Douglas devient le premier chef - un poste qu'il détiendra pendant 10 ans.
Le Nouveau Parti démocratique (NPD) est fondé à Ottawa sous la bannière sociale-démocrate. Le NPD naît grâce à l’union des forces du PSDC avec celles du Congrès du travail du Canada. Tommy Douglas devient le premier chef - un poste qu'il détiendra pendant 10 ans.
 Une faction de l'aile gauche, The Waffle, émerge au sein du caucus du NPD. Elle prône la nationalisation des industries canadiennes, le droit du Québec à l'autodétermination et l’émergence d’un mouvement ouvrier indépendant canadien. En 1972, elle se détache du parti NPD.
Une faction de l'aile gauche, The Waffle, émerge au sein du caucus du NPD. Elle prône la nationalisation des industries canadiennes, le droit du Québec à l'autodétermination et l’émergence d’un mouvement ouvrier indépendant canadien. En 1972, elle se détache du parti NPD.
 David Lewis devient chef du NPD et détient la balance du pouvoir dans le gouvernement minoritaire libéral de Pierre Trudeau. Lewis a de l’influence en forçant l’adoption de lois diverses, dont une loi sur les dépenses électorales, l’indexation des pensions de retraite, la création de Pétro-Canada et l'Agence d’examen de l’investissement étranger.
David Lewis devient chef du NPD et détient la balance du pouvoir dans le gouvernement minoritaire libéral de Pierre Trudeau. Lewis a de l’influence en forçant l’adoption de lois diverses, dont une loi sur les dépenses électorales, l’indexation des pensions de retraite, la création de Pétro-Canada et l'Agence d’examen de l’investissement étranger.
 Le NPD obtient 43 sièges à la Chambre des communes, un des plus haut nombre à ce jour.
Le NPD obtient 43 sièges à la Chambre des communes, un des plus haut nombre à ce jour.
 Au début des années 1990, l’appui au NPD chute et le parti obtient 9 sièges lors des élections.
Au début des années 1990, l’appui au NPD chute et le parti obtient 9 sièges lors des élections.
 Après les mauvais résultats de 1993, le parti s'engage dans une métamorphose. En 1995, après une convention nationale et un vote de parti, les membres élisent un nouveau chef, Alexa McDonough.
Après les mauvais résultats de 1993, le parti s'engage dans une métamorphose. En 1995, après une convention nationale et un vote de parti, les membres élisent un nouveau chef, Alexa McDonough.
 Dans un scrutin à l'échelle nationale directe, Jack Layton, ancien conseiller municipal de Toronto, devient le chef du NPD.
Dans un scrutin à l'échelle nationale directe, Jack Layton, ancien conseiller municipal de Toronto, devient le chef du NPD.
 Jack Layton mène le NPD à un résultat historique en obtenant 103 sièges à la Chambre des communes et en formant l'opposition officielle pour la première fois dans l'histoire du pays.
Jack Layton mène le NPD à un résultat historique en obtenant 103 sièges à la Chambre des communes et en formant l'opposition officielle pour la première fois dans l'histoire du pays.
À la découverte du canal de Lachine
Situé à Montréal, le canal de Lachine s'étend sur 14,5 kilomètres entre le Vieux-Port et le lac Saint-Louis. Bien plus qu’une voie navigable intérieure, le canal est aussi un parc urbain accessible qui surprend par sa riche histoire.
Tous les ans, depuis un quart de siècle, des millions de visiteurs s’approprient les rives du canal de Lachine. Que ce soit à pied, en vélo ou en bateau, ce canal a de quoi surprendre avec ses paysages saisissants et avec l’une des plus belles pistes polyvalentes de la ville.
Les activités et les aménagements au canal vous donnent l’occasion de découvrir l’histoire de ce lieu marquant de l’industrie et de la navigation, tout en profitant d’un cadre urbain unique.
Lecteur mp3 à la main, écouteurs ajustés et souliers bien attachés, vous voilà prêt à partir pour l’aventure Onde! Parcourez le canal en son et en musique et ressentez les différentes facettes du canal de Lachine, à travers la narration d'un personnage. Visitez le site Web de Parcs Canada pour connaître tous les détails de cette activité.
Expérience Explora
Explora propose six circuits géoréférencés pour découvrir les secrets du canal de Lachine : son histoire, celle des bâtiments et des gens qui ont été témoin de son évolution. Muni d’un mini appareil mobile prêté par Parcs Canada, tous les parcours qui sont proposés incluent des témoignages, des photos anciennes, des vidéos, et plus encore. Visitez le site Web de Parcs Canada pour connaître tous les détails concernant l'expérience Explora. Téléchargez Explora sur l'iTunes App Store
Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine
Pourquoi ne pas terminer votre aventure à la découverte du canal de Lachine en faisant un arrêt au lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine. Le site occupait une position stratégique sur la route des fourrures, en tant que point de départ et d'arrivée des expéditions de traite. Il s’agissait d’un important centre d'entreposage de fourrures et de marchandises de traite des marchands de Montréal.
Pour tout savoir à propos du canal de Lachine :
Visiter le site Web du lieu historique national du Canal-de-Lachine
Visiter le site Web du lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine
Patrimoine gourmand: une application de Parcs Canada

Application de Parcs Canada : Patrimoine gourmand © Parcs Canada
Hérisson du fort Georges... les noms des recettes constituent à eux seuls une bonne raison de télécharger cette application gratuite.
Avec ce projet, Parcs Canada fusionne les recettes du XVIIIe siècle avec la technologie du XXIe siècle. Patrimoine gourmand offre un voyage à travers la riche histoire culinaire du Canada.
Lancée en septembre 2011, l'application Patrimoine gourmand donne accès à plus de 60 recettes que vous pouvez chercher par ingrédient, par service, par menu, par époque ou encore par région. Ces recettes traditionnelles ont été testées et modifiées au besoin par les cordons-bleus de l'École d'hôtellerie et de tourisme du Collège Algonquin. Les mesures impériales et métriques sont fournies.
Patrimoine gourmand propose des recettes du passé comme :
• Soupe au mufle d’orignal de Marm Bailey,
• Hérisson du fort Georges,
• Soupe à la viande,
• Chaussons à la marmelade à l'orange
• Biscuits à la poudre à pâte,
• Gâteau de tante Lora,
• Pain des soldats français du XVIIIe siècle,
• Le gâteau aux fruits de la famille King,
• Marmelade d’oranges.
L’application vous permet de sauvegarder vos recettes préférées et créer des listes pratiques pour vos courses. Chaque recette est associée à une histoire. Vous pourrez impressionner vos invités en leur racontant l’histoire de ces plats appréciés par des Canadiens, parfois célèbres, appartenant à d’autres époques.
Patrimoine gourmand propose une délicieuse façon d'apprendre l'histoire culinaire canadienne. Cette application est gratuite et téléchargeable sur votreiPhone,iPod, Android et BlackBerry (BlackBerry à venir).
Le Projet mémoire : Alphonse Martel

Alphonse Martel (c) Le Projet mémoire
Écoutez Alphonse Martel raconter son expérience dans la guerre de Corée. Vous pourrez entendre d’autres histoires en visitant le Projet mémoire.
Transcription audio
D’abord pour commencer quand on est arrivé à Séoul (à l’automne de 1952, comme renfort au 1er Bataillon du Royal 22e Régiment), c’était tout bombardé. Mais moi je ne l’ai pas vu la ville parce que j’ai été là peut-être une heure, deux heures avec les autres personnes qui étaient avec moi. Et puis on s’est allé tout de suite avec le 1er Bataillon, on s’est en allé tout de suite dans les montagnes. On avait des camps de compagnie, nous autres, et on était tous placés dans différentes montagnes. C’est pour ça qu’on se reconnaît les gens, on n’était pas ensemble, mais on était ensemble, mais éloignés un peu. Pis les gens se tiennent ensemble. La compagnie A sont ensembles, la compagnie B sont ensembles, la compagnie C sont ensembles. Quand je suis arrivé en Corée moi, évidemment, étant le commis du major, bien moi, j’avais ma carabine, ma .303 avec moi (carabine britannique Lee-Enfield No. 4 Mk. 1 de calibre .303). J’avais ma dactylo aussi avec moi, parce que j’écrivais au dactylo.
Je montais tranquillement dans la montagne et on m’a dit : « Tu vas aller rester dans le même abri que le sergent-major Dussault. » (Herménégilde Dussault, un vétéran du régiment des Fusiliers Mont-Royal ayant participé au raid de Dieppe en août 1942) Parfait, je me suis en allé là. Le soir, quand est arrivé le temps pour souper, les premières heures qu’on était là, c’est certain que quand on est monté la première fois en général on faisait des blagues quand on était à Tokyo. Mais quand on était rendu là, on n’avait pas l’expérience de la guerre. On ne connaissait pas ça. Pis moi je me souviens que les Chinois nous bombardaient souvent. Ils nous envoyaient souvent des tirs de canon. Souvent à tous les jours. Plusieurs obus, peut-être quatre, cinq, 10 obus par jour, tout le temps. Je marquais dans ça, dans une espèce d’agenda. Je n’ai pas été souper ce soir-là parce que j’ai eu peur.
Quand je suis venu pour sortir de mon abri j’ai entendu « Chouuu !! » Pis là ça éclater ! Tabarnouche ! Qu'est-ce qui se passe icitte ? On n’avait pas cette expérience-là d’un obus qui éclate comme ça. Les gens qui étaient là depuis un certain nombre de mois m’avaient dit : « Martel, fais-toi en pas, quand tu l’entends, est déjà passé. » Vois-tu, c’est l’expérience qui commence à rentrer. Ça fait que quand il y a une autre qui passe, tu ne te garroches pas à terre, tu sais qu’elle ne te touchera pas. Elle est passée, ça va tellement vite, ça va tellement vite.
Ça, c’était le commencement. On commençait à avoir une certaine crainte. Il y a des fois, même après plusieurs semaines, il y a des soirs que ce n’était pas de combats épouvantables, mais il y en avait qui mourrait. Comme nous autres, dans notre bataillon, il y en a eu 100 dans les trois bataillons là. On a eu 115 personnes (soldats du Royal 22e Régiment tués pendant la Guerre de Corée). C’est beaucoup de monde ça, c’est beaucoup de monde. Pis moi, dans mon propre bataillon, dans le 1, il y en a eu une quarantaine. C’est certain que quand on a des amis qui meurent comme ça, où on dit : « À quelle place qu’est untel ? » « Ah ben! T’as pas entendu parler ? Comment ça ? « Il dit : « Il s’est fait tuer hier. »
Il y avait des escarmouches qui se faisaient, il y avait des patrouilles. On allait faire des patrouilles. Pis des fois, étant donné que c’était relativement tranquille, à une certaine période, quand on revient d’une patrouille on est plus... On se laisse aller un peu. Mais ils ne sont pas fous les Chinois. Ils nous attendaient eux autres. Il y en a plusieurs qui se sont fait prendre. Qui se sont fait prendre prisonniers, se sont fait blesser, se sont fait tuer. Parce qu’en revenant ils n’étaient pas sur leurs gardes. Mais c’est parce que les Chinois les avaient laissés passer dans le chemin qu’ils avaient dirigé avec le sergent. Généralement, c’était un sergent ou un lieutenant des fois. Fais que ç’a été comme ça tout le temps. Il y avait toujours de petites escarmouches comme ça.
Notre devoir, même moi si j’étais un commis de bureau, mon devoir, moi, pour aider, c’était de temps en temps, comme sur l’heure du dîner, mon officier me demandait : « Tu vas aller dans le poste d’observation en avant, pis quand tu vas entendre des tirs qui vont sur nous autres, arrange-toi pour savoir, pour prendre la mesure de ça pour savoir approximativement d’où ça vient ça. » Moi je donnais ces commandes-là à mon major. On avait un char d’assaut nous autres, à côté de nous autres. Fais que lui avec ses mappes pis tout ça il a été capable d’aller chercher l’obus. On regardait dans nos lunettes, pis quand on les voyait, parce qu’on les voyait des fois les Chinois, on n’était pas loin, on n’était pas trop loin. Les premiers mois quand on est arrivé c’était drôle ça. Probablement que c’était une tactique de l’armée. L’ennemi était loin de nous autres. Quand je dis loin c’est plus qu’ah, je ne sais pas moi, plusieurs mille pieds. Certain, certain. Parce que ça allait comme ça. Pis à mesure qu’on avançait sur le front, on était toujours de plus en plus proche. Comme la 355 (la colline 355, près du 38e parallèle, un lieu de violents affrontements), tu pouvais quasiment voir les yeux du gars l’autre bord de la montagne. C’est certain, tu restes là moins longtemps, premièrement parce que c’est trop dangereux. Pis évidemment tu recules. Parce que ce qu’on faisait, on restait quelques semaines, dépendamment de l’importance du poste à observer, pis on nous retournait en arrière pour se reposer un peu. Pis on continuait notre entraînement pareil.
Mais moi mon entraînement c’était dans le bureau. Je n’allais pas toujours avec les gars, je n’avais pas le même entraînement que les autres personnes. Je n’en avais pas de besoin non plus. Je n’étais pas un soldat qui s’en allait. J’en avais des grenades après moi pis tout ça, mais c’était en cas de défense, au cas de s’il y avait eu quelque chose. Fais qu’en gros c’est ça qui s’est passé sur le front. C’était comme ça, tout le temps. À aller jusqu'à la fin de juin, la fin de juillet (1953). Même à la fin de juillet, quand ils ont signé, pas l’armistice, mais un traité de paix, quelques jours avant on recevait encore des bombes.
Pis durant la journée, ça arrivait souvent quand on était là, l’aviation australienne et américaine venait bombarder les places en avant de nous autres. Pis les gros bombardiers laissaient tomber des bombes de napalm. Des grosses bombes, c’est comme de la gélatine ça. Ça rentrait dans les tranchées et le feu prenait là-dedans. Ben ok, c’était une façon de…. Nous autres on n’a jamais vu d’aviation ennemie, ils n’avaient pas d’aviation eux autres. Pour moi, ils n’étaient pas capables de se rendre ici. Il devait avoir des batailles qui se faisaient, mais dans les airs, mais plus loin.
(Fin de l'enregistrement)
October 16, 2011
Transcriptionist: Alexandre Racine
Des voix unies pour l’espoir
Dans l’édition février-mars du magazine Histoire Canada, Heath McCoy publie un article intitulé Rocking the World qui porte sur l’apport des artistes canadiens en ce qui a trait à l’aide humanitaire à l’étranger.
En complément à cet article, nous vous proposons quelques moments marquants en images.
Famine en Éthiopie - 1984-1985
Le projet collectif musical Les Yeux de la faim a vu le jour en 1985 par l’intermédiaire de la Fondation Québec-Afrique. La chanson écrite par le journaliste Gil Courtemanche et composée par Jean Robitaille connut beaucoup de succès dans la francophonie canadienne. Plusieurs artistes québécois ont participé à ce projet visant à venir en aide aux enfants touchés par la famine en Éthiopie. Visionnez la vidéo créée pour cette chanson.
Ensemble pour Haïti - 2010
Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre d’une haute magnitude frappa Haïti. Le bilan fut désastreux. On recensa 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de sans-abris.
Par solidarité avec le peuple d’Haïti, le Réseau TVA, la Société Radio-Canada, Télé-Québec, V Télé, LCN, Musique Plus et MusiMax, TV5, Espace Musique, Astral Média Radio, Bold et les stations de Corus Québec se sont unies afin de présenter un spectacle bénéfice pour venir en aide aux sinistrés.Au total, avec le téléthon des artistes anglophones diffusé dans le reste du pays, la soirée a permis d'amasser 16 millions $.
Pendant deux heures et demie en direct, une cinquantaine d'artistes du Québec se sont unis pour Haïti. Voyez ou revoyez le numéro d’ouverture avec Marie-Josée Lord, Luce Dufault, Patsy Gallant, Martine St-Clair, Judith Bérard interprétant Le monde est stone de Luc Plamondon et Michel Berger.
Unis pour l’action (We Day) – 2007 à aujourd’hui
Unis pour l’action est un événement unique associé à un programme éducatif innovateur visant à célébrer le pouvoir des jeunes à créer des changements positifs dans le monde.
Depuis 2007, des jeunes Canadiens se sont rassemblés pour explorer leur passion commune pour l’engagement social. Unis pour l’action inspire à la fois élèves et enseignants grâce à des présentations d’artistes influents et de conférenciers passionnés en provenance des quatre coins du monde.
Les participants aux évènements Unis pour l’action ont notamment pu voir des discours de Sa Sainteté le dalaï lama, de la Dre. Jane Goodall, du lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire, de l’activiste Robert Kennedy Jr, ainsi que des performances des Jonas Brothers, de Justin Bieber, Sarah McLachlan et Simple Plan.
À ce jour, Unis pour l’action a rassemblé plus de 50 000 jeunes. Enfants Entraide compte plus d’un million de jeunes membres qui se sont impliqués dans les programmes éducatifs et de développement dans plus de 45 pays.
Reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale

Lester B. Pearson présidant l'un des comités à la Conférence des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture, Québec, 1945. Credit: Office national du film du Canada. Photothèque / Bibliothèque et Archives Canada / PA-117587
Dans l’édition février-mars du magazine Histoire Canada, Susan Armstrong-Reid et David Murray proposent un article intitulé Soldat de la paix. Celui-ci porte sur le rôle essentiel joué par le Canada lors de la reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale.
En complément à cet article, nous vous proposons le visionnement de quatre documentaires produits par l’Office national du film du Canada. Pendant la guerre, l’ONF tourne des centaines de films qui témoignent de multiples contributions du Canada dans tous les secteurs d’activités et sur tous les fronts. Les documentaristes, parmi les meilleurs au monde, ont aussi observé à travers leur lentille les défis entourant la reconstruction de l’Europe après la guerre.
Un retour vers le passé comme si vous y étiez...
Office national du film du Canada
1945, 20 minutes 40 secondes
Documentaire unique sur la création de la Société des nations. Réalisé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce film témoigne des diverses mesures prises pour conduire le monde à une paix plus durable. Sont mentionnées la conférence de l'UNRRA, organisation visant à aider les pays occupés, la conférence de Bretton-Woods, où l'on créa le Fonds monétaire international et la Banque internationale de reconstruction et de développement, et finalement, celles de Dumbarton Oaks et de San Francisco, qui ont mené à l'adoption de la Charte des Nations Unies.
Office national du film du Canada
Stuart Legg, 1945, 12 minutes 37 secondes
Court métrage documentaire réalisé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur la pénurie de vivres et la famine en Europe. Les grandes villes sont victimes du manque de moyens de transport et les régions agricoles ne suffisent plus à nourrir leur pays. Le Canada et les États-Unis viendront en aide aux affamés d’outre-mer et l’effort humanitaire sera à la hauteur de l’effort militaire pour l’édification d’une nouvelle Europe.
Office national du film du Canada
Sydney Newman, 1945, 10 minutes 29 secondes
Court métrage documentaire explorant les conséquences désastreuses de la Seconde Guerre mondiale sur 60 millions d’enfants. Après des années d’occupation nazie, les enfants, malades et affamés, seront livrés à la dure réalité de la lutte pour la vie, la famine et la tuberculose sévissant en Europe. Le Canada, les États-Unis et certains pays d’Europe moins démunis, apporteront leur secours.
Office national du film du Canada
1943,19 minutes 49 secondes
Court métrage documentaire sur le potentiel des richesses naturelles de l'Amérique et sa contribution économique auprès de l'Europe d'après-guerre.
William Clark : Survivre aux naufrages du Titanic et de l’Empress of Ireland

Monsieur Albéric Gallant, animateur au Site historique maritime national de la Pointe-au-Père, dans la peau de William Clark
Dans l’édition avril-mai du magazine Canada’s History, Paul Butler propose un article intitulé « Have Struck Iceberg » portant sur le naufrage du Titanic en 1912.
En complément à cet article, nous vous proposons une baladodiffusion réalisée avec monsieur Albéric Gallant, animateur au Site historique maritime national de la Pointe-au-Père. Monsieur Gallant partage avec nous l’histoire incroyable de William Clark, un pelleteur de charbon, qui survécut à la fois au naufrage du Titanic et à celui de l’Empress of Ireland deux ans plus tard. Il reviendra aussi sur les faits saillants de ces deux grandes tragédies maritimes.
Écoutez l’intégralité de l’entrevue accordée par Albéric Gallant à Histoire Canada (durée 17 minutes, 42 secondes).
Site historique maritime de la Pointe-au-Père
1000, rue du Phare
Rimouski (Québec)
Canada G5M 1L8
Téléphone : 418 724-6214
Télécopieur : 418 721-0815
Courriel : info@shmp.qc.ca
Accès :
Route 132
ou Sortie 621 de l'autoroute 20
Brochure du musée - 2012
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir au sujet de 1812 sans jamais oser le demander

Dans l’édition avril-mai du magazine Canada’s History, Chris Raible propose un article intitulé Fighting Words faisant référence à la Guerre de 1812.
En complément à cet article, nous vous proposons une baladodiffusion réalisée avec monsieur Luc Lépine, auteur et historien militaire. Il nous met en contexte cette guerre oubliée, en nous présentant les faits saillants et en prenant soin de bien expliquer les tenants et aboutissants de ce conflit.
Écoutez l’intégralité de l’entrevue accordée par Luc Lépine à Histoire Canada (durée 12 minutes, 37 secondes).
Les sugestions de Luc Lépine :
Lecture:
Michelle Guitard – Histoire sociale des miliciens de la bataille de la Châuteauguay
Stanley, George F.G. -- La guerre de 1812 : les opérations terrestres. -- Traduit par Marguerite MacDonald. -- [Montréal] : Éditions du Trécarré en collaboration avec le Musée national de l'Homme, Musées nationaux du Canada, c1984. -- 489 p. -- (Musée canadien de la guerre, publication d'histoire militaire, no 18). -- Publié aussi en anglais sous le titre : The War of 1812 : land operations
À venir à l'automne 2012:
Un ouvrage de Luc Lépine aux Presses de l'Université Laval.
Toujours par Luc Lépine, publication des lettres d’amour de Maurice Nolan et son épouse Agathe Perrault
Les lieux historiques nationaux
Lieu historique national de la Bataille-de-la-Châteauguay
Lieu historique national du Canada du Fort-George
Lieu historique national du Canada du Fort-Malden
Lieu historique national du Canada Fort-St. Joseph
Lieu historique national du Canada Fort-Wellington
Lieu historique national du Canada des Hauteurs-de-Queenston
1812 : L’envers de la médaille — Tecumseh, un héros oublié

Mort du Chef Tecumseh. Nathaniel Currier,1846. Crédit: Bibliothèque et Archives Canada, no d'acc 1970-188-1431 Collection de Canadiana W.H. Coverdale
Le 1er août 2009, Serge Bouchard nous proposait l’histoire de Tecumseh, un héros de la guerre de 1812, lors de son émission De remarquables oubliés à la radio de Radio-Canada. En deuxième heure, Alain Beaulieu, professeur d'histoire à l'UQAM, était invité à commenter cette histoire et à répondre aux questions des auditeurs.
De remarquables oubliés / Radio-Canada - 1er août 2009
Première partie – 54 minutes
Deuxième partie – 53 minutes
360 secondes pour comprendre 1812 avec Jacques Lacoursière
 Le 18 juin dernier, le ministre du Patrimoine James Moore lançait officiellement les commémorations de la guerre de 1812. Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce conflit, le journaliste Sébastien Bovet s’est entretenu avec l’historien Jacques Lacoursière lors de l’émission 24 heures en 60 minutes présentée au réseau de l’information de Radio-Canada.
Le 18 juin dernier, le ministre du Patrimoine James Moore lançait officiellement les commémorations de la guerre de 1812. Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce conflit, le journaliste Sébastien Bovet s’est entretenu avec l’historien Jacques Lacoursière lors de l’émission 24 heures en 60 minutes présentée au réseau de l’information de Radio-Canada.
Visionner l’entrevue accordée par Jacques Lacoursière à Radio-Canada le 19 juin 2012 (durée 5 minutes, 42 secondes).
Regard des historiens francophones sur les commémorations de 1812
 Lors d’une émission spéciale présentée à CPAC et intitulée Guerre 1812-1814: perspective francophone, la journaliste Danielle Young a rencontré quelques historiens afin de faire la lumière sur l’importance que l’on doit accorder à la commémoration de la guerre de 1812.
Lors d’une émission spéciale présentée à CPAC et intitulée Guerre 1812-1814: perspective francophone, la journaliste Danielle Young a rencontré quelques historiens afin de faire la lumière sur l’importance que l’on doit accorder à la commémoration de la guerre de 1812.
Principales questions soulevées :
-
Est-ce que la guerre de 1812 a réellement contribué à définir le Canada tel qu’il est aujourd’hui?
-
Est-ce que le conflit a créé une identité et un sentiment d’unité nationale?
-
Est-ce que cette guerre a permis de protéger le fait français?
-
Qu’elle est l’importance de l’invasion américaine de 1812 dans l’histoire du Canada et pour les francophones?
Visionner l’émission spéciale Guerre 1812-1814: perspective francophone présentée à CPAC le 20 juillet 2012 (durée 27minutes).
Canada et URSS : 1972 – Série du siècle

Photo: David Portigal / Bibliothèque et Archives Canada, MIKAN 4365527
Le 28 septembre 1972, des milliers de Canadiens étaient rivés à leur petit écran ou encore l’oreille collée à leur radio afin d’être témoin d’un des moments les plus importants de l’histoire du sport canadien, soit le match décisif qui opposait le Canada à l’Union Soviétique lors de la Série du siècle.
Afin de souligner le 40e anniversaire de cette célèbre série, Histoire Canada vous propose, en complément de l’article écrit par Bruce Dowbiggin dans le magazine d’août/septembre 2012, un dossier créé par le Musée virtuel du Canada.
Visiter l’exposition proposée par le Musée virtuel du Canada
John A. Macdonald sous toutes les formes

Crédit: Notman Studio/Bibliothèque et Archives Canada/C-010144
Janvier 2015 coïncidera avec 200e anniversaire de la naissance de Sir John A. Macdonald. Dans le numéro de décembre/janvier du magazine Canada’s History, l'historien Yves Pelletier propose un article intitulé Soberly Celebrating Sir John. Pelletier montrant les malaises à commémorer certains legs de ce père de la Confédération canadienne.
En complément à cet article, nous vous proposons de parcourir l’exposition virtuelle Sir John A. Macdonald : homme d'État canadien et patriote préparée par des spécialistes de Bibliothèque et Archives Canada.
Au programme, vous parcourrez les faits saillants de la vie de Macdonald, vous découvrirez une riche collection de documents et vous aurez accès à des ressources pédagogiques inspirantes.
Visiter l’exposition virtuelle Sir John A. Macdonald : homme d'État canadien et patriote .

Sur les traces de Macdonald
Janvier 2015 coïncidera avec 200e anniversaire de la naissance de Sir John A. Macdonald. Dans le numéro de décembre/janvier du magazine Canada’s History, l'historien Yves Pelletier propose un article intitulé Soberly Celebrating Sir John. Pelletier montrant les malaises à commémorer certains legs de ce père de la Confédération canadienne.
En complément à cet article, nous vous proposons de faire un retour dans le temps et de fouler les pas de Macdonald. Pourquoi ne pas découvrir l’histoire de vie du politicien en en visitant quelques lieux historiques nationaux de Parcs Canada.
 Lieu historique national du Canada de la Villa-Bellevue
Lieu historique national du Canada de la Villa-Bellevue
La maison et les jardins, animés par des interprètes en costume d'époque, ont été restaurés au goût des années 1840, en bonne partie tels qu'ils étaient lorsque Macdonald, sa femme et leur jeune fils y habitaient.
35, rue Centre Kingston (Ontario) K7L 4E5
 Lieu historique national du Canada Earnscliffe
Lieu historique national du Canada Earnscliffe
Cette maison, construite dans les années 1855-57 par John MacKinnon, fut occupée par Sir John en 1870-71 et en 1882; il l'acheta en 1883 et y vécut jusqu'à sa mort, le 6 juin 1891. Earnscliffe sert aujourd’hui de résidence au haut-commissaire britannique au Canada.
140, promenade Sussex, Ottawa, Ontario

Lieu historique national du Canada du Lieu-de-Sépulture-de-sir John A. Macdonald
Le lieu de sépulture de sir John A. Macdonald a été désigné lieu historique national du Canada en 1938 parce qu’il fut l’un des Pères de la Confédération et la première personne à occuper le poste de premier ministre du Canada.
Cimetière Cataraqui, 927, chemin Purdy Mills, Kingston, Ontario
Crédit photo: Parcs Canada
Abri antinucléaire à domicile
Dans l’édition décembre-janvier du magazine Canada’s History, Andrew Burtch propose un article intitulé Gimme Shelter. Il porte sur les mesures mises en place par le Gourvernement canadien afin de protéger la population civile lors d’éventuelles attaques nucléaires à l’époque de la Guerre froide. Shelter s’est intéressé entre autres aux exercices de simulation d’attaques que l’on proposait aux Canadiens et aux abris antinucléaires à domicile.
En complément à cet article, nous vous proposons le visionnement d’archives vidéo de la Société Radio-Canada que nous avons rassemblées pour vous.
 Voir le reportage Climat de psychose
Voir le reportage Climat de psychose
Émission Premier Plan, Radio-Canada, 10 octobre 1961 (9 min 51 s)
 Voir le reportage Organisation des mesures d’urgence
Voir le reportage Organisation des mesures d’urgence
Émission Mesures d’urgence, Radio-Canada, 13 novembre 1961 (18 min 39s)
 Voir le reportage L’abri antiatomique de Mme Feltus
Voir le reportage L’abri antiatomique de Mme Feltus
Émission Aujourd’hui, Radio-Canada, 10 mars 1965 (9 min 46 s)
 Voir le reportage Abri antinucléaire à domicile
Voir le reportage Abri antinucléaire à domicile
Émission Le 60, Radio-Canada, 18 mars 1975 (3 min 24 s)
 Voir le reportage Le « Pont » de Valcartier
Voir le reportage Le « Pont » de Valcartier
Émission Le 60, Radio-Canada, 18 mars 1975 (52s)
 Voir le reportage Le Diefenbunker
Voir le reportage Le Diefenbunker
Émission Téléjournal, Radio-Canada, 10 août 1997 (3 min 04s)
Joseph-Elzéar Bernier – Cap vers le Grand Nord

Prise de possession de la terre de Baffin, 9 Nov. 1906 / Credit: Bibliothèque et Archives Canada / PA-165672
Dans l’édition de décembre-janvier du magazine Canada’s History, John English publie un article intitulé Arctic Ambitions portant sur les tenants et aboutissants de la création du Conseil de l’Arctique. En complément, nous vous proposons un dossier complet portant sur le capitaine Joseph-Elzéar Bernier, une figure marquante de l’histoire du Grand Nord. Grâce aux expéditions de ce grand explorateur, le Canada a pu imposer sa souveraineté sur de vastes étendues au-delà du 66e parallèle.
Joseph-Elzéar Bernier est né à L’Islet au Québec en 1852. Déjà à sept ans, il accompagnait son père sur le pont des bateaux. À l’âge de 17 ans, devenu capitaine de son propre bateau, il faisait des allers-retours entre le Québec et l’Angleterre pour transporter du bois. Après 25 ans sur les eaux, il fit une pause de ses voyages outre-Atlantique afin de devenir pendant quelques années gouverneur de la prison de Québec.
De 1904 à 1911, à bord d’un bateau appartenant au gouvernement, il dirigea des expéditions vers l'Arctique de l'Est. En 1909, au nom du Canada, il revendiqua l'archipel de l'Arctique. Il installa une plaque sur l'île Melville afin d’officialiser le tout. Après 1911, il entreprit plusieurs expéditions, personnelles cette fois, dans le Grand Nord.
Le capitaine Bernier fut aux commandes d’une centaine de navires au cours de sa carrière. Il connaissait l’Arctique comme personne d’autre et on lui doit quelques-uns des plus importants rapports d’expédition portant sur ce territoire.
Le capitaine Joseph-Elzéar Bernier est mort à Lévis, au Québec, en 1934.
Pour en savoir plus :
Musée maritime du Québec – Musée maritime Bernier
Le Musée perpétue le souvenir du capitaine Bernier par l’appellation de son édifice principal le Pavillon J.-E.-Bernier. Une exposition permanente intitulée Capitaine Joseph-Elzéar Bernier 1852-1934 est consacrée au navigateur.
Pour s’y rendre :
Musée maritime du Québec
55, chemin des Pionniers Est,
L'Islet (Québec), Canada,
G0R 2B0
(418) 247-5001
Musée virtuel du Canada et Musée maritime du Québec
 Exposition virtuelle : Ilititaa... Bernier, ses hommes et les Inuits
Exposition virtuelle : Ilititaa... Bernier, ses hommes et les Inuits
Découvrez la dure réalité des aventures du plus célèbre explorateur canadien-français de l'Arctique. Des récits audio, des photos et des extraits de journaux de bord passionnants vous donneront un bon aperçu de ce pan d'histoire du Canada.
Télévision
 Série documentaire Histoires oubliées – Émission 38- Kapitai-Kallak, J.E. Bernier
Série documentaire Histoires oubliées – Émission 38- Kapitai-Kallak, J.E. Bernier
Les Productions Vic Pelletier inc.
Histoires oubliées est une série documentaire qui s'inspire de faits authentiques, d'événements marquants gravés dans notre mémoire collective.
 Série documentaire Terres arctiques
Série documentaire Terres arctiques
Producteurs Vic Pelletier et Sam De Champlain
Terres arctiques est une série documentaire de 10 épisodes sur les enjeux politiques qui se jouent au-delà du 66e parallèle. Une vaste section est consacré à la vie de Joseph-Elzéar Bernier.
Radio
 De remarquables oubliés – Radio-Canada – 21 août 2006 (rediffusion le 26 juillet 2008)
De remarquables oubliés – Radio-Canada – 21 août 2006 (rediffusion le 26 juillet 2008)
Le 21 août 2006, Serge Bouchard nous proposait l’histoire de Joseph-Elzéar Bernier, lors de son émission De remarquables oubliés à la radio de Radio-Canada. En deuxième heure, Marjolaine Saint-Pierre, auteure de Joseph-Elzéar Bernier : Capitaine et coureur des mers, était invitée à commenter cette histoire et à répondre aux questions des auditeurs.
Écouter l’histoire de Joseph-Elzéar Bernier (54 min 59 sec)
Écouter la tribune téléphonique de l’épisode sur Joseph-Elzéar Bernier du 21 août 2006 (54 min 59 sec)
Lecture
 Marjolaine Saint-Pierre. Joseph-Elzéar Bernier : Capitaine et coureur des mers. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2005. 376 pages.
Marjolaine Saint-Pierre. Joseph-Elzéar Bernier : Capitaine et coureur des mers. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2005. 376 pages.
Acheter en ligne chez Septentrion
Mon musée d'histoire : Votre opinion
 Le plus célèbre musée national canadien subira une importante métamorphose impliquant à la fois un changement de nom, mais aussi un resserrement de sa mission qui sera dorénavant axée davantage autour de l’histoire canadienne.
Le plus célèbre musée national canadien subira une importante métamorphose impliquant à la fois un changement de nom, mais aussi un resserrement de sa mission qui sera dorénavant axée davantage autour de l’histoire canadienne.
Dans l’édition de décembre 2012 / janvier 2013 du magazine Canada’s History, nous mentionnions que le nouveau Musée canadien de l’histoire invitait les Canadiens, en novembre et en décembre, à participer aux consultations publiques ayant pour but de déterminer les histoires importantes à mettre en lumière dans ce nouveau musée.
Réservez dès maintenant votre place pour ces consultations en visitant le site Web Mon musée d’histoire. Attention, prenez soin de faire défiler le texte vers le bas pour trouver le formulaire.
Dans le cas où il serait impossible pour vous d’assister aux consultations, vous pouvez en quelques clics compléter un sondage en ligne.
Pour en savoir plus sur l'histoire du musée, vous pouvez lire le plus récent mot de notre présidente , ou encore prendre connaissance des deux lignes du temps consacrées soit à l’histoire du Musée canadien des civilisations ou soit à celle du Musée canadien de la guerre.
Baladodiffusion: Musée du Quai 21 – Trouver sa place
Baladodiffusion : Musée canadien de l’immigration du Quai 21 – Trouver sa place
Jusqu’au 30 mars prochain, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21 présente une nouvelle exposition de photos intitulée Trouver sa place / Réflexions sur l’identité afro-canadienne : Photographies de la Wedge Collection.
Pour en apprendre davantage sur l'exposition, Histoire Canada s’est entretenue avec Kristine Kovacevic, gestionnaire des services aux visiteurs au Musée du Quai 21. Madame Kovacevic nous parle de la collection de photos et explique comment l’utilisation des arts visuels peut améliorer notre compréhension de l'histoire et de l'identité. Elle nous parle également de la programmation spéciale préparée par le musée dans le cadre de l'exposition. Au programme : tables rondes, projections de films et séance de lecture publique avec dédicaces en compagnie de l'auteur primé Lawrence Hill.
Visitez Quai21.ca pour en savoir plus sur l'exposition et pour confirmer votre présence à certains événements spéciaux gratuits.



Revisiter le bed-in peut être contagieux
Dans l’édition avril-mai du magazine Canada’s History, le rédacteur en chef Mark Reid propose un article intitulé Come Together portant sur le bed-in de John Lennon et Yoko Ono à l’hôtel Le Reine Elizabeth de Montréal en 1969. Il s’est particulièrement intéressé à l’histoire d’un jeune photographe alors âgé de 18 ans, Roy Kerwood, qui a vécu de près le bed-in avec le l’icône de la musique pop et sa femme.
En complément à cet article, nous vous proposons le visionnement d’une archive vidéo de l’enregistrement de la chanson Give Peace a Chance enregistrée à l’intérieur de la désormais célèbre chambre 1742 de l’hôtel Le Reine Elizabeth lors du bed-in.
De plus, ce retour en arrière dans l’univers des Beatles semble avoir été très inspirant pour le rédacteur en chef qui a regroupé les membres de l’équipe de la Société Histoire Canada pour un hommage bien particulier...
Avertissement — le visionnement de ces vidéos pourrait vous donner une folle envie, vous aussi, d'organiser un bed-in. Nous préférons vous en aviser.
Bon visionnement!
Enregistrement de la chanson Give Peace a Chance lors du ben-in de John Lennon et Yoko Ono. 1er juin 1969. Hôtel Le Reine Elizabeth (durée 6 minutes 7 secondes)
Hommage au bed-in de John et Yoko par l'équipe de la Société Histoire Canada (2 minutes 37 secondes).
L'héritage de John et Yoko pour la paix

Archives Radio-Canada
Dans l’édition avril-mai du magazine Canada’s History, le rédacteur en chef Mark Reid propose un article intitulé Come Together portant sur le bed-in de John Lennon et Yoko Ono à l’hôtel Le Reine Elizabeth de Montréal en 1969. Il s’est particulièrement intéressé à l’histoire d’un jeune photographe alors âgé de 18 ans, Roy Kerwood, qui a vécu de près le bed-in avec le l’icône de la musique pop et sa femme.
En complément à cet article, nous vous proposons l’écoute d’un reportage réalisé dans le cadre de l’émission Maisonneuve en direct diffusée sur les ondes de la radio de la Société Radio-Canada le 26 mai 2009. Au menu, Pierre Maisonneuve fait un retour sur le bed-in de John et Yoko avec entre autres le journaliste Gilles Gougeon et l’ex-ambassadeur du Canada à l’ONU, Yves Fortier.
Écouter Les 40 ans du bed-in de John et Yoko, Société Radio-Canada, 26 mai 2009 (durée 19 minutes 54 secondes)
Une semaine avec John Lennon et Yoko Ono
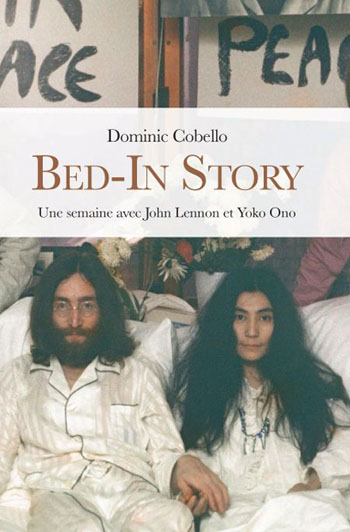
Dominic Cobello. Bed-In Story. Une semaine avec John Lennon et Yoko Ono. Montréal, Éditions Hurtubise, 2008. 208 pages.
Résumé : Bed-in Story raconte, tel que vécu par Dominic Cobello, la semaine qu’il a passée en compagnie de John Lennon et Yoko Ono, dans la chambre 1742 de l’Hôtel Reine Elisabeth, au printemps 1969, lors du bed-in historique du célèbre couple. Sitôt ces derniers débarqués à Dorval, l’auteur s’affirme comme l’un des maîtres d’oeuvre du bed-in et assiste nuit et jour les deux artistes. Quarante ans plus tard, il nous fait pénétrer dans l’intimité de John Lennon et dans les coulisses de l’un des événements mythiques des années 1960, improvisé dans une atmosphère bon enfant et buissonnière qu’on n’oserait imaginer aujourd’hui…
L’auteur retrace les carrières respectives de John Lennon et de Yoko Ono, la genèse du bed-in, et nous présente certains des témoins importants de cette semaine inoubliable qui a fait de Montréal, pendant quelques jours, le point de mire du monde entier, et de la suite 1742 du Reine Elisabeth un lieu mythique. À signaler la participation exceptionnelle de Yoko Ono au livre, par le biais d’une entrevue spécialement accordée à l’auteur dans le cadre de ce livre.
Acheter chez Renaud Bray
Petit Louis devint grand

Louis Robichaud, premier francophone à devenir premier ministre du Nouveau-Brunswick, était de petite stature physiquement, mais passa à l’histoire pour la grandeur de ses réformes qui changèrent assurément la vie des Néo-Brunswickois.
L’accession au pouvoir de Robichaud en 1960 transforma profondément la province. Sa venue signifiait entre autres pour les francophones du Nouveau-Brunswick qu'ils ne seraient plus des citoyens de seconde classe. La bataille ne fut pas facile pour Robichaud. Des forces des milieux des affaires et des médias n’allèrent pas rendre ses réformes faciles.
Dans l’édition juin-juillet du magazine Canada’s History, l’auteur et journaliste Jacques Poitras propose un article intitulé Nasty Work in New Brunswick qui porte sur les luttes de Robichaud avec quelques-uns des touts puissants de sa province. Histoire Canada a réalisé une entrevue avec l’auteur.
Écoutez l’intégralité de l’entrevue accordée par Jacques Poitras à Histoire Canada (durée 12 minutes, 10 secondes).
La renaissance du Bluenose

Crédit: W.R. MacAskill/Bibliothèque et Archives Canada/PA-030803
La une de l’édition juin-juillet du magazine Canada’s History est consacrée au Bluenose II, un symbole cher aux Canadiens. La légendaire goélette, rendue célèbre entre autres grâce à sa présence sur la pièce de 10 cents, a une histoire riche qui mérite qu’on s’y attarde. C’est ce que Dean Jobb a fait dans un article intitulé Bluenose II Reborne.
En complément à cet article, nous vous proposons de parcourir une exposition virtuelle réalisée par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse avec l’aide de Patrimoine Canadien, du Fisheries Museum of the Atlantic et du Maritime Musuem of the Atlantic. Vous y découvrirez près de 100 ans d’histoire par l’entremise de récits, de photos anciennes, de découpures de presse et d'images vidéo.
Visiter l’exposition virtuelle Le Bluenose, symbole canadien
Comme second complément à cet article, nous vous invitons à prendre quelques minutes afin de visionner un reportage vidéo préparé en 1984 par le journaliste Jean Pagé et qui raconte l’histoire de la goélette mythique.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada. Émission : Québec cet été. Date de diffusion : 27 juin 1984. Durée : 3 minutes et 41 secondes.
VISIONNER LE REPORTAGE
La valeureuse Laura

Le Monument aux Valeureux - Laura Secord, U.E. Guerre de 1812 (1812-1814), Commission de la capitale nationale.
Dans l’édition août-septembre du magazine Canada’s History, l’auteure et historienne Dianne Graves propose un article intitulé Women of Valour. Madame Graves présente quelques-unes des figures emblématiques féminines de la guerre de 1812, des figures souvent oubliées.
En complément à cet article, nous vous proposons de faire la connaissance avec l'une de ces héroïnes féminines. Le nom de Laura Secord vous semblera sans doute familier, mais est-ce pour les bonnes raisons? Le temps de quelques minutes, nous vous invitons à mettre de côté vos envies chocolatées pour découvrir l’histoire peu banale de la véritable Laura Secord.
Pour ce faire, nous vous proposons deux capsules audio préparées par la Commission de la capitale nationale dans le cadre de son projet Décod’ART. La première s’adresse aux enfants alors que la seconde est destinée aux adultes. En plus d’explorer l’histoire de Laura Secord, vous entrerez dans l’univers de l’artiste Marlene Hilton Moore. C'est elle qui immortalisa dans le bronze la légendaire femme en 2006. Nous espérons qu'une écoute attentive vous permettra d’apprécier davantage le Monument aux Valeureux lors de votre prochain passage à Ottawa.
Pour écouter la capsule destinée aux enfants:
Pour écouter la capsule destinée aux adultes:
Pour en savoir plus
Pour en savoir un peu plus sur Laura Secord, pourquoi ne planifierez-vous pas un retour aux sources en visitant sa maison à Queenston en Ontario?
Maison ancestrale Laura Secord
29, Queenston Street
Queenston, Ontario
(905) 262-4851
Enfin, pour connaître tous les détails au sujet de la vie de Laura Secord, nous vous invitons à parcourir l’article de Ruth McKenzie publié dans le Dictionnaire biographique du Canada.
Victor Brodeur – Officier de la Marine canadienne (1909-1946)
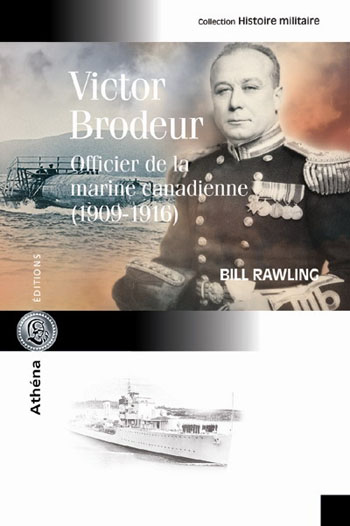
Dans l’édition août-septembre du magazine Canada’s History, Mark Reynolds propose un article intitulé Canada invades El Salvador! Dans son récit, Raynolds accorde une grande importance aux actions de l’Officier de la marine Victor Brodeur. Celui-ci fut le premier haut gradé de la Marine royale canadienne. En complément à cet article, nous vous proposons de parcourir une biographie écrite par l'historien Bill Rawling et portant sur l’officier Brodeur.
Bill Rawling, Victor Brodeur – Officier de la Marine canadienne (1909-1946), Éditions Athéna, Outremont (Québec), 2008, 268 pages.
Résumé du livre :
Créée officiellement en 1910, la Marine royale canadienne forme une sorte de société distincte: elle possède une hiérarchie, ses traditions, un langage différent, le privilège de choisir ses membres et son propre système de valeurs.
Pour en faire partie, il faut donc en accepter les codes et les traditions toutes britanniques. Francophone unilingue, Victor Brodeur en devint pourtant un membre à part entière en s'enrôlant en tant que cadet en 1909 et terminant sa carrière avec le grade de contre-amiral en 1946.
La carrière de Victor Brodeur se fit parallèlement au développement de la toute jeune Marine canadienne. Faute de navires, les recrues tout comme les officiers s'entraînaient avec les membres de la Royal Navy. Brodeur sillonnera donc les mers des Caraïbes, tout comme il se retrouvera dans la mer Baltique à la fin de la Première Guerre mondiale. Il fut tour à tour capitaine de navire, attaché naval et commandant de la marine en Colombie-Britannique.
Grâce aux nombreux documents d'archives, Bill Rawling met en lumière la carrière d'un homme étonnant, au franc-parler, mais totalement méconnu au Québec.
Acheter chez Renaud Bray
Les camps d'internement au Canada

La fête de Noël dans un camp d'internement au Canada, lors de la Première Guerre mondiale en 1916. Bibliothèque et Archives Canada / C-014104
Dans l’édition août-septembre du magazine Canada’s History, l'auteur et historien Bill Waiser propose un article intitulé Park Prisoners. Il y raconte comment des milliers de prisonniers de guerre dans les camps d’internement canadiens ont joué un rôle actif dans la construction des parcs nationaux canadiens.
En complément à cet article, nous vous proposons de parcourir un guide thématique créé par Bibliothèque et Archives Canada et qui porte sur les camps d’internement au Canada durant les Première et Seconde Guerres mondiales. Pour les personnes intéressées par le sujet, ce guide est une véritable bible à consulter.
Bibliothèque et Archives Canada:
Guides thématiques — Les camps d'internement au Canada durant les Première et Seconde Guerres mondiales
Guerres mondiales – Prisonniers en sol canadien

Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Dans l’édition août-septembre du magazine Canada’s History, l'auteur et historien Bill Waiser propose un article intitulé Park Prisoners. Il y raconte comment des milliers de prisonniers de guerre dans les camps d’internement canadiens ont joué un rôle actif dans la construction des parcs nationaux canadiens.
En complément à cet article, nous vous proposons quelques ressources à consulter et des lieux à visiter afin d'en savoir plus au sujet des camps d’internement au Canada durant les Première et Seconde Guerres mondiales.
Pour en savoir plus :
Organisation:
Fonds canadien de reconnaissance de l'internement durant la Première Guerre mondiale
Fonds canadien de reconnaissance de l'internement durant la Première Guerre mondiale a pour but d'appuyer des projets visant à commémorer et à reconnaître les expériences vécues par les communautés ethnoculturelles touchées par la première opération nationale d'internement menée au Canada de 1914 à 1920.
Lieux à visiter
Parc national Banff
Exposition – Lieu historique national Cave and Basin
Sujets d’un pays ennemi, prisonniers de guerre : les opérations d’internement au Canada pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1920
Parcs Canada a créé une exposition qui a pour but d’accroître la sensibilisation du public aux opérations d’internement qui ont eu lieu au Canada pendant la Première Guerre mondiale entre les années 1914 et 1920. L’exposition, qui est d’une superficie de 305 m2, est située à côté du lieu historique national Cave and Basin dans le parc national Banff. Elle propose des écrans tactiles interactifs, des présentations multimédias et des montages à deux dimensions qui incitent les visiteurs à découvrir à leur propre rythme cette période difficile et particulièrement intense de l’histoire canadienne tout en leur laissant le soin de former leur propre opinion.
Camp de prisonniers en Abitibi durant la Première Guerre mondiale
Camp de détention Spirit Lake
Situé en bordure du lac Beauchamp, près d'Amos, ce camp a accueilli environ 1 200 personnes internées principalement en raison de leur origine ethnique. Elles étaient ukrainiennes pour la plupart, mais des Allemands, des Bulgares et des Turcs ont également été envoyés au camp. Le camp de Spirit Lake est aussi l'un des deux seuls camps canadiens à avoir logé des familles.
Spirit Lake
Chemin Saint-Viateur
La Ferme
(819) 732-8611
Visite extérieure seulement
Tarifs : Entrée gratuite
Horaire : Accès libre au site en tout temps
Exposition virtuelle
Musée canadien de la guerre
Exposition virtuelle – Le Canada et la Première Guerre mondiale
La guerre encouragea le sentiment national et les manifestations de patriotisme, mais elle aggrava les tensions et les préjugés ethniques et conduisit à poursuivre en justice un bon nombre de ceux qu'on appelait des « sujets d'un pays ennemi ». Apprenez-en davantage sur les effets négatifs de la guerre sur certaines communautés canadiennes.
Archives audio et vidéo
Office national du Film
Les rêves perdus 1999, réalisation : Daniel Frenette (Extrait: 2 minutes et 17 secondes)
Une jeune Canadienne d'origine ukrainienne raconte l'histoire de son père, venu au Canada d'Ukraine avec sa famille pour échapper à la pauvreté et fuir l'empire autrichien. Elle rappelle la répression et les persécutions endurées par ses compatriotes détenus dans les camps d'internement durant la Première Guerre mondiale.
Étrangers ennemis 1975, réalisation : Jeanette Lerman (26 minutes et 49 secondes)
L'internement des Canadiens d'origine japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale constitue le sujet de ce film de 1975. Au moyen de photos d'archives et de la narration, l'extrait présenté décrit les conditions sociales et physiques particulières de cet internement. Il met en lumière l'humiliation, l'exploitation et les préjugés subis par les Canadiens d'origine japonaise au cours de cette période.
Minoru : souvenirs d'un exil 1992, réalisation : Michael Fukushima (18 minutes et 49 secondes)
Comme des milliers d'autres Canadiens d'origine japonaise, Minoru et sa famille, qui habitaient Vancouver en Colombie-Britannique, furent déclarés ennemis du Canada, à la suite du bombardement de Pearl Harbor par l'aviation japonaise le 7 décembre 1941.
Canada vignettes : le dentiste 1979, réalisation : Judith Potterton, Rosemarie Shapley (5 minutes)
Vignette sur un Canadien japonais qui pratique l'art dentaire à Montréal. Il nous raconte son enfance dans un camp de prisonniers.
Parcs Canada
La détention des prisonniers militaires de la Seconde Guerre mondiale et des sujets ennemis (4 minutes et 54 secondes)
De 1940 à 1947, le Canada détient environ 34 000 combattants allemands, des marins marchands ennemis et des internés civils de la Grande-Bretagne dans 26 camps permanents et des centaines de petits camps de travail partout au pays. Cette mesure, demandée par les Britanniques, contribue à l'effort de guerre allié en éloignant ces hommes des zones de combats. Dans les camps les détenus forment une main-d'œuvre utile dans des secteurs clés, dont l'agriculture et la foresterie. Salué sur la scène internationale, le traitement accordé aux prisonniers militaires en incitera des centaines à immigrer après la guerre.
Camp allemand de prisonniers de guerre de Whitewater -- Le meilleur emploi d'été au Canada (7 minutes et 41 secondes)
Dans le cadre des célébrations marquant le 125e anniversaire des parcs nationaux du Canada, 32 étudiants répartis dans les 32 unités des gestions de Parcs Canada à travers le pays avaient pour tâche de réaliser une série de reportages vidéo sur leurs expériences dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation. Christopher Paetkau a réalisé le film Camp allemand de prisonniers de guerre de Whitewater.
Société Radio-Canada
1914-1918 : Ukrainiens internés. Radiojournal. 25 mai 1987. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (1 minutes et 21 secondes)
22 000 Japonais déplacés dans des camps. Le Point. 24 octobre 1984. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (14 minutes et 17 secondes)
Au camp de Kananaskis Le Sommet du G8 de Kananaskis. 25 juin 2002. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (4 minutes et 16 secondes)
Des Juifs et des nazis prisonniers ensemble. Des livres et des hommes. 3 juin 1976. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (7 minutes et 27 secondes)
Des prisonniers au travail dans les fermes. Qui êtes-vous? 30 octobre 1995. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (5 minutes et 45 secondes)
Enquête sur les prisonniers de guerre au Canada. Dimanche magazine. 7 mai 1995. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (10 minutes et 2 secondes)
Étrangers internés au Canada. Présent dimanche. 25 septembre 1988. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (33 minutes et 19 secondes)
Évasion au fort de l'île Sainte-Hélène. Montréal ce soir. 19 juillet 1993. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (9 minutes et 6 secondes)
Excuses aux anciens détenus d'origine italienne. Montréal ce soir. 5 novembre 1990. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (2 minutes et 16 secondes)
Italiens internés au Cap-Breton. Radiojournal. 15 avril 1991. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (1 minute et 43 secondes)
La convention de Genève. Le Point. 22 janvier 1991. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (6 minutes et 49 secondes)
La grande évasion de Bowmanville. Contrechamp. 12 février 1985. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (26 minutes et 6 secondes)
La vie à Slocan et à Lethbridge. La Bombe – Victoire finale. 15 août 1995. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (7 minutes et 6 secondes)
Le camp de Trois-Rivières : une prison dorée? La Vie quotidienne des Québécois de 1939 à 1945. 15 juin 1975. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (6 minutes et 41 secondes)
Le Canada, geôlier de l'Empire britannique. Le Point. 11 novembre 1991. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (3 minutes et 45 secondes)
Le fascisme gagne le Canada. Les Actualités (radio). 15 juillet 1997. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (7 minutes et 5 secondes)
Les Canadiens d'origine japonaise obtiennent réparation. Téléjournal. 22 septembre 1988. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (2 minutes et 28 secondes)
Prisonniers allemands en sol canadien. Entrevue avec Yves Bernard. 3 septembre 1995. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (6 minutes et 59 secondes)
Retour au camp de Bowmanville. Le Point. 11 novembre 1991. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (17 minutes et 46 secondes)
Un camp de prisonniers au Lac Saint-Jean. Mon oeil. 3 septembre 1995. Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. (9 minutes et 4 secondes)
Lecture :
Caroline Bergeron et Yves Bernard. Trop loin de Berlin Des prisonniers allemands au Canada (1939-1946). Québec, Septentrion. 1995. 360 pages.
Résumé :
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Canada a accueilli environ 35 000 prisonniers de guerre allemands sur son territoire. Pendant plus de six ans, à la demande du gouvernement britannique, les autorités canadiennes ont administré des camps disséminés un peu partout au pays, mais principalement au Québec et en Ontario.
Trop loin de Berlin nous fait revivre l'époque de la guerre grâce aux documents inédits (photographies, documents d'archives) et aux témoins. Ceux-ci se souviennent et relatent une partie de notre histoire presque inconnue.
Martin F. Auger, Prisonniers de guerre et internés allemands dans le sud du Québec (1940-1946), Éditions Athena, novembre 2010. 299 pages.
Résumé:
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement canadien mit sur pied cinq camps d'internement pour prisonnier et internés allemands dans le sud du Québec (Farnham, Grande-Ligne, île-aux-Noix, Sherbrooke et Sorel).
Cet ouvrage analyse le fonctionnement de ces camps. Il évoque aussi la vie derrière les barbelés et les tensions physiques et psychologiques auxquelles furent soumis ces hommes. Il porte également un regard sur les programmes d'éducation conçus à leur intention.
Amis de l’homme même dans le malheur

Bibliothèque et Archives Canada / PA-030191
Dans l’édition octobre-novembre du magazine Canada’s History, les historiens Tim Cook et Andrew Iarocci proposent un article intitulé Animal Soldiers. Ils nous présentent quelques histoires étonnantes situées à l'époque de la Première Guerre mondiale et mettant en vedette des animaux attachants. Peu importe qu’ils aient été mascottes, outils de travail ou meilleurs amis de l’homme, les animaux ont eux aussi joué un rôle important dans l’histoire militaire canadienne.
En complément à cet article, nous vous proposons un dossier de ressources à consulter pour en savoir plus à ce sujet.
Bibliothèque et Archives Canada
Le blogue de Bibliothèque et Archives Canada
Lancé en novembre 2011 comme projet pilote, le blogue de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est une initiative visant à moderniser les façons de communiquer avec les Canadiens. Voici deux billets intéressants en lien avec l’article d’octobre-novembre 2013 du magazine Canada’s History.
Les animaux à la guerre (1914-1918)
Trésors cachés-Winnie l’ourson
Bibliothèque et Archives Canada a également créé une page Flickr mettant à l’honneur quelques animaux célèbres de la Première Guerre mondiale.
Les animaux à la guerre (1914-1918)
Musée canadien de la guerre
Dans l’exposition virtuelle Le Canada et la Première Guerre mondiale que l’on retrouve sur le site Web du Musée canadien de la guerre, une section est consacrée aux mascottes et animaux de compagnie.
Visiter le site Web
Le Musée canadien de la guerre a également regroupé une série photo d’animaux de la guerre dans une page intitulée Mascottes.
Visiter la page Flickr
Enfin, le musée a mis en ligne sur sa page YouTube une vidéo intitulée Le chaton mascotte d'une corvette pendant la Seconde Guerre mondiale.
Anciens combattants Canada
Ancien combattants Canada a créé des activités d’apprentissage s'adressant aux enseignants du niveau primaire. Le ministère a créé à cet effet un dossier regroupant :
• une affiche - Histoires d'animaux à la guerre
• un jeu de société
• un guide de l'enseignant
• des fiches des personnages du Club du Souvenir
• un arbre généalogique du Club du Souvenir
Pour un savoir plus Visiter Histoire d'animaux à la guerre
La Commission de la capitale nationale
Des éléments commémoratifs rendant hommage aux animaux de guerre ont été réalisés en 2012 par l’artiste et sculpteur canadien David Clendining.
Pour en savoir plus au sujet de cet hommage particulier aux animaux de guerre.
Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel
Pour les militaires, la présence des animaux à leur côté semble avoir perduré jusqu’à aujourd’hui. Pour témoigner de ce phénomène, nous vous proposons de rencontrer Batisse, la mascotte régimentaire du Royal 22e Régiment. Découvrez Batisse dans un portrait réalisé dans le cadre de l’Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel.

Crédit Photo: Musée Royal 22e Régiment
Connaissez-vous votre sport national?

Match de hockey à la patinoire Victoria de Montréal, en 1893 / Source: Bibliothèque et Archives Canada/Collection des Archives Molson/PA-139443
Dans l’édition octobre-novembre du magazine Canada’s History, un article intitulé The Genuine Originals attirera votre attention. Présentant les premières équipes qui composaient la Ligue nationale de hockey, cet article pourrait vous en apprendre beaucoup à propos des six premières équipes qui composaient la ligue.
Pour en savoir plus sur les origines du hockey au Canada, nous avons pensé vous présenter deux projets numériques préparés par Bibliothèque et Archives Canada. Le premier s’adresse aux adultes et est intitulé Regard sur le hockey alors que le second est destiné aux élèves et a s'intitule Regard sur le hockey à l'intention des jeunes.
La coupe Stanley à Québec, ce n’est pas une fiction!

Quebec Bulldogs, 1912-1913.
Dans l’édition octobre-novembre du magazine Canada’s History, vous découvrirez un article intitulé The Genuine Originals. Vous y constaterez que les premières équipes qui composaient la Ligue nationale de hockey n’étaient peut-être pas celles que vous croyez.
En attendant de parcourir l’article, nous vous présentons l’histoire d’une de ces équipes, les Quebec Bulldogs, en attirant votre attention vers le travail de recherche réalisé par le journaliste québécois Marc Durand. Au menu : livre, reportages vidéo et blogue.
Livre
Marc Durand. La Coupe à Québec : les Bulldogs et la naissance du hockey. Édition Harvey Sylvain, novembre 2012.

Résumé
En mars 1912, Québec célèbre sa plus grande conquête sportive : son club de hockey vient de remporter la coupe Stanley. Lors de la victoire ultime disputée sur les plaines d'Abraham, les huit buts sont comptés par trois natifs de Québec et le jeu blanc est porté à la fiche du gardien local. Québec devient alors la capitale mondiale du hockey et remporte la première de deux coupes Stanley, bien avant les Canadiens de Montréal.
La Coupe à Québec raconte l'incroyable aventure du Québec Hockey Club, créé à l'hiver 1878 par un fils de libraire de la rue St-Paul. Il décrit la naissance du sport, la rivalité Québec- Montréal qui s'établit dès le premier match, les grandes victoires de 1912 et 1913, les exploits de Joe Malone, de Paddy Moran et de Joe Hall ainsi que les grandes décisions qui ont défini notre sport national.
Abondamment illustré de photos rares et appuyé par dix ans de recherches et d'entrevues, La Coupe à Québec révèle enfin un passé riche, caché dans de vieux journaux.
Au moment où le retour d'une équipe de la LNH à Québec est de plus en plus plausible, ce bel ouvrage ravira tant les amateurs de hockey dont la flamme n'est pas encore éteinte que les friands d'histoire. Publié par les Éditions Sylvain Harvey et la Commission de la capitale nationale du Québec, il enrichit la collection La Bibliothèque de la capitale nationale.
Reportages
Les Bulldogs de Québec 1878-1920
Reportage diffusé à l’émission 400 fois Québec, Radio-Canada.
La première coupe Stanley des Bulldogs de Québec (1912)
Reportage diffusé à l’émission Hebdo sport, Radio-Canada, le 6 mars 2012.
Blogue
Quebec Bulldogs - Le Quebec Hockey Club (1878-1920): le premier club de hockey civil au monde
Le journaliste Marc Durand a créé un blogue qu'il alimente régulièrement.
Lorsque l'histoire reprend vie sur nos petits écrans
Pouvons-nous considérer que les diffuseurs canadiens mettent en onde suffisamment de fictions ou de documentaires à caractère historique ? Dans l’édition décembre/janvier du magazine Canada’s History, l’historienne et auteure Charlotte Gray se questionne sur la place de notre histoire dans les séries dramatiques produites au Canada. Le manque de financement disponible semble être la cause principale de cette rareté dans nos petits écrans. Véronique Nguyên-Duy, professeure au département d’information et de communication de l’Université Laval, semble abonder dans le même sens que madame Gray à ce sujet.
En plus de la lecture de l'article Too Big to Film de Charlotte Gray, nous vous proposons la lecture d’un article publié par madame Nguyên-Duy publié dans l’Encylopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française. Madame Nguyên-Duy s’intéresse aussi aux impacts des séries historiques pour le secteur de l’industrie touristique québécoise.
Véronique Nguyên-Duy, Téléséries d'époque et tourisme, Encylopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française.
Bien que les séries historiques soient de plus en plus rares à la télévision francophone, les Canadiens Français ont en mémoire de grandes séries produites par les chaînes francophones. Alors que les chaînes anglophones produisirent seulement six grandes séries dramatiques au cours des 60 dernières années, les Canadiens Français ont quant à eux pu en visionner plus d'une soixantaine selon la professeure Nguyên-Duy. Nous vous proposons de revoir quelques extraits de ces séries marquantes.
Pourquoi ne pas profiter de la froideur hivernale pour voir ou revoir quelques-unes de ces grandes séries?
Radisson, 1957, Ici Radio-Canada télé et CBC
Les Forges de Saint-Maurice,1972-1975, Ici Radio-Canada télé
Duplessis, 1978, Ici Radio-Canada télé
Les Tisserands du pouvoir, 1988, Ici Radio-Canada télé
Les Filles de Caleb, 1990, Ici Radio-Canada télé
Montréal ville ouverte, 1992, Groupe TVA
Blanche, 1993, Ici Radio-Canada télé
Alys Robi, 1995, Groupe TVA
Marguerite Volant, 1996, Ici Radio-Canada télé
Chartrand et Simonne, 2000 et 2003, Ici Radio-Canada télé et Télé Québec
René Lévesque, 2006, Ici Radio-Canada télé et CBC
Musée Éden, 2010, Ici Radio-Canada télé
Autres séries ou téléromans:
Cormoran
Le temps d’une paix
René Lévesque (série télévisée,1994)
Le Polock
La Petite Patrie
Le Parc des braves
Montréal PQ
Les Orphelins de Duplessis
Nos étés
L'Ombre de l'épervier
Au nom du père et du fils
Asbestos
J.Armand Bombardier
Les Bâtisseurs d'eau
Les Belles Histoires des pays d'en haut
Ces enfants d’ailleurs
Miséricorde
Cher Olivier
Entre chiens et loups
Le volcan tranquille
Shehaweh
Willie
Les jumelles Dionne
Séparation ne rime pas toujours avec Québec

Photo: Vancouver Island Province Association
Et si l’Île de Vancouver devenait la 11e province du Canada? L’idée peut surprendre, mais il semblerait qu’elle soit bien présente dans l’esprit d’habitants de l’île et depuis plus longtemps que l’on pourrait l’imaginer. L’historien Forrest D. Pass, dans un article intitulé Free the Island et publié dans l’édition décembre/janvier du magazine Canada’s History s’est intéressé à cette question. Pour en apprendre davantage à ce sujet, vous pouvez, en plus de lire l’article de l'historien, écouter un reportage diffusé le 7 août 2013 par Ici Radio-Canada Première.
L’Île de Vancouver en quête d’indépendance
Émission Midi express
Diffusée le 7 aout 2013 - Ici Radio Canada Première
Tommy Douglas
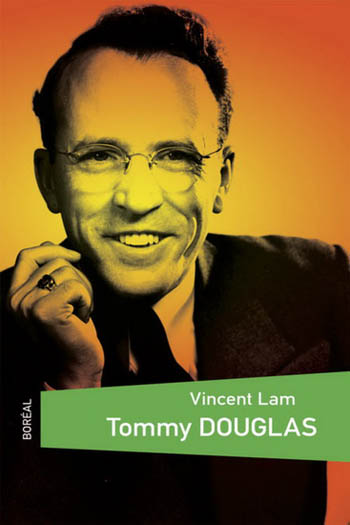
En complément à l'article de Christopher Moore publié dans le numéro février/mars du magazine Canada’s History , nous vous proposons la lecture de cette biographie du médecin et écrivain Vincent Lam portant sur Tommy Douglas, bâtisseur de la social-démocratie au Canada.
Vincent Lam, Tommy Douglas, Montréal, Édition du Boréal, 2012. 240 pages.
Résumé du livre
Homme des Prairies, Tommy Douglas était d'ascendance écossaise. Il croyait profondément en l'apport du mouvement coopératif au bien commun. Il se lança d'abord dans une carrière de boxeur avant de devenir ministre de l'Église baptiste. Il abandonna ensuite la chaire du prêcheur pour la tribune du politicien et se fit connaître comme un redoutable orateur. Il fut pendant dix-sept ans premier ministre de la Saskatchewan, où il implanta un système de soins de santé universel qui allait servir de modèle à tout le Canada.
À partir de 1961, comme leader du Nouveau Parti démocratique, Tommy Douglas s'est révélé un irréductible défenseur des libertés civiles. Il s'opposa farouchement à Pierre Elliott Trudeau quand celui-ci imposa les mesures de guerre, en 1970. C'est grâce à lui que la social-démocratie s'est établie durablement sur la scène politique canadienne.
Acheter chez Renaud Bray
La lutte pour l’assurance maladie au Canada

Bibliothèque et archives Canada, no4366063
Dans l’édition février/mars du magazine Canada’s History, l’historien Christopher Moore signe un article intitulé Canada without Medicare. L’auteur nous propose un retour en arrière afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants entourant la création du système de santé universel au Canada. En faisant la lecture, vous découvrirez que les luttes des principaux partisans, inspirés par le charismatique Tommy Douglas, ne furent pas de tout repos.
Question d’en apprendre davantage sur le sujet, nous vous proposons la visite d’une exposition virtuelle intitulée La lutte pour l’assurance maladie : l’histoire des soins de santé au Canada, 1914-2007. Préparée par le Musée canadien de l’histoire, vous pourrez explorer l’histoire, les personnes, la politique et les programmes qui ont fait du régime universel d’assurance maladie un élément distinctif du progrès social au Canada. Vous trouverez aussi des plans de leçons, des cyberquêtes, des activités d’apprentissage, des ressources primaires
et secondaires, et des liens vers d’autres sites Internet utiles.
Visiter l’exposition La lutte pour l’assurance maladie : l’histoire des soins de santé au Canada, 1914-2007.
Pour en savoir plus sur l’exposition en question, nous vous invitons à visionner la vidéo suivante créée par le musée.
Acte de naissance de l'assurance maladie

Source : C.C.F. / Bibliothèque et Archives Canada / C-000314
Dans l’édition février/mars du magazine Canada’s History, l’historien Christopher Moore signe un article intitulé Canada without Medicare. L’auteur y explique la création d’un système de santé universel au Canada. En faisant la lecture, vous constaterez que les luttes des principaux partisans de ce système ne furent pas de tout repos.
Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous proposons de visionner un reportage de la journaliste Julie Miville-Dechêne diffusé au Point en 1993 et conservé dans les Archives de Radio-Canada. Madame Miville-Dechêne retrace l'histoire du système public de santé au Canada.
Acte de naissance de l'assurance maladie : Le Point, 16 février 1993, 13 min 27 s
Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. Journaliste: Julie Miville-Dechêne
Cliquez ici pour voir le reportage
Les « cigarettes girls » de Montréal

The Jefferson R. Burdick Collection, Gift of Jefferson R. Burdick; Burdick 257, C190.3
Dans l’édition avril/mai du magazine Canada’s History, l’auteure et professeure Sharon Anne Cook signe un article intitulé When Smoking Was Chic. L’auteure nous propose un retour en arrière nous permettant de mieux comprendre les stratégies des compagnies de tabac pour courtiser les femmes comme consommatrices au début de XXe siècle.
Pour compléter cet article, nous vous proposons l’écoute d’une entrevue audio réalisée par le journaliste Hugo Lavoie, dans le cadre de l’émission C’est pas trop tôt! Diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première, le 13 novembre 2013. À l'occasion du lancement de l'exposition Scandale sur le Montréal du vice des années 1940-1960 au Centre d'histoire de Montréal, le journaliste s’est entretenu avec madame Thérèse Vallée-Fiorilli afin d’en apprendre davantage au sujet du métier de « cigarette girl ».
En terminant, nous vous proposons aussi une chronologie regroupant les moments importants de l’histoire du tabac au Canada.
Les « cigarettes girls » de l'après-guerre
Émission C’est pas trop tôt! - ICI Radio Canada Première
Par Hugo Lavoie
Diffusée le mercredi 13 novembre 2013
Durée: 5 minutes 6 secondes

 Le Conseil souverain de la Nouvelle-France impose des droits sur le tabac.
Le Conseil souverain de la Nouvelle-France impose des droits sur le tabac.
 Il est interdit aux habitants de la Nouvelle-France de fumer dans les rues et d’y transporter du tabac.
Il est interdit aux habitants de la Nouvelle-France de fumer dans les rues et d’y transporter du tabac.
 Le Canada exporte du tabac en France.
Le Canada exporte du tabac en France.
 MacDonald Tobacco voit le jour à Montréal.
MacDonald Tobacco voit le jour à Montréal.
 La Chambre des communes rejette une résolution visant à abolir les taxes sur le tabac.
La Chambre des communes rejette une résolution visant à abolir les taxes sur le tabac.
 La Colombie-Britannique interdit la vente de tabac aux mineurs; son exemple est suivi par l’Ontario et la Nouvelle-Écosse en 1891, le Nouveau-Brunswick en 1893 et les Territoires du Nord-Ouest en 1896.
La Colombie-Britannique interdit la vente de tabac aux mineurs; son exemple est suivi par l’Ontario et la Nouvelle-Écosse en 1891, le Nouveau-Brunswick en 1893 et les Territoires du Nord-Ouest en 1896.
 Le ministère fédéral de l’Agriculture met sur pied la Direction générale du tabac.
Le ministère fédéral de l’Agriculture met sur pied la Direction générale du tabac.
 La Loi sur la répression de l'usage du tabac chez les adolescents rend illégale la vente de produits du tabac à quiconque a moins de 16 ans.
La Loi sur la répression de l'usage du tabac chez les adolescents rend illégale la vente de produits du tabac à quiconque a moins de 16 ans.
 Imperial Tobacco, établie en 1908 par la fusion de l’American Tobacco Company et de l’Empire Tobacco Company, est constituée en société.
Imperial Tobacco, établie en 1908 par la fusion de l’American Tobacco Company et de l’Empire Tobacco Company, est constituée en société.
 Le comité spécial des maux de la cigarette de la Chambre des communes tient des audiences publiques.
Le comité spécial des maux de la cigarette de la Chambre des communes tient des audiences publiques.
 La première publicité canadienne montrant une femme qui fume une cigarette paraît dans la Montreal Gazette.
La première publicité canadienne montrant une femme qui fume une cigarette paraît dans la Montreal Gazette.
 Des études épidémiologiques de grande envergure montrant un lien statistique entre le cancer du poumon et le tabagisme sont publiées.
Des études épidémiologiques de grande envergure montrant un lien statistique entre le cancer du poumon et le tabagisme sont publiées.
 Le gouvernement fédéral réduit les taxes sur le tabac pour réagir à une augmentation de la contrebande de cigarettes.
Le gouvernement fédéral réduit les taxes sur le tabac pour réagir à une augmentation de la contrebande de cigarettes.
 L’Association médicale canadienne publie son premier avertissement sur les dangers de la cigarette.
L’Association médicale canadienne publie son premier avertissement sur les dangers de la cigarette.
 La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune est mise sur pied.
La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune est mise sur pied.
 Publication des résultats d’une importante étude de Santé et Bien-être social, amorcée en 1954, sur les effets de la cigarette chez les anciens combattants canadiens; on signale qu’il y a 60 p. 100 plus de morts chez les fumeurs de cigarette que chez les non-fumeurs, et un lien est établi entre la consommation de cigarettes et une augmentation des cas de cancer du poumon et de maladies cardiaques.
Publication des résultats d’une importante étude de Santé et Bien-être social, amorcée en 1954, sur les effets de la cigarette chez les anciens combattants canadiens; on signale qu’il y a 60 p. 100 plus de morts chez les fumeurs de cigarette que chez les non-fumeurs, et un lien est établi entre la consommation de cigarettes et une augmentation des cas de cancer du poumon et de maladies cardiaques.
 Un rapport du Royal College of Physicians à Londres expose les faits établis par les recherches concernant les conséquences nocives du tabac.
Un rapport du Royal College of Physicians à Londres expose les faits établis par les recherches concernant les conséquences nocives du tabac.
 La ministre fédérale de la Santé, Judy LaMarsh, attire l’attention sur le lien entre la consommation de cigarettes et le cancer du poumon, les maladies coronariennes et la bronchite chronique.
La ministre fédérale de la Santé, Judy LaMarsh, attire l’attention sur le lien entre la consommation de cigarettes et le cancer du poumon, les maladies coronariennes et la bronchite chronique.
 Un rapport du Comité consultatif présenté au ministre de la Santé des États-Unis conclut que le cancer du poumon et la bronchite chronique sont des conséquences médicales du tabagisme.
Un rapport du Comité consultatif présenté au ministre de la Santé des États-Unis conclut que le cancer du poumon et la bronchite chronique sont des conséquences médicales du tabagisme.
 L’industrie canadienne du tabac adopte son premier code volontaire sur les pratiques de commercialisation.
L’industrie canadienne du tabac adopte son premier code volontaire sur les pratiques de commercialisation.
 Le ministère fédéral de la Santé nationale et du Bien-être social commande une enquête nationale sur la consommation de tabac.
Le ministère fédéral de la Santé nationale et du Bien-être social commande une enquête nationale sur la consommation de tabac.
 Le Cabinet fédéral approuve la rédaction de mesures législatives exigeant qu’on indique sur les paquets de cigarettes et dans la publicité la teneur des produits en goudron et en nicotine; cependant, aucun projet de loi n’est présenté.
Le Cabinet fédéral approuve la rédaction de mesures législatives exigeant qu’on indique sur les paquets de cigarettes et dans la publicité la teneur des produits en goudron et en nicotine; cependant, aucun projet de loi n’est présenté.
 Un rapport du Comité de la santé, du bien-être et des affaires sociales des Communes (rapport Isabelle) formule des recommandations sur les restrictions à la publicité et à la promotion des produits du tabac.
Un rapport du Comité de la santé, du bien-être et des affaires sociales des Communes (rapport Isabelle) formule des recommandations sur les restrictions à la publicité et à la promotion des produits du tabac.
 Dans sa première résolution antitabac, l’Assemblée mondiale de la santé exhorte les gouvernements à lutter contre le tabagisme, considéré comme une cause de décès qu’on peut éviter.
Dans sa première résolution antitabac, l’Assemblée mondiale de la santé exhorte les gouvernements à lutter contre le tabagisme, considéré comme une cause de décès qu’on peut éviter.
 Le gouvernement présente le projet de loi C-248 prévoyant l’interdiction de la publicité sur la cigarette; cependant, le projet de loi n’est pas débattu. L’industrie du tabac et le gouvernement s’entendent sur des lignes directrices d’application volontaire.
Le gouvernement présente le projet de loi C-248 prévoyant l’interdiction de la publicité sur la cigarette; cependant, le projet de loi n’est pas débattu. L’industrie du tabac et le gouvernement s’entendent sur des lignes directrices d’application volontaire.
 Le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé et l’Association pour les droits des non-fumeurs sont fondés.
Le Conseil canadien sur le tabagisme et la santé et l’Association pour les droits des non-fumeurs sont fondés.
 La ville d’Ottawa adopte le premier règlement municipal interdisant la cigarette dans les lieux publics.
La ville d’Ottawa adopte le premier règlement municipal interdisant la cigarette dans les lieux publics.
 Imasco fait l’acquisition de Shoppers Drug Mart.
Imasco fait l’acquisition de Shoppers Drug Mart.
 Une gomme à mâcher à la nicotine est mise en vente au Canada sur ordonnance.
Une gomme à mâcher à la nicotine est mise en vente au Canada sur ordonnance.
 La Stratégie nationale de lutte contre le tabagisme est mise en place, avec la participation des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et de huit organisations du secteur de la santé.
La Stratégie nationale de lutte contre le tabagisme est mise en place, avec la participation des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et de huit organisations du secteur de la santé.
Source : Direction de la recherche parlementaire. Le tabac et la santé : réponses du gouvernement. Décembre 1998 http://publications.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/modules/prb98-8-tobacco/index-f.htm#HISTORIQUE
Sainte Kateri Tekakwitha

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 0003727136
Dans l’édition avril/mai du magazine Canada’s History, Mark Abley publie un article intitulé Reclaiming Kateri portant sur la seule sainte autochtone canadienne. En complément, nous vous proposons quelques ressources à consulter afin de mieux connaître cette jeune amérindienne récemment canonisée.
De remarquables oubliés
ICI Radio-Canada Première
1er septembre 2011
Serge Bouchard et son équipe nous proposent un conte historique relatant l’histoire de Kateri Tekakwitha lors de son émission de radio De remarquables oubliés ICI Radio-Canada Première.
Téléchargez le conte Kateri Tekakwitha, la sainte sauvagesse sur iTunes
Second Regard
L'héritage de Kateri Tekakwitha
Émission du 21 octobre 2012
Dans le cadre de l’émission Second Regard, voici un reportage du journaliste-réalisateur Jean Robert Faucher. Il s’est entretenu avec différentes personnes à propos de l’héritage laissé par Kateri Tekakwitha.
Visionner le reportage
-
-
Dictionnaire biographique du Canada
Henri Béchard, « TEKAKOUITHA, Kateri », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 18 mars 2014, http://www.biographi.ca/fr/bio/tekakouitha_1F.html.
Rachel Jodoin. Kateri Tekakwitha. Montréal, Éditions LIDEC, 2012. 64 pages.
Résumé:
La collection biographique Célébrités met en lumière les grandes figures qui ont marqué notre histoire. Riches en informations et concises, ces courtes biographies de 64 pages chacune sont les complices idéales pour les recherches sur des sujets aussi variés que la politique, la religion, les arts, la culture et bien plus encore.
Acheter chez Renaud Bray
Anne E. Neuberger. Bienheureuse Kateri Tekakwitha. Montréal, Éditions Novalis, 2011. 32 pages
Résumé:
Cet album retrace la vie de Kateri Teakakwitha, frappée par la maladie dès son plus jeune âge, qui sera animée par sa foi en Dieu tout au long de son existence.
Acheter chez Renaud Bray
Québec/Canada et guerre de Sécession
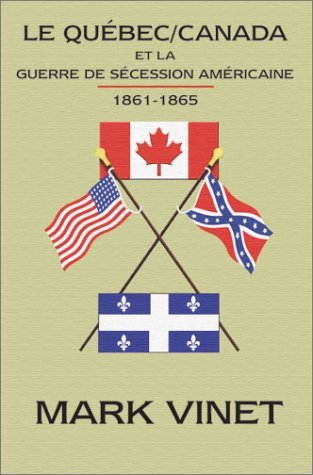
Résumé
Au mois d'avril 1861, l'armée de la nouvelle nation des États Confédérés d'Amérique bombarde une garnison de troupes américaines occupant le Fort Sumter en Caroline du Sud. Cet événement déclenche une guerre civile entre les états américains du Nord et les états du Sud. Cette guerre a duré 4 ans et causa la mort de 620 000 soldats incluant des milliers de Canadiens engagés dans cette guerre. En accord avec la politique externe de l'Angleterre, le Canada se déclare officiellement neutre. Malgré ce fait, plus de 50 000 Canadiens furent impliqués dans ce conflit à titre de militaires. Pendant les hostilités, l'opinion publique du peuple canadien est divisée par divers facteurs dont: la langue, la religion, la culture et le statut social et économique. La Guerre de Sécession fut le point culminant d'une influence réciproque entre le Canada et les États-Unis dans leur développement historique, territorial, politique, économique et social. Suite à la guerre, deux nouvelles nations émergent - la renaissance des États-Unis et la création du Canada moderne.
L'auteur et historien Mark Vinet a choisi de présenter l'histoire du Canada et de la Guerre de Sécession américaine dans une série de livres détaillés. Le voyage débute avec ce tome où Mark Vinet dépeint et élucide, avec la participation de plusieurs auteurs, les systèmes politiques, économiques et sociaux des deux pays avant, pendant et après la guerre. L'influence et la participation canadiennes aux événements principaux, tels l'esclavage, le mouvement abolitionniste et les grandes campagnes militaires, sont explorées et préparent le terrain pour un regard sur le Québec et le Canada à la veille et pendant le grand conflit américain.
Mark Vinet. Le Québec/Canada et la Guerre de Sécession américaine 1861-1865. Vaudreuil-sur-le-Lac, Éditions Wadem, 2002. 204 pages.
Acheter le livre
Compagnie de la Baie d’Hudson – Fleuron du commerce canadien
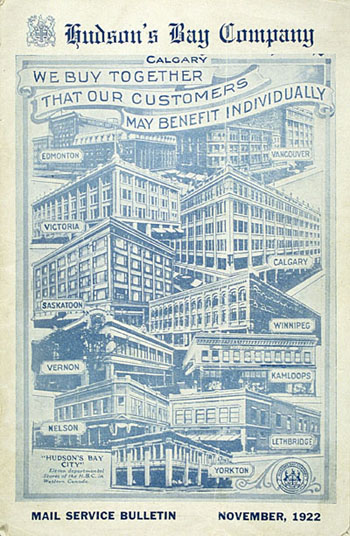
Bulletin du service par correspondance de la Compagnie de la Baie d'Hudson, Calgary, novembre 1922, page de couverture. Archives de la Compagnie de la Baie d'Hudson, Archives provinciales du Manitoba.
Dans l’édition juin/juillet du magazine Canada’s History, Mark Collin Reid publie un article intitulé Empire Upstart portant sur l’histoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson, la plus vieille compagnie en Amérique du Nord. En complément, nous vous proposons quelques ressources en ligne à consulter afin de mieux connaître histoire de ce fleuron canadien.
Site Web commercial de la Compagnie de la Baie d’Hudson – Notre Histoire
Vous trouverez sur cette page une courte synthèse portant sur l’histoire des 400 ans de la compagnie.
MuséeVirtuel.ca
Dans cette exposition virtuelle en ligne, différents thèmes sont présentés. Vous découvrirez entre autres comment la compagnie a pu faire la transition entre le commerce de la fourrure et le commerce de détail. Le premier catalogue, le magasin de Winnipeg, le dernier catalogue et les achats par correspondance font également partie des thèmes qui sont développés dans le cadre de cette exposition.
Site Web du service du Patrimoine de la Compagnie de la Baie d’Hudson
La diffusion est un élément important de la stratégie du service du Patrimoine Hbc. Ce service s’est engagé à faire la promotion de l’histoire de la Société auprès du public en recourant à divers moyens. Ce site Web complet et diversifié a été conçu pour présenter aux gens
le riche patrimoine de Hbc.
L’affaire Munsinger

Gerda Munsinger en mars 1966.
Dans l’édition juin-juillet du magazine Canada’s History, l’auteur et historien Allan Levine propose un article portant sur l’affaire Munsinger, un scandale politique à caractère sexuel survenu à la fin des années 1950. En complément, pour les lecteurs intéressés par cette histoire, nous vous proposons de parcourir un dossier d’archives vidéo disponibles dans de site Web d’ICI Radio-Canada.ca.
Pierre Sévigny parle aux médias.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Durée : 7 minutes et 12 secondes
L'affaire Munsinger.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Émission : Présent 2e édition nationale
Date de diffusion : 14 mars 1966
Durée : 8 minutes et 32 secondes
Gerda Munsinger : « je n'ai rien fait de mal ».
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Émission : Spéciales télé information
Date de diffusion : 15 mars 1966
Durée : 27 minutes et 54 secondes
Le rapport Spence saupoudre les blâmes.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Émission : Présent édition métropolitaine
Date de diffusion : 23 septembre 1966
Durée : 9 minutes et 21 secondes
Pierre Sévigny à nouveau devant la caméra.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Durée : 1 minute et 40 secondes
Ça brassait au Parlement.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada. Émission : Le Sel de la semaine
Date de diffusion : 21 décembre 1965
Durée : 18 minutes et 50 secondes
Le gouvernement du Québec ne veut pas s'en mêler.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Durée : 1 minute et 49 secondes
Le rapport de la GRC sur Gerda Munsinger.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Émission : Présent 2e édition nationale
Date de diffusion : 26 avril 1966
Durée : 5 min 38 s
Gerda fait la une des médias.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Émission : Nouvelles
Date de diffusion : 1er mars 1966
Durée : 1 minute et 55 secondes
Tout le monde, et Maurice Sauvé, a une opinion.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Durée : 1 minute
L'affaire Munsinger, vue 20 ans après.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Émission : Déjà 20 ans
Date de diffusion : 5 mars 1986
Durée : 7 minutes et 58 secondes
Un livre sur les dessous de l'histoire.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Émission : Le Journal du siècle
Date de diffusion : 2 août 1997
Durée : 7 min 02 s
Ursulines et Augustines : piliers du Canada depuis 375 ans !

Avec l'autorisation du Musée des Ursulines
En avril 1639, il y a 375 ans, le navire Saint-Joseph leva l’ancre à Dieppe en direction d’une destination dont la beauté – et l’hiver – avait été rendue légendaire par les Relations des Jésuites. Du voyage se trouvaient six Jésuites, l’équipage ainsi que trois Ursulines et trois Augustines. La traversée dura trois mois durant lesquels ces missionnaires évitèrent les Anglais et les pirates, bravèrent de furieuses tempêtes, survécurent à des maladies infectieuses et frôlèrent un iceberg « grand comme une ville ». Miraculeusement sauves et en relativement bonne santé, Jésuites, Ursulines et Augustines débarquèrent à Québec le 1er août 1639 dans l’allégresse générale. Bien qu’en petit nombre, les Ursulines et les Augustines venaient apporter une aide et un soutien moral essentiels au développement de la jeune colonie. Québec, d’ailleurs, ne restait alors qu’un village de quelques centaines d’habitants.
Sans attendre, les deux communautés féminines cloîtrées entamèrent leur mission dans ce « païs de Canada » où tout était encore à faire. Les Augustines fondèrent alors le premier hôpital au nord du Mexique. Très tôt, les malades tant français qu’amérindiens affluèrent. Soutenues financièrement par la Duchesse d’Aiguillon, celles que l’on appelle également les Hospitalières demeurèrent, et demeurent aujourd’hui, une référence dans les soins apportés aux malades. Les Ursulines, de leur côté, parrainées par Madame de la Peltrie, entreprirent leur œuvre d’éducation et d’évangélisation le lendemain de leur arrivée. Leur école, qui devint au XIXe siècle l’une des plus prestigieuses écoles du continent américain, est aujourd’hui la plus ancienne école pour filles en Amérique du Nord.
L’amitié qui lie toujours les deux communautés dépassa ce qu’elle aurait dû être dans un monde sans catastrophe ou conflit, soit une simple cohabitation doublée d’un souvenir d’un voyage complété en collaboration. À trois occasions, le destin de ces deux communautés se rejoignit, bien que cela fût temporaire. La maison des Ursulines fut détruite par le feu à deux reprises; les Ursulines trouvèrent à chaque fois un refuge immédiat chez leurs compagnes Augustines. Puis, lors de la Guerre de Sept Ans, les Hospitalières accueillirent les Ursulines dont le monastère était exposé aux bombardements.
Pour célébrer le 375e anniversaire de l’arrivée miraculeuse des Ursulines et des Augustines à Québec, les deux communautés s’allient de nouveau et présentent une vaste gamme d’activités commémoratives et ludiques. Le point culminant de ces festivités se tiendra le 2 août 2014, lors d’une reconstitution historique interactive de l’arrivée des Hospitalières et des Ursulines. La Place Royale de Québec prendra des airs festifs pour accueillir de nouveau celles qui ont tant fait pour notre pays, alors qu’il n’en était qu’à ses balbutiements. Pour prendre connaissance des autres activités à venir, rendez-vous au www.le375e.com.
La Confédération : objectif Canada

Les Pères de la Confédération à la Conférence de Londres, 1866. © Rogers Cantel. Reproduction autorisée par Rogers Communications Inc. Source : Bibliothèque et Archives Canada/C-006799
Dans l’édition août-septembre du magazine Canada’s History, les auteurs Anne McDonald et Christopher Moore proposent les articles intitulés Daughters of Confederation et The Foundering Fathers? Pour compléter ces articles, nous avons pensé attirer votre attention vers un circuit thématique portant sur la Confédération canadienne et accessible sur le site Web du Musée McCord.
L’historien Brian Young a collaboré avec le Musée McCord afin de créer ce circuit de 32 étapes intitulé La Confédération: objectif Canada. Abondamment illustré, il montre les tenants et les aboutissants de la Confédération canadienne en évoquant le contexte politique, social, économique et culturel de l’époque.
Parcourir le circuit La Confédération : objectif Canada
La Confédération canadienne vue par Bibliothèque et Archives Canada

Crédit : G. P. Roberts. Source : Bibliothèque et Archives Canada/C-000733
Pour compléter les articles d’Anne McDonald et Christopher Moore portant sur la Confédération canadienne, nous vous proposons deux sites Web créés par Bibliothèque et Archives Canada. Le premier, La Confédération canadienne s’adresse d’une manière générale aux personnes intéressées à mieux comprendre cet épisode de l’histoire du pays. Le second, Confédération pour enfants, est destiné aux jeunes de 9 à 13 ans qui souhaitent mieux comprendre la formation du Canada.
Les deux sites expliquent la naissance et la croissance du Canada à partir des quatre provinces du début, en 1867, jusqu'à nos jours. Des essais historiques assortis de documents, d'articles de journaux et de photographies présentent les gens, les lieux et les événements qui ont façonné le pays.
Le site contient des documents rares, difficilement accessibles, qui proviennent de la riche collection de Bibliothèque et Archives Canada.
Visiter le site La Confédération canadienne
Visiter le site Confédération pour les enfants
1812 : Des objets à découvrir au Château Ramezay
Le Château Ramezay — Musée et site historique de Montréal commémore la guerre de 1812 en dévoilant des artéfacts de sa collection dans trois capsules web historiques présentant chacune une perspective différente du conflit, soit celle des Canadiens, des Britanniques et des Premières Nations.
Visitez le site Web du Château Ramezay pour tous savoir à propos de l’exposition et du musée.
Première capsule : Les Canadiens
La première capsule met en lumière le héros de Châteauguay, Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry. Les histoires de l’homme et celles de sa famille y sont abordées et de précieux objets familiaux y sont également dévoilés. D’autres objets associés à un ami proche de Salaberry, le duc de Kent, et des œuvres du peintre et miniaturiste Anson Dickinson sont également présentés dans cette capsule.
Seconde capsule : Les Britannique
La seconde capsule porte sur le gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique, Sir George Prevost. L'interprétation du conflit selon la perspective britannique est bonifiée dans cette capsule par l’intégration d’objets militaires et des œuvres de peintres influents tels que Jean-Baptiste Roy-Audy.
Troisième capsule : Les Premières Nations
Dans cette troisième capsule, le projecteur est tourné vers le chef Shawneen Tecumseh. Parmi les artefacts présentés ici au public, un poignard ayant appartenu à Tecumseh est montré. L’objectif de cette capsule est de raconter la guerre de 1812 telle qu'elle fut vécue et ressentie par les Premières Nations. Les œuvres du peintre huron Zachary Vincent ou l’artiste américain George Catlin contribuent à illustrer la narration.
Semper fidelis : Valcartier d’hier à aujourd’hui (1914-2014)
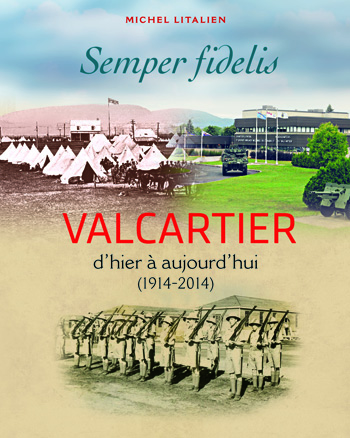
Née en 1914, après l'entrée en guerre du Canada, Valcartier a été menacée d'abandon dans les années 1920, sous-utilisée dans les années 1930 et a repris du service à la Deuxième Guerre mondiale. La base a connu la guerre de Corée et passé au travers de nombreuses missions de paix de l'ONU et des interventions armées de l'OTAN.
Cent ans plus tard, Valcartier reste l'une des plus importantes bases militaires au pays, tant du point de vue de la superficie que de l'opérationnalité. Cet ouvrage de Michel Litalien en raconte l'histoire.
Acheter le livre en ligne chez Archambault
Le Québec et les guerres mondiales
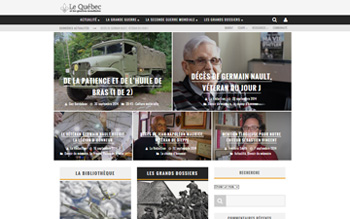
Le site Le Québec et les guerres mondiales explore l’histoire socio-militaire, politique, diplomatique et culturelle du Québec pendant la Grande Guerre (1914-1918) et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Il s'adresse au grand public, aux étudiants et aux milieux d’enseignement. Le lecteur y retrouvera diverses ressources, des nouvelles, des biographies et des témoignages de militaires, des ouvrages historiques, des sites et des activités reliés au sujet.
Depuis la cessation des activités de la Chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec (UQAM) en décembre 2008, dont un des axes de recherches portait sur les Canadiens français/Québécois face aux guerres, un lieu de rassemblement important pour les chercheurs de tous horizons , qu’ils soient universitaires ou évoluant en périphérie fut abandonné. Dans une perspective de continuité, Sébastien Vincent a créé le site Le Québec et les guerres mondiales qui se veut un complément aux différentes instances et initiatives déjà en place.
Visiter le site Le Québec et les guerres mondiales
Les Archives de Montréal et la Grande Guerre
Militaires du Black Watch (The Royal Highlanders of Canada) sur le Champ-de-Mars en novembre 1916 (Archives de la Ville de Montréal, VM6,S10,D1901.223-31)
Il y a maintenant 100 ans, la Grande-Bretagne entrait en guerre contre l’Allemagne, entraînant à sa suite le Canada et les autres dominions britanniques. Comment les Montréalais, partis au front ou demeurés au pays, ont-ils vécu ce terrible conflit, d’une intensité sans précédent? Les Archives de Montréal proposent une série de six articles de Nicolas Bedbarz qui présentent des traces émouvantes du passage de Montréal à travers cette époque troublée.
Voir les chroniques:
Chronique Montréal et la Grande Guerre : l’effort humain (1ère d’une série de 6)
Chronique Montréal et la Grande Guerre : le front raconté par Olivar Asselin à son jeune fils (2e d’une série de 6).
Chronique Montréal et la Grande Guerre : l’effort médical (3e d’une série de 6).
Chronique Montréal et la Grande Guerre : l’effort industriel (4e d’une série de 6).
Chronique Montréal et la Grande Guerre : et c’est la fin… (5e d’une série de 6).
Chronique Montréal et la Grande Guerre... à Pointe-à-Callière (6e d’une série de 6).
Souvenirs de la guerre 14-18 : les collections de l’Assemblée nationale

Souvenirs de la guerre 14-18 : les collections de l’Assemblée nationale est également une exposition virtuelle
Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec
Du 22 septembre 2014 au 4 septembre 2015
L’exposition Souvenirs de la guerre 14-18 : les collections de l’Assemblée nationale souligne le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale. Elle met en valeur les collections de l’Assemblée nationale liées à cet événement historique. C’est l’occasion de voir des documents parlementaires, du matériel de propagande, des photos d’époque et des objets ayant appartenu à des soldats. Vous découvrirez également quels sont les députés qui ont participé à la Grande Guerre.
Pour ceux et celles ne pouvant pas se déplacer sur les lieux de l'exposition, ou encore pour ceux et celles qui souhaiteraient poursuivre leur expérience d’apprentissage à la maison, une exposition virtuelle a été préparée par l'équipe de la bibliothèque. Les personnes intéressées pourront entre autres y feuilleter une sélection de livres rares numérisés et faciles à consulter
Cliquez ici pour connaitre les heures d’ouverture de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec
Cliquez ici pour visiter l’exposition virtuelle Souvenirs de la guerre 14-18 : les collections de l’Assemblée nationale préparée par l’équipe de la bibliothèque.
Coordonnées :
Assemblée nationale du Québec
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A3
Téléphone :
Région de Québec : 418 643-7239
Numéro sans frais : 1 866 DÉPUTÉS (1 866 337-8837)
Les langues autochtones du Québec : Un patrimoine en danger
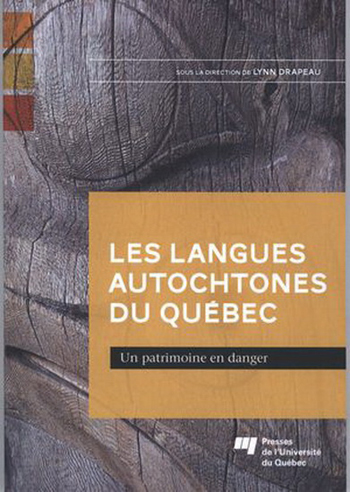
L'article The Unpaved Road du journaliste Blair McBride est publié dans le numéro de décembre/janvier du magazine Canada’s History. Il traite des efforts à sauvegarder les langues autochtones menacées au Canada. En complément, nous vous proposons la lecture d’un ouvrage collectif dirigé par Lynn Drapeau qui présente un état de la question de la situation des langues autochtones au Québec.
Résumé
Depuis Les langues autochtones du Québec, sous la direction de Jacques Maurais, publiées il y a vingt ans par le Conseil de la langue française, aucun ouvrage n’est venu faire le point sur la situation des langues autochtones au Québec, si bien qu’elles en sont venues en quelque sorte à disparaître de l’écran radar. La recherche sur les questions reliées à la langue et au répertoire oral en milieu autochtone est pourtant bien vivante. De nombreux partenariats entre des chercheurs universitaires et des représentants de l’une ou l’autre des Premières Nations ont notamment permis de réaliser des avancées remarquables.
Ce livre vient illustrer les progrès qui ont été accomplis au cours des dernières années en matière de conservation, de préservation, et même, de revitalisation des langues autochtones. Les études de cas présentées reflètent la diversité des situations et la complexité des enjeux auxquels les communautés autochtones sont confrontées. Alors que les problématiques sont diverses et abordées sous une multiplicité d’angles, le portrait composite qui s’en dégage permet d’avoir une vue d’ensemble nuancée et équilibrée. Il vient rappeler l’existence d’un patrimoine linguistique précieux qu’il convient de préserver de la disparition rapide qui le menace.
Lynn Drapeau et coll. Les langues autochtones du Québec : Un patrimoine en danger. Québec, Presses de l’Université du Québec, 2011. 236 pages
Acheter chez Renaud Bray
La controverse du drapeau

Cérémonie de lever du drapeau devant l’édifice du Parlement le 15 février 1967. Source: Bibliothèque et Archives Canada
Dans l’édition décembre/janvier 2014 du magazine Canada’s History, l’auteur et historien Allan Levine propose un article portant sur le débat entourant l’adoption d’un drapeau officiel pour le Canada. Pour les lecteurs intéressés par cette histoire, nous vous proposons de parcourir un dossier d’archives vidéo offert sur le site Web d’ICI Radio-Canada.ca.
Quel drapeau choisir?
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Caméra 64
Date de diffusion : 24 avril 1964
Durée : 56 secondes
Fernand Seguin raconte les deux solitudes
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Actualités politiques
Date de diffusion : 17 juin 1964
Durée : 4 minutes 05 secondes
Pearson présente son drapeau à Winnipeg
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Caméra 64
Date de diffusion : 24 avril 1964
Durée : 2 minutes 05 secondes
Pearson crée un comité pour choisir le drapeau
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Lester Bowles Pearson (radio)
Date de diffusion : 13 septembre 1964
Durée : 1 minute 29 secondes
Enfin un drapeau!
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Caméra 64
Date de diffusion : 20 décembre 1964
Durée : 4 minutes 16 secondes
Vox populi sur le choix d'un drapeau
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Aujourd'hui (1962-1969)
Date de diffusion : 14 décembre 1964
Durée : 1 minute 47 secondes
L'adoption officielle de l'unifolié
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Le Nouveau Drapeau canadien
Date de diffusion : 15 février 1965
Durée : 2 minutes 43 secondes
D'autres modèles de drapeaux pour le Canada
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Premier Plan
Date de diffusion : 23 janvier 1961
Durée : 2 minutes 03 secondes
Clip silencieux
Un drapeau arborant une feuille d'érable
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Caméra 64
Date de diffusion : 24 avril 1964
Durée : 28 minutes 19 secondes
Fernand Seguin et le drapeau canadien
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Actualités politiques
Date de diffusion : 17 juin 1964
Durée : 27 minutes 39 secondes
Drapeau canadien : retour sur un débat houleux
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Caméra 64
Date de diffusion : 20 décembre 1964
Durée : 28 minutes 19 secondes
Comment utiliser le drapeau
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Partage du jour
Date de diffusion : 11 février 1965
Durée : 6 minutes 09 secondes
Le nouveau drapeau canadien
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Le Nouveau Drapeau canadien
Date de diffusion : 15 février 1965
Durée : 28 minutes
Un an après l'adoption de l'unifolié
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Présent 2e édition nationale
Date de diffusion : 15 février 1966
Durée : 16 minutes 15 secondes
Histoire de l'adoption de l'unifolié
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Émission : Le Point
Date de diffusion : 14 février 1990
Durée : 12 minutes 34 secondes
Le nehlueun en héritage
Dans l’édition de décembre-janvier du magazine Canada’s History, Blair NcBride signe un article intitulé The Unpaved Road portant sur les efforts à sauvegarder les langues autochtones qui sont menacées au Canada. En complément, nous nous sommes intéressés aux Innus du Lac-Saint-Jean et à leurs efforts afin de protéger leur langue traditionnelle le nehlueun.Lors du dernier recensement, environ 200 personnes ont déclaré avoir le nehlueun comme langue maternelle au Canada. Nous vous proposons ici quelques ressources pour en savoir plus au sujet de ce combat engagé dans la communauté.
État de la situation :

Visionner le reportage intitulé La langue innue de Mashteuiatsh, préparé par la journaliste Sabrina Myre et présenté au Téléjournal/Saguenay-Lac-Saint-Jean le 21 novembre 2012 à ICI Radio-Canada (durée 5 minutes, 07 secondes).
La langue innue de Mashteuiatsh menacée
Apprendre le nehlueun :

Le site Web Nehlueun, langue des Pekuakamiulnuatsh rend possible l'apprentissage du nehlueun, langue ilnu de Mashteuiatsh grâce à des cours en ligne qui sont à la fois éducatifs, informatifs et ludiques.
Nehlueun, langue des Pekuakamiulnuatsh
Mobilisation de la nouvelle génération :
Wapikoni mobile — Innu aimun
Un très beau clip du groupe Uashtushkuau qui chante en innu l'importance de préserver les langues autochtones.
ONF – Corporation Wapikoni mobile – Les Productions des Beaux jours, 2008, 3 minutes 41 secondes.
Wapikoni mobile — Innu aimun par ONF, Office national du film du Canada
William Redver Stark, artiste et soldat de la Première Guerre mondiale

Hommes du 1er Bataillon des Troupes ferroviaires canadiennes construisant un pont [Carnet de croquis 11, folio 1r]
Dans l’édition février/mars 2015 du magazine Canada’s History, l’historien de l’art Jim Burant propose un article portant sur William Redver Stark, artiste-peintre et soldat de la Première Guerre mondiale. Pour les lecteurs qui souhaiteraient mieux connaître la vie et l’œuvre de Stark, nous vous proposons l’écoute d’une baladodiffusion réalisée et produite par l’équipe de Bibliothèque et Archives Canada.
L’archiviste en art Geneviève Morin et la restauratrice Lynn Curry discutent des antécédents du peintre, de son service à titre de soldat, de ses œuvres d’art et plus particulièrement les 14 cahiers de dessins qui font partie de son fonds.
Écouter la baladodiffusion William Redver Stark: le soldat et l’artiste
Consulter le fonds William Redver Stark et les documents connexes à Bibliothèque et Archives Canada
Montréal au temps de la variole

The first vaccination against smallpox, performed by Edward Jenner in 1796. A photogravure of an 1879 painting by Gaston Melingue.
Dans l’édition février/mars 2015 du magazine Canada’s History, l’auteur et historien médical Christopher J. Rutty propose un article portant sur les effets et conséquences de la variole à différents moments de l’histoire canadienne. En 1885, le Canada fut frappé par la pire épidémie de variole de son histoire. Rien qu'à Montréal, plus de 3000 personnes succombèrent à la maladie, dont une grande majorité d'enfants.
Pour compléter l'article de Rutty, nous vous proposons une baladodiffusion qui fut présentée par André Martineau à ICI Radio-Canada Première et qui raconte cet épisode méconnu de l’histoire montréalaise.
Écouter la baladodiffusion
1885 : Quand la vaccination provoquait l'émeute
Durée: 4 minutes
À REBOURS
Avec André Martineau | En semaine de 10 h 55 à 11 h
Combattez une épidémie de variole!

Montréal, 1885. La ville est aux prises avec un cas de variole qui risque de se transformer en épidémie si vous n'agissez pas rapidement! Quelles mesures allez-vous prendre? Quelles en seront les conséquences?
Pour compléter l'article de Christopher J. Rutty portant sur la variole, nous vous proposons un jeu interactif à la fois ludique et éducatif. L'épidémie de variole de 1885 a été réalisé pour les élèves du secondaire par Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal grâce au soutien du Fonds des partenariats de Patrimoine canadien et en partenariat avec l’agence Bob.
Jouer au jeu L'épidémie de variole de 1885
George-Étienne Cartier: le lion québécois de la Confédération

Une présentation spéciale du réseau CPAC
George-Étienne Cartier fut l'un des Pères de la Confédération canadienne. Parmi ses principales réalisations, notons la création des provinces et de la mise en place du Code civil du Québec. L’homme politique eut une influence majeure à Montréal et joua un rôle important dans le développement urbain et économique du Canada. Toutefois, peu de Canadiens connaissent l’héritage laissé par George-Étienne Cartier. Encensé par certains, qualifié de traitre par d’autres, le parcours de vie de Cartier a certes de quoi étonner lorsque nous le regardons de plus près.
En 2014, nous commémorions le bicentenaire de sa naissance. En route vers les célébrations entourant le 150e anniversaire de la Confédération en 2017, l'héritage laissé par Cartier sera également évoqué au cours des prochains mois. Pour en apprendre davantage au sujet du personnage historique, nous avons cru bon attirer votre attention vers un long reportage réalisé par la journaliste Danielle Young et diffusé par le réseau de télévision CPAC.
Intitulé George Étienne Cartier, le lion québécois de la Confédération, il propose entre autres une rencontre avec l’historien Brian Young, un spécialiste de Cartier, ainsi qu'une visite de la demeure montréalaise de Cartier en compagnie de David Ledoyen, guide au lieu historique national de Sir-George Étienne Cartier.
Visionner le reportage George Étienne Cartier, le lion québécois de la Confédération
Histoire de la caricature au Québec
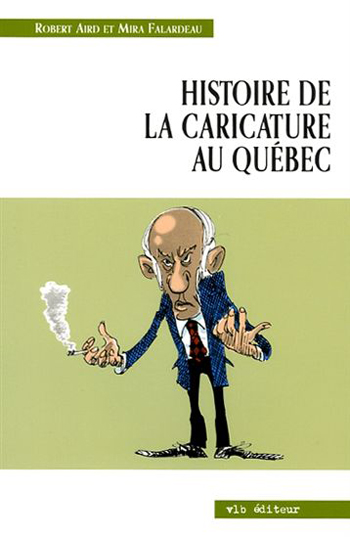
Résumé
Au Québec, la caricature est née en même temps que le journalisme, avec l'arrivée de l'imprimerie au début du régime anglais, et ces deux pratiques sont restées, depuis, indissociables. Le XIXe siècle a vu le foisonnement d'une infinité de journaux satiriques qui devaient une bonne part de leur succès aux caricatures qu'ils contenaient. Et quand la grande presse est apparue, elle a su, elle aussi, profiter de l'engouement du public pour ces dessins. La caricature a ainsi accompagné toutes les idéologies, tous les débats politiques, qui ont agité la société québécoise : on la retrouve aussi bien dans les feuilles fascistes de l'entre-deux-guerres que dans les publications syndicales militantes.
Ce livre, qui contient plus de 200 illustrations, est le premier à présenter l'histoire de cet art populaire de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Faire l'histoire de la caricature, c'est refaire l'histoire du Québec d'une façon qui replonge immédiatement le lecteur dans la vie sociale et politique du temps passé. Et ce parcours amusant offre aussi l'occasion de revisiter les œuvres d'artistes considérables : Jean-Baptiste Côté et Hector Berthelot, Henri Julien et Albéric Bourgeois, Robert LaPalme et Normand Hudon, Girerd et Berthio, Serge Chapleau et André-Philippe Côté.
Robert Aird et Mira Falardeau. Histoire de la caricature au Québec. Montréal, VLB Éditeur, 2010. 258 pages.
Acheter le livre en ligne chez Renaud Bray
Sans rature ni censure au McCord

Pour compléter l’article The Twisted Genius of George Feyer publié dans l’édition avril-mai du magazine Canada’s History, nous vous proposons la visite de l’exposition virtuelle intitulée Sans rature ni censure? Caricatures éditoriales du Québec, 1950-2000 préparée par le Musée McCord d’histoire canadienne.
Ce projet d’exposition a pour objectif d’offrir au public un accès privilégié à la remarquable collection de caricatures éditoriales du Musée McCord en plus de revaloriser les œuvres en rappelant à la mémoire les détails de certains événements politiques, sociaux et culturels qui ont inspiré les caricaturistes sur une période de 50 ans.
Les visiteurs pourront voir ou revoir des œuvres réalisées par les plus célèbres caricaturistes québécois, dont John Collins, Normand Hudon, Aislin (Terry Mosher), Serge Chapleau, Garnotte (Michel Garneau) et d’Éric Godin. Une visite de l’exposition Sans rature ni censure? Caricatures éditoriales du Québec, 1950-2000 vous plongera au cœur d’un monde ludique, artistique et riche en information, miroir de la société québécoise.
En terminant, il est important de noter que le Musée McCord a rendu accessibles au public sur son site Web plus de 20 000 caricatures réalisées entre 1759 et 2005 par une cinquantaine d’artistes.
Visiter l'exposition virtuelle Sans rature ni censure? Caricatures éditoriales du Québec, 1950-2000
Les Pays-Bas libérés

Dans l’édition avril mai 2015 du magazine Canada’s History, la journaliste Nelle Oosterom jette un regard personnel sur l’épisode de la libération des Pays-Bas lors de la Seconde Guerre mondiale dans un article intitulé Lasting Liberation. En complément à cet article, nous vous proposons le visionnement de documents audio et vidéo portant sur le sujet.
1 - Chants de victoire aux Pays-Bas
Émission : Reportage sur le cardinal Léger
Société Radio Canada
Date de diffusion : 8 mai 1945
Durée : 6 minutes 49 secondes
Ce reportage de Marcel Ouimet montre la reconnaissance des Hollandais envers les forces alliées pour la libération de leur pays. Le correspondant de guerre laisse la parole à un citoyen de La Haye qui souhaite exprimer sa gratitude aux militaires canadiens, anglais et américains, vainqueurs des armées de Hitler en Hollande.
Entendre le reportage
2 - La libération des Pays-Bas par Anciens Combattants Canada
À l’occasion du 70e anniversaire de la libération des Pays-Bas, le gouvernement du Canada organise des activités commémoratives à l’intention de sa délégation officielle qui sera aux Pays-Bas du 3 au 9 mai 2015. Une page Web consacrée à cet anniversaire a été préparée par Anciens Combattants Canada. On y trouve un choix de ressources et de documents d’archives.
Visiter La libération des Pays-Bas par Anciens Combattants Canada
3 - Des héros se racontent : la libération des Pays-Bas
La libération des Pays-Bas, entre septembre 1944 et avril 1945, a marqué un point culminant de la Seconde Guerre mondiale alors que les Alliés réussirent à bloquer l'Allemagne de tous les côtés. La Première armée canadienne était en première ligne lors de la libération du peuple néerlandais, qui vivait en captivité dans son propre pays, et qui souffrait de la famine et d'autres privations sous le contrôle des Allemands de plus en plus désespérés.
Anciens Combattants Canada
Des héros se racontent : la libération des Pays-Bas
Durée : 9 minutes et 11 secondes
,
4 - Jocelyn Major et Miguel Tremblay racontent Léo Major
Léo Major a libéré à lui seul la ville de Zwolle, aux Pays-Bas, à la suite du débarquement, en juin 1944. Il est le seul soldat canadien à avoir reçu deux médailles de conduite distinguée.
Miguel Tremblay est féru d'histoire militaire. Il a découvert l'histoire de Léo Major sur Internet et a depuis démarré une page Facebook en son honneur. Il croit que l'on connaît trop mal nos héros militaires québécois. Dans le cadre de son émission Médium large diffusée à l’antenne d’Ici Radio-Canada Première, Catherine Perrin a rencontré Miguel Tremblay et Jocelyn Major, petit-fils de Léo Major, pour en apprendre davantage au sujet de ce héros méconnu.
Jocelyn Major et Miguel Tremblay racontent Léo Major
Diffusé le 12 novembre 2012 à 9 h 15
Médium large – Ici Radio-Canada Première
Durée: 18 minutes 30 secondes
Entendre l'entrevue de Catherine Perrin
McCrae au champ d'honneur

Le lieutenant-colonel John McCrae et son chien Bonneau, circa 1914.
Au Champ d'honneur*
(Adaptation du poème: In Flanders Fields, de John McCrae)
Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
Nous sommes morts
Nous qui songions la veille encor'
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici
Au champ d'honneur.
À vous jeunes désabusés
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.
*Adaptation française du major Jean Pariseau
Musée McCord
John McCrae au champ d'honneur
Stephen Robinson et Tracie Seedhouse Robinson Heritage Consulting et les Guelph Museums
Parcourir le circuit Web
Clip vidéo
Pour en savoir plus :
Société Histoire Canada – Album de la Grande Guerre
Musée canadien de la guerre
Anciens Combattants Canada
Mémorial virtuel de guerre du Canada
La Magna Carta au Canada pour célébrer son 800e anniversaire
Nous célébrons cette année le 800e anniversaire de la Magna Carta. La Grande Charte et son document d’accompagnement, la Charte de la forêt, seront présentés au public dans quatre villes du Canada, du 11 juin au 29 décembre 2015. Ils seront exposés à Ottawa, à Toronto, à Winnipeg et à Edmonton.
Magna Carta Canada a créé un site Web afin de souligner l’événement, préparer la visite de l'exposition et renseigner les Canadiens au sujet de l’importance de ces documents dans l’histoire.
Visiter Magna Carta 2015 Canada
Pour ceux et celles qui aimeraient apprendre davantage au sujet de la Magna Carta, vous pouvez consulter l’article The Great Charter de l’historien Christopher Moore publié dans l’édition juin-juillet du magazine Canada’s History.
Augustin Le Bourdais

Augustin Le Bourdais.
Dans l’édition juin-juillet du magazine Canada’s History, Patricia Kirby signe un article portant sur son ancêtre le marin Augustin Le Bourdais. Parce qu’il fut en 1871 le seul survivant d’un légendaire naufrage aux Iles-de-la-Madeleine, Le Bourdais demeure encore aujourd’hui un personnage coloré qui habite l’imaginaire des conteurs québécois.
Pour compléter l’article de Patricia Kirby, nous vous proposons de découvrir Le Bourdais à travers les yeux du conteur André Vigneau.
Le rôle des femmes canadiennes pendant la Première Guerre mondiale

Pour l’édition juin-juillet du magazine Canada’s History, Christa Thomas a signé un article intitulé Angels Behind the Wheel portant sur les femmes ambulancières en Europe lors de la Première Guerre mondiale. Avec ce conflit, le rôle et le statut des femmes commencèrent à changer. Cette guerre constitua un moment charnier dans l’histoire des femmes canadiennes. Pour compléter l’article de Thomas, nous vous proposons un conte cartographique préparé par Esri Canada. Le conte est accompagné par une activité pédagogique.
Voir le conte cartographique Le rôle des femmes canadiennes pendant la Première Guerre mondiale
Activité pédagogique
Dans le cadre d’une activité créée par Esri Canada, vous allez explorer l'évolution et la contribution du rôle des femmes canadiennes sur le front intérieur et outre-mer pendant la Première Guerre mondiale à travers des documents de source primaire telles que des photographies, des lettres, des peintures et des annonces publicitaires.
Voir l’activité pédagogique
La course vers le pôle Nord

Inuits observant l'arrivée du C.D. Howe, patrouilleur de la région est de l'Arctique.
Dans l’édition juin-juillet 2015 du magazine Canada’s History, dans un article intitulé Who Found the Northwest Passage? Ken McGoogan fait un retour cent ans en arrière pour démystifier les explorations liées à la découverte du passage du Nord-Ouest.
En complément à cet article, nous vous proposons le visionnement d’une courte vidéo préparée par l’équipe de l’émission Découverte, l'écoute d'une capsule radiophonique portant sur l’explorateur Roald Amundsen diffusée dans le cadre de l'émission À rebours et le visionnement d’un film de fiction créé en 1912 par le réalisateur Georges Méliès et qui montre toute la frénésie entourant la découverte d’une nouvelle route maritime vers le Nord.
À la conquête du passage du Nord-Ouest
Découverte, Ici Radio-Canada Télé
Diffusion : 28 juin 2009
Voir le reportage
André Martineau raconte les explorations polaires de Roald Amundsen
À rebours, Ici Radio-Canada Premières
Diffusion : 14 décembre 2012
Écouter la capsule radio
À la Conquête du pôle
Réalisateur : Georges Méliès
1912, Europea Film Treasures, 30 minutes
La Magna Carta, son importance pour le Canada
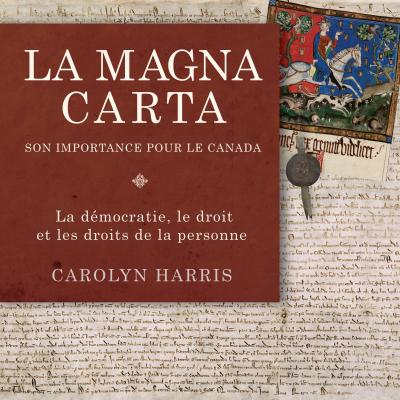
Carolyn Harris. La Magna Carta, son importance pour le Canada : la démocratie, le droit et les droits de la personne. Toronto. Dundurn. 2015.
Résumé :
La Magna Carta avait été conçue au départ dans le but d’assurer que le roi Jean respecte les us et coutumes de la noblesse au XIIIe siècle. Au cours des huit cents années qui se sont écoulées depuis sa création, elle est devenue la pierre angulaire des idéaux de la démocratie pour tous. La « Grande Charte » a inspiré de nombreux documents portant sur le respect des droits de la personne, y compris la Déclaration d’indépendance des États-Unis, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de la France, et la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies.
Pour les Canadiens, la Magna Carta a servi de modèle pour d’importants documents, depuis la Proclamation royale de 1763, qui a façonné les colonies britanniques de l’époque et les relations de celles-ci avec les Premières Nations, jusqu’à la Charte des droits et libertés. La Magna Carta : son importance pour le Canada est une célébration des huit cents années d’existence du document ainsi que de son influence sur le Canada et le monde entier.
Acheter chez Archambault
Le sort de l'Amérique
Dans l’édition août-septembre du magazine Canada’s History, l'historien D. Peter MacLeod propose un article intitulé Empire Lost. Il porte sur les tenants et aboutissants de la prise de Québec par les Anglais lors de la bataille des plaines d’Abraham.
En complément à cet article, nous vous proposons le visionnement d’un documentaire marquant produit par l’Office national du film du Canada. Projeté sur les écrans en 1996, Le sort de l’Amérique de Jacques Godbout est encore tout aussi pertinent près de 20 ans après sa sortie. Dans son film, Godbout cherche à comprendre les Canadiens furent vaincus, conquis ou abandonnés en 1759.
Un retour vers le passé comme si vous y étiez... ou presque!
Le sort de l’Amérique
Office national du film du Canada
Jacques Godbout, 1996, 81 minutes 28 secondes
Après la bataille des plaines d'Abraham, le 13 septembre 1759, le monde ne sera plus jamais le même. Tout pays est fondé sur un mythe, le Canada est né de cette guerre entre la France et l'Angleterre où les deux généraux qui s'affrontaient, le marquis de Montcalm et James Wolfe, sont morts de leurs blessures.
Le sort de l'Amérique par Jacques Godbout, Office national du film du Canada
La Guerre de Sept Ans en Nouvelle-France
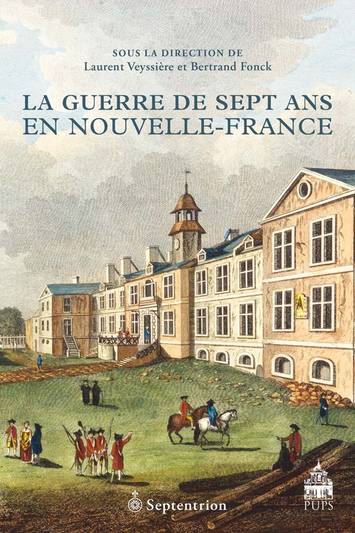
Laurent Veyssière et Bertrand Fonck, dir. La Guerre de Sept Ans en Nouvelle-France. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2012. 400 pages.
Résumé:
La chute de Québec en 1759 et la capitulation de Montréal l'année suivante sonnèrent le glas de la Nouvelle-France et d'un long conflit. C'est en Amérique du Nord que la guerre de Sept Ans a commencé et qu'elle a provoqué les bouleversements décisifs entérinés par le traité de Paris de 1763, portant un coup fatal au premier empire colonial français.
Derrière les enjeux diplomatiques auxquels on réduit trop souvent ce qui fut l'une des premières guerres mondiales de l'histoire, des hommes ont combattu pour défendre ou conquérir un territoire sur lequel se livra une guerre différente de celle pratiquée en Europe. La rudesse du climat, l'immensité du théâtre d'opérations, la guerre à la canadienne et les alliances amérindiennes forcèrent les troupes venues d'Europe à s'adapter, avec plus ou moins de réticence et de succès. Au-delà des interrogations qui subsistent sur la responsabilité d'un Montcalm ou les mérites d'un Wolfe, ces combats et les hommes qui les livrèrent méritaient qu'on porte sur eux un nouveau regard.
Cet ouvrage collectif, réunissant les contributions d'historiens et de conservateurs français, anglais, canadiens et américains, explore différentes facettes du conflit et étudie tant la stratégie des belligérants et l'expérience vécue par les combattants que l'évolution du contexte mémoriel hérité de la guerre de la Conquête. S'appuyant sur les recherches les plus récentes et tentant de répondre aux ambitions de l'histoire totale du fait militaire, il se veut enfin un bilan historiographique sur la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France.
Acheter chez Renaud Bray
Montréal nucléaire dans un monde en guerre

Dans l’édition août/septembre 2015 du magazine Canada’s History, l’auteur et historien Ron Verzuh propose un article portant sur l’histoire méconnue d’une entreprise de la Colombie-Britannique qui participa au projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Au même moment dans l’est du pays, à Montréal, dans un secret absolu, des chercheurs de l’Université de Montréal étudiaient la pile atomique.
Pour compléter l'article de Verzuh, nous vous proposons l’écoute d’une entrevue radiophonique diffusée à la radio de Radio-Canada et réalisée avec Pierre Demers, un acteur de premier plan de ces recherches. Monsieur Demers lève le voile sur cet épisode méconnu de l’histoire montréalaise.
Écouter la baladodiffusion
Un laboratoire nucléaire secret à Montréal
Date de diffusion : 9 février 1980
Durée: 20 minutes et 15 secondes
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Fantastiques monstres marins
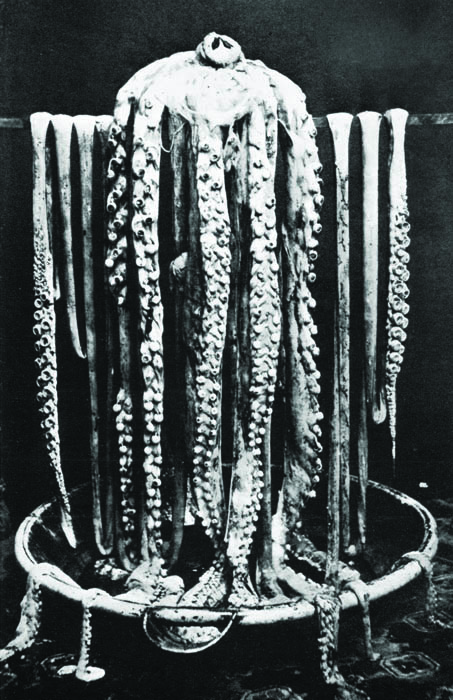
La carcasse d’Architeuthis obtenue par le Rev. Moses Harvey en 1873. La photo est le première connue d’un calmar géant.
Pour compléter l’article intitulé The Devilfish of Newfoundland de l’auteur et journaliste J.R. McConvey publié dans le numéro août/septembre du magazine Canada’s History, nous vous proposons la visite du site Web Fantastiques montres marins créé par le Musée du fjord en partenariat avec l’équipe de la Société The Room de Terre-Neuve-et-Labrador et l’équipe du Musée de la Colombie-Britannique. En plus d'en apprendre davantage au sujet du légendaire calmar géant de Terre-Neuve, vous pourrez découvrir les histoires de créatures marines fascinantes ayant marqué l'histoire canadienne.
Visiter le site Web Fantastiques monstres marins
Lacorne Saint-Luc
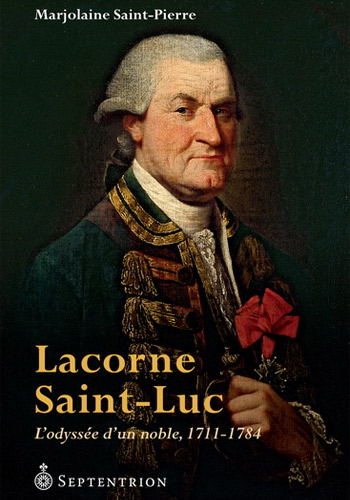
Marjolaine Saint-Pierre. Lacorne Saint-Luc : L’Odyssée d’un noble, 1711-1784. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2013. 408 pages.
Officier du roi en Nouvelle-France, chevalier de la croix de Saint-Louis, Lacorne Saint-Luc fut un agent de liaison de grande influence auprès des tribus indiennes alliées. Également riche commerçant de Montréal, il connut une des carrières les plus éclatantes de la fin du Régime français en Amérique au milieu du xviiie siècle. Sa forte personnalité, son ambition, son talent et ses succès ne laissaient personne indifférent. Les Amérindiens et les Canadiens le respectaient et l’admiraient tandis que les Anglais et les Américains le craignaient et le qualifiaient de «fieffé coquin aussi malin que le diable».
Après la capitulation de la Nouvelle-France, Lacorne Saint-Luc dut se préparer à l’inévitable: un exil forcé vers la France. Le vieux navire affrété par les autorités anglaises fit malheureusement naufrage le 15 novembre 1761. Lacorne Saint-Luc était des sept rescapés. Sa longue marche de trois mois du Cap-Breton à Québec, au plus fort de l’hiver, toucha beaucoup de gens, même ses pires ennemis. Le récit de son périple lui assura une place de choix parmi les figures héroïques des annales historiques de notre nation, au même titre que d’Iberville, La Vérendrye ou Lévis.
Acheter chez Renaud Bray
En septembre 2015, abonnez-vous au bulletin d’information Histoire à suivre et courez la chance de gagner ce livre!
Abonnez-vous à Histoire à suivre!
Nettoyer Montréal: Les campagnes de moralité publique, 1940-1954

Mathieu Lapointe. Nettoyer Montréal : Les campagnes de moralité publique, 1940-1954. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2014. 400 pages.
Corruption, collusion, morale douteuse, Montréal doit assainir ses mœurs politiques. Nous sommes dans la décennie 1940-1950, alors que des groupes de citoyens luttent, en vain, pour la tenue d’une enquête publique sur la tolérance policière des maisons de prostitution, de jeu et de pari. C’est alors qu’entre en scène un dénonciateur-vedette, l’avocat Pacifique «Pax» Plante, ancien directeur adjoint de la police, qui accuse les plus hautes autorités municipales de corruption et de complicité avec la pègre.
Mathieu Lapointe retrace la révélation graduelle du scandale au fil des reportages et des enquêtes, en resituant les événements dans leurs contextes tant locaux que nord-américains, à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la première élection à la mairie de Jean Drapeau en 1954.
Acheter chez Renaud Bray
En octobre 2015, abonnez-vous au bulletin d’information Histoire à suivre et courez la chance de gagner ce livre!
Abonnez-vous à Histoire à suivre!
Thérèse Casgrain et le droit de vote des femmes
Pour en savoir plus au sujet de Thérèse Casgrain:
Pour compléter l’article intitulé Winning Back the Vote de l’auteur et journaliste Cec Jennings publié dans le numéro octobre/novembre du magazine Canada’s History, nous vous proposons de visionner un extrait d’entrevue réalisée avec Thérèse Casgrain et diffusée à la télévision de Radio-Canada en 1963. Madame Casgrain était une militante féministe de la première heure qui a lutté pendant de nombreuses années pour que les femmes québécoises puissent obtenir le droit de voter. Toute sa vie fut consacrée à des actions politiques, sociales et syndicales.
Thérèse Casgrain et le droit de vote des femmes
Les Archives de Radio-Canada
Société Radio-Canada
Date de diffusion: 7 juin 1963

Nicolle Forget. Thérèse Casgrain : la gauchiste en collier de perles. Montréal, Les Éditions Fides, 2013. 552 pages.
Acheter chez Renaud Bray
Moments marquants

Agnes MacPhail
Pour souligner le 100e anniversaire de l’obtention du droit de vote par les femmes au Canada, nous aimerions porter à votre attention cet excellent documentaire réalisé par la chaîne de télévision CPAC. Présenté dans le cadre de la série Moments marquants, il nous fait découvrir les initiatives qui ont permis aux Canadiennes d’obtenir enfin le droit de vote.
Visionner Moments marquants - L'histoire du vote - le droit de vote des femmes
Patrilinéaire, mitochondriale et agnatique : trois façons de faire votre généalogie!
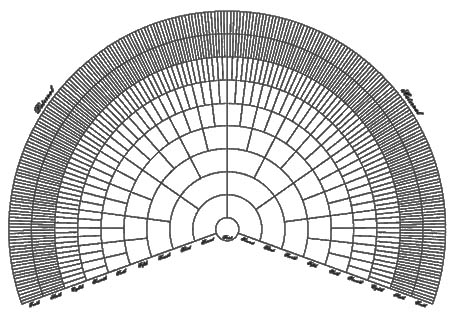
Faire sa généalogie est l’occasion de plonger dans sa propre histoire et de voyager à travers l’espace, le temps et les mœurs. Sous la casquette de l’enquêteur, on dépèce et épluche les registres d’antan, décode des informations complexes et recompose des récits de vie parfois touchants, surprenants, voire emplis de gloire. Avant d’avoir procédé à ces recherches, il est difficile de savoir si l’un de nos ancêtres lointains est un noble privé de sa terre, un briquetier tapageur, un criminel repenti ou un héros de guerre. Trois façons de faire s’offrent à l’individu ayant soif de passé qui veut se lancer dans la généalogie : les méthodes patriarcale, mitochondriale et agnatique.
La manière la plus connue — et généralement la plus aisée — de reconstruire son ancestralité est la généalogie patrilinéaire. Elle consiste à remonter le fil de l’histoire de fils en père en se donnant pour base de travail un nom de famille. Cependant, plusieurs embûches se dressent sur la route de l’amateur. La première est simplement la fantaisie orthographique des annalistes d’antan — qu’ils soient prêtres ou notaires —, qui mutilent les patronymes en les affublant de lettres supplémentaires ou même de syllabes déformées au gré des accents régionaux. La seconde est la prééminence d’un surnom, au détriment du nom de famille connu en aval des générations. Notre ancêtre brouille ainsi ses propres empreintes historiques, au grand malheur de ceux qui s’intéressent à lui. Heureusement, quelque consciencieux rédacteur d’antan aura noté à la fois le sobriquet et le legs patronymique. En procédant de fils en père (et en mère), la généalogie patriarcale recomposée aura la forme d’une échelle à remonter dans le temps, où chaque barreau correspond à une génération plus ou moins bien révélée par les traces qu’elle a laissées. Bien souvent, cette forme de recherche fait office de mise en bouche pour l’étape suivante : la généalogie mitochondriale.
Puisque nos traits génétiques sont hérités en parties égales de notre père et de notre mère, la généalogie mitochondriale — également nommée matrilinéaire — devient un incontournable lorsque vient le temps de terminer un arbre de famille. Il s’agit alors, parfois contre l’instinct induit par une société historiquement patriarcale, de remonter le courant des gènes par les femmes, de fille en mère. Si les mœurs de nos ancêtres avaient donné aux fils le nom de leur génitrice, le paysage patronymique — il serait en fait matronymique — différerait complètement de celui que nous connaissons. Le défi posé par la généalogie par les femmes est considérable : le nom de famille change alors à chaque génération, ce qui n’empêche pas qu’il ait pu être malmené ou supplanté par un surnom. Le résultat de la généalogie mitochondriale est semblable par la forme à la généalogie patrilinéaire. En outre, l’impact de femmes prolifiques est plus facilement visible — on peut alors penser aux fameuses Filles du Roy, ces orphelines françaises volontaires à immigrer au Nouveau-Monde pour peupler la colonie française.
La conjugaison des généalogies patriarcale et mitochondriale résulte en un arbre généalogique complet, c’est-à-dire une reconstitution entière de nos patrimoine et matrimoine génétiques. L’arbre ainsi obtenu peut avoir la forme d’un éventail de demi-cercles concentriques à la fois pénible et fascinant à compléter (vous trouverez un canevas de base imprimable et en grand format ici) Il surviendra presque inévitablement des recoupements entre les ramifications, et parfois beaucoup plus rapidement que l’on pense. Il était en effet commun de se marier entre petits cousins, il n’y a pas si longtemps. Si l’on ne rencontre aucun recoupement, on devra dénombrer 2^10 ancêtres différents à la dixième génération, soit 1 024 individus ! Au quinzième palier, vers la moitié du XVIIe siècle, se retrouveront au plus 32 768 personnes, total dix fois supérieur à la population « canadienne » de l’époque.
Le généalogiste en manque de défi pourra se lancer ensuite dans la généalogie agnatique. Celle-ci consiste à partir de l’ancêtre de son choix, qu’il soit homme ou femme, et de faire la liste de ses descendants. Cela est d’autant plus intéressant lorsque le point de départ est une femme, car son nom n’aura généralement pas été transmis aux générations suivantes, ce qui permet de découvrir les liens de parenté entre différentes familles. Peut-être partagez-vous le même ancêtre que Madonna, Sydney Crosby ou Jim Carrey, qui sait ? De plus, les différences démographiques intergénérationnelles apparaissent clairement en utilisant cette méthode. Vous serez sans doute surpris du nombre d’enfant qu’ont eus vos aïeuls, ou du nom que ceux-ci ont donné à leur progéniture !
Qu’importe la méthode choisie, la généalogie révèle les itérations quasi inévitables de nos ancêtres. En raison d’une contrainte financière, d’un désir d’aventure ou d’une histoire d’amour, beaucoup de nos aïeuls étaient de grands voyageurs, parcourant des milliers de kilomètres à pied, à cheval ou en train pour accomplir leur destinée. Ainsi, chaque arbre généalogique constitue un roman historique où des personnages plus grands que nature s’assemblent et assemblent du même coup l’histoire canadienne telle que nous la connaissons.
Les 10 principales raisons pour lesquelles les femmes n'avaient pas le droit de vote
Il y a seulement un siècle, les femmes canadiennes obtenaient le droit de vote aux élections générales — d’abord au Manitoba, puis dans d’autres provinces et au fédéral. La lutte pour le suffrage féminin a été livrée pendant plusieurs décennies au Canada, aux États-Unis et en Europe. En Grande-Bretagne, le droit de vote aux femmes a été le sujet de débat pas moins de dix-huit fois à la Chambre des Communes en 1970 et 1904.
La question du suffrage féminin était un sujet de conversation populaire à cette époque. Voici dix des raisons pour lesquelles les femmes ne devaient pas voter, selon les détracteurs du droit de vote aux femmes.
1. L’argument biblique
Certains membres influents du clergé avançaient que la « loi naturelle » — telle que décrite dans la Bible chrétienne — statuait sans doute possible la subordination des femmes aux hommes.
2. Trop faibles
Les femmes ne possèdent pas la force physique des hommes, et ne pouvaient donc pas d’adonner à la politique, une discipline parfois rude et difficile.
3. Un vote redondant
Comme une femme mariée a fait le vœu d’obéir à son mari, son vote serait donc le même que celui de son époux. Cela donnerait simplement deux votes à un homme marié.
4. Une trop grande distraction
Le droit de vote éloignerait les femmes de leur devoir de ménagère et de mère.
5. Trop vulnérables
Si les femmes obtiennent le droit de vote, elles seraient égales aux hommes, et ne pourraient plus bénéficier de leur protection. Trop faibles pour se défendre elles-mêmes, les femmes seraient alors oppressées.
6. Trop instables
Les femmes seraient surexcitées par la politique et subiraient des dépressions nerveuses.
7. Trop occupées
Les femmes sont — ou devraient être — trop occupées par leurs tâches ménagères à la maison pour prendre part au jeu politique.
8. Trop fragiles
Si les femmes étaient sur la liste électorale, elles seraient également obligées d’être jurés si on leur demandait, et entendraient des choses que les femmes ne devraient pas entendre — comme des crimes sexuels.
9. Trop peu instruites
Les femmes ne connaissent rien à l’éconimie, au commerce, à la science, à la finance, à la guerre ou aux lois, et ne peuvent donc pas contribuer à la politique.
10. Ce serait indigne d’une dame
Les femmes seraient endurcies et souillées par la politique, et deviendraient masculines et non-féminines.
La légende de la chasse-galerie

La chasse-galerie de Charles Vinh
Dans l’édition décembre 2015 / janvier 2016 du magazine Canada’s History, André Pelchat signe un article ayant pour titre Sorcery in New France. Pelchat dévoile des histoires de magie noire et de phénomènes étranges qui ont grandement influencé la fantasmagorie présente dans les contes et légendes du Canada français.
La chasse-galerie, un de ces contes nés de la tradition orale, a pu traverser le temps grâce à une version écrite publiée en 1892 par Honoré Beaugrand. Dans cette histoire, un groupe de bûcherons isolés en forêt scella un pacte avec le diable afin de voyager rapidement en direction de leur village à bord d’un canot volant pour retrouver leur bien-aimée le soir de la Saint-Sylvestre. En aucun temps, ils ne devaient invoquer Dieu ou toucher le clocher d'une église. La perte de leur âme était le prix à payer.
Pour en savoir plus au sujet de ce conte ou le découvrir, nous proposons quelques pistes à explorer.
Film d’animation :
La légende du canot d'écorce
Office national du Film du Canada
Robert Doucet, 1996, 10 min 37 secondes
Un court métrage d'animation inspiré par La légende du canot d'écorce, mieux connue sous le nom de La chasse-galerie. Publié pour la première fois en 1891 par Honoré Beaugrand, ce conte folklorique raconte l'histoire de bûcherons qui, partis travailler dans un camp isolé dans la vallée de la rivière Gatineau pour l'hiver, concluent un pacte avec le diable pour pouvoir passer la veille du jour de l'An auprès de leurs parents et amis.
La légende du canot d'écorce par Robert Doucet, Office national du film du Canada
Cinéma :
 Chasse-Galerie : La légende
Chasse-Galerie : La légende
Réalisation: Jean-Philippe Duval
Producteur: Christian Larouche et Réal Chabot
Avec: Caroline Dhavernas, Francis Ducharme, François Papineau, Vincent-Guillaume Otis, Samian, Fabien Cloutier et Hubert Proulx
Synopsis:
Fin d'été à Lavaltrie, à la fin du 19e siècle. Ancien foreman de chantier forestier, Joe Farrel est maintenant un agriculteur aux grandes ambitions. Il est amoureux de Liza Gilbert, la mercière du village. Ils se marieront au printemps et vivront enfin leur idylle au grand jour. Mais des forces occultes semblent bientôt s'opposer à leur bonheur: un incendie suspect, un notaire douteux ? Transi d'amour pour Liza ?, et cet inquiétant étranger qui vient de débarquer à l'Hôtel central... Risquant de tout perdre, Joe est forcé de retourner aux chantiers, inconscient du complot maléfique qui s'ourdit contre son bonheur. L'hiver est rude et le chantier semble maudit. Liza se languit, sans nouvelles de son amour. Elle ne se doute pas que c'est elle sur qui le Malin a décidé de jeter son dévolu, en vertu d'une vieille rancune, un pacte maléfique brisé vingt-deux ans plus tôt... par son propre père. La veille du jour de l'an, Joe devra placer sa confiance en un traître et pactiser lui-même avec le Malin, afin de sauver tout ce qui lui est cher... S'il n'est pas déjà trop tard...
Chanson québécoise
 Chasse-galerie
Chasse-galerie
Album Fable d’espace
Artiste: Claude Dubois
Chasse-galerie c’est aussi une chanson popularisée en 1978 par le chanteur québécois Claude Dubois.
Acheter chez Archambault
Lecture:
Honoré Beaugrand. La chasse-galerie et autres récits. Montréal, Les éditions du Boréal, 2002. 188 pages.
 Résumé:
Résumé:
Reprend le texte des 5 récits de l'édition originale parue en 1900 ainsi que les illustrations signées Henri Julien, Henry Sandham et Raoul Barré. Ces histoires reposent sur une croyance populaire remontant à l'époque des coureurs de bois et des voyageurs du Nord-Ouest.
Acheter chez Renaud Bray
Vincent Vanoli. La Chasse-galerie. Montréal, Les éditions de la Pastèque, 2011. 40 pages
 Résumé:
Résumé:
Vincent Vanoli s'est attaqué à une ouvre fondamentale de la littérature québécoise. Ce récit d'Honoré Beaugrand, qui nous raconte comment des bûcherons retrouvent leurs blondes la veille du jour de l'An après un pacte avec le diable, est illustré d'une façon magistrale grâce au regard vierge de l'auteur et à son trait expressionniste qui rappelle l'art de l'estampe.
Acheter chez Renaud Bray
Le Québec et l’Irlande: Histoire, culture, identité
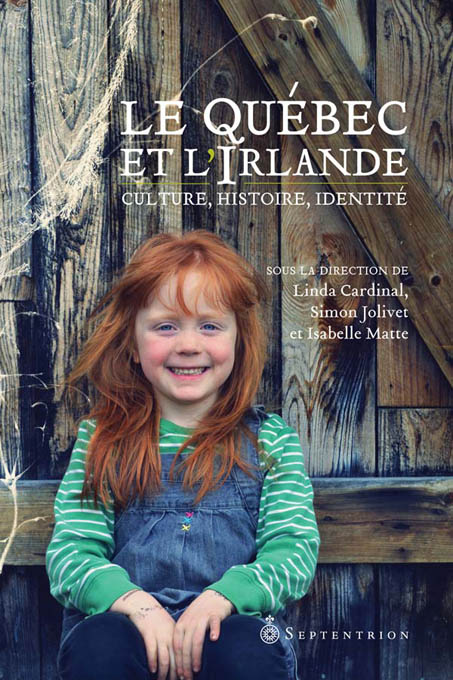
Simon Jolivet, Isabelle Matte et Linda Cardinal. Le Québec et l’Irlande : Histoire, culture, identité. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2014. 298 pages.
Le Québec et l’Irlande ont beaucoup en commun. La quête politique pour se sortir de l’Empire britannique, un catholicisme longtemps omniprésent et la lutte pour préserver la langue nationale sont autant d’éléments qui en font des sociétés comparables. De plus, les Irlandais font partie du paysage démographique du Québec depuis deux cents ans. Jusqu’au début des années 1900, ils y étaient plus nombreux que les Anglais, les Écossais ou tout autre groupe ethnoculturel, exception faite des Canadiens français. Majoritairement catholiques, ils ont profondément influencé la société: non seulement les traces de cette présence irlandaise sont palpables dans l’histoire, mais on peut encore les remarquer dans la culture, qu’elle soit musicale, littéraire, cinématographique, religieuse ou politique.
Les auteurs nous apprennent, entre autres, que la Société Saint-Patrick de Montréal a été fondée par des Irlandais protestants en 1834 pour contrer les aspirations des Patriotes, alors que d’autres Irlandais, tel Daniel Tracey, les appuyaient. L’Irlande et les Irlandais ont continué de marquer la société après 1960, en alimentant les productions des géants du monde cinématographique et littéraire québécois que sont André Forcier, Gilles Carle, Victor-Lévy Beaulieu et Jacques Ferron. Ce livre est donc une occasion unique de redécouvrir l’empreinte que l’Irlande et les Irlandais ont laissée au Québec ainsi que les liens qui unissent les deux nations.
Acheter chez Renaud Bray
En novembre 2015, abonnez-vous au bulletin d’information Histoire à suivre et courez la chance de gagner ce livre!
Abonnez-vous à Histoire à suivre!
Expédition : l'Arctique
Dans l’édition décembre 2015 / janvier 2016 du magazine Canada’s History, l’auteure et journaliste Kate Jaimet propose un article portant sur la grande expédition dans l’Arctique qui se déroula de 1913 à 1918. Madame Jaimet s’est particulièrement intéressée au rôle joué par les Inuits lors de ces grandes explorations. Pour compléter l’article, nous vous proposons de parcourir différentes ressources préparées par le Musée canadien de l’histoire, des ressources riches en informations, en images d’archives et en documents historiques de toutes sortes.
Du 21 avril 2011 au 15 avril 2012, le Musée présenta une exposition intitulée Expédition : l’Arctique. Un site web complémentaire à l’exposition fut alors conçu pour l’occasion. Visiter le site Web

Toujours dans le cadre du centenaire de cette expédition, une exposition virtuelle a été préparée conjointement par le Musée canadien de l’histoire, le Musée canadien de la nature, Parcs Canada et la Commission géologique du Canada. Visiter l’exposition virtuelle intitulée Peuples et connaissances du Nord et les histoires

Enfin, toujours dans l’objectif de documenter et souligner le centenaire de cette expédition, l’équipe du musée a réalisé une série de vidéos éducatives portant sur différents sujets.
Stefansson, Dr. Anderson and the Canadian Arctic Expedition, 1913--1918 par Stuart E. Jenness.
Expédition : l'Arctique // Les cultures locales
Expédition : l'Arctique // Technologie de 1913
Expédition : l'Arctique // Découverte de la géographie
Expédition : l'Arctique // La science et les spécimens
La bataille d’Angleterre

Lors de la Seconde Guerre mondiale, la bataille d’Angleterre fut la première opération à laquelle participa l’Aviation royale du Canada. Bien que la contribution canadienne fût de faible ampleur comparativement aux opérations suivantes, plus de 100 Canadiens ont néanmoins participé à la bataille. Environ 300 Canadiens ont également servi parmi les équipes au sol.
Dans l’édition décembre 2015 / janvier 2016 du magazine Canada’s History, l’historien Joel Ralph propose un article complet portant sur cette bataille. Pour ceux et celles qui aimeraient en apprendre davantage au sujet cette opération militaire, voici quelques documents à consulter.
Office nationale du film du Canada
La forteresse de Churchill
Stuart Legg, 1941, 22 minutes
Premier film de l'ONF à gagner un Oscar®, ce documentaire évoque la stratégie de la bataille d'Angleterre. On y voit la Royal Air Force du Royaume-Uni lors de la bataille épique contre la Luftwaffe, l'armée de l'air du IIIe Reich allemand. Tout est mis en branle pour la défense : la marine, la garde côtière, la cavalerie et l'armée civile.
La forteresse de Churchill par Stuart Legg, Office national du film du Canada
Aviation royale canadienne
L’Aviation royale canadienne propose une section au sujet de la bataille d’Angleterre sur son site Web.
Visiter le site Web

Anciens Combattants Canada
Anciens Combattants Canada propose également sur son site Web une courte synthèse historique au sujet de la bataille d’Angleterre. Cette page nous permet de comprendre rapidement les tenants et aboutissants de cette opération militaire.
Visiter le site Web

Le Musée canadien de la guerre
Pour mieux comprendre toutes les subtilités de la bataille d’Angleterre, il peut être intéressant de revisiter les journaux de l’époque. Le Musée canadien de la guerre a compilé sur son site Web quelques-uns des articles de journaux d’intérêt parus dans Le Devoir, The Globe and Mail et The Hamilton Spectator.
Accéder à la sélection d’articles

Journal Le Soleil
Bataille d'Angleterre: les «few» du Québec
Par Paul-Robert Raymond
9 août 2015
Pour en apprendre davantage au sujet de la bataille et de la participation des Québécois, nous vous invitons à lire l’article du journaliste Paul-Robert Raymond.
Lire l’article
Le Vietnam de Beryl Fox

La productrice et documentariste Beryl Fox au Vietnam en 1965
Dans l’édition décembre 2015 / janvier 2016 du magazine Canada’s History, le journaliste Cecil Rosner propose un article portant sur le travail de la documentariste Beryl Fox. Figure majeure de la télévision canadienne, Beryl Fox s’est entre autres fait connaître pour un documentaire marquant portant sur la guerre du Vietnam intitulé Mills of the Gods. Première femme à filmer des images lors de ce conflit, Fox fut une véritable pionnière et son travail influença toute une génération de réalisateurs et journalistes.
Pour en apprendre davantage au sujet de Beryl Fox, nous vous proposons la lecture d’un article de Nathalie Mary, docteure en études cinématographiques de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
Kinoks - Blog du GRHED sur la culture visuelle
Guerre du Vietnam : “Mills of the Gods” de Beryl Fox (1965)
Par Nathalie Mary, docteure en études cinématographiques de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants de la guerre du Vietnam, nous vous suggérons le visionnement d’un reportage vidéo tiré des Archives de la Société Radio-Canada.
Archives de Radio-Canada
Sud Vietnam : un pays en guerre
Émission : Le Sel de la semaine
Date de diffusion : 29 mars 1966
Durée : 12 min 50 secondes

Résumé :
La vie au Sud Vietnam devient intenable sous la pression des bombardements américains et la résistance des forces nord-vietnamiennes.
Duo Improbable
En 1901, Frederick Haultain, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, propose de créer une seule province formée de la région entre le Manitoba et la Colombie-Britannique. Le gouvernement du Canada s’y opposera en adoptant une loi donnant lieu à la création de deux nouvelles provinces de taille et de population à peu près équivalentes. Le premier ministre Wilfrid Laurier affirmait à l’époque que ces territoires étaient trop vastes pour ne former qu’une seule province et que l’Alberta n’accepterait jamais d’être dirigée par Regina, qui était la capitale territoriale depuis 1882. En outre, l’Ontario et le Québec ne voyaient pas d’un très bon œil l’émergence d’une seule grande province dans l’Ouest qui risquait de compromettre leur propre domination au parlement fédéral. La solution des deux provinces fut donc adoptée et l’Alberta et la Saskatchewan virent officiellement le jour en septembre 1905.
Cent ans plus tard, on souligne ces anniversaires à grand renfort de défilés, de pique-niques et de concours. Ces célébrations permettent aux communautés de se définir et d’exprimer leurs valeurs propres, de faire le point sur les difficultés surmontées et les progrès réalisés, ainsi que sur leurs perspectives futures. Ces communautés ne célèbrent pas leur passé historique, mais plutôt un passé qui les rend fières de leur présent et leur donne espoir en l’avenir. En approfondissant la réflexion, on peut se poser la question suivante sur les anniversaires de l’Alberta et de la Saskatchewan : comment deux provinces, à l’origine si semblables, sont-elles devenues si différentes? L’Alberta moderne est une terre où règne la libre entreprise et les impôts peu élevés, la Saskatchewan est le symbole de l’assurance-maladie et des sociétés d’État. James Blanchard, ancien ambassadeur des États-Unis au Canada, cite une description de Calgary : « C’est tout comme le Texas, juste un peu moins antiaméricain ». Personne n’aurait l’idée de faire le même commentaire au sujet de Regina. Chaque province, en construisant sa propre identité, a contribué à définir ce que nous sommes en tant que Canadiens. Nous avons tous un peu de l’Alberta et de la Saskatchewan en nous.
Le « dernier front pionnier de l’Ouest » (the « last, best West ») fut la destination de milliers de colons en quête d’une vie meilleure de la fin des années 1890 jusqu’au début des années 1900. Les deux provinces étaient alors en pleine expansion : la population de l’Alberta est passée de 73 000 à 374 000 habitants entre 1901 et 1911, et celle de la Saskatchewan, de 91 000 à 492 000 pendant la même période. L’arrivée massive d’immigrants ne parlant pas l’anglais donna lieu à d’importants efforts pour les convertir aux valeurs et à la culture du Canada britannique. Malgré une composition ethnique diversifiée, les populations de ces deux provinces étaient différentes. L’Alberta, qui fut colonisée la dernière, profita de l’afflux de colons américains attirés par le prix abordable des terres canadiennes. Dans les régions rurales de l’Alberta, pendant les années 1920, les colons américains dépassaient en nombre les Britanniques dans une proportion de deux pour un. En Saskatchewan, les Britanniques étaient légèrement plus nombreux que les Américains. Également, la majeure partie des ex-Américains en Alberta étaient d’origine anglo-saxonne, alors qu’en Saskatchewan, les colons étaient en grande partie d’origine allemande et scandinave. Compte tenu des préjugés ethniques de l’époque, les Américains de l’Alberta étaient plus susceptibles que leurs contreparties de la Saskatchewan d’occuper des postes de leadership et d’influence.
Lors des élections provinciales de 1905, les Libéraux remportèrent 23 des 25 sièges en Alberta, et 16 des 25 sièges en Saskatchewan. Les deux administrations adoptèrent des politiques similaires dans certains dossiers clés. Le gouvernement de l’Alberta accusait alors la compagnie de téléphone Bell de ne pas offrir un service adéquat aux clients des régions rurales. Il acheta Bell en 1907 et créa la Alberta Government Telephones. Le gouvernement de la Saskatchewan fit la même chose en 1909, sauf que dans cette province, le gouvernement ne possédait que le service interurbain, laissant le service local à de petites entreprises organisées au niveau municipal. Le premier ministre Walter Scott préférait l’aide gouvernementale à la propriété en bonne et due forme car il jugeait que les entreprises étaient plus efficaces lorsque les citoyens pouvaient participer à leur gestion. La création de la Saskatchewan Cooperative Elevator Company en 1911 en est un autre exemple. Malgré les pressions exercées par des groupes d’agriculteurs en faveur d’une participation gouvernementale directe dans la manutention des grains, le gouvernement Scott choisit plutôt de consentir un prêt à une entreprise d’élévateurs appartenant à un agriculteur. Le premier ministre de l’Alberta, Arthur Sifton, instaura la même politique en 1913. Les deux provinces adoptèrent une loi en 1909 pour offrir des cautionnements de garantie aux compagnies de chemin de fer afin de favoriser la construction des voies secondaires, rassurant ainsi les agriculteurs qui avaient de la difficulté à acheminer leurs récoltes vers les marchés.
Les politiques sociales de l’Alberta et de la Saskatchewan suivaient également des voies parallèles. Les deux provinces réagirent avec patriotisme au déclenchement de la Première Guerre mondiale et profitèrent toutes deux du développement économique qui s’ensuivit. Le prix du blé tripla et les superficies cultivées doublèrent. L’esprit de sacrifice prévalant en temps de guerre intensifia le mouvement des réformes sociales qui avait pris naissance avant la guerre et qui maintenant pouvait se matérialiser. Lors d’un référendum tenu en Alberta, en juillet 1915, les citoyens votèrent en faveur de l’interdiction de la vente d’alcool, et la Saskatchewan lui emboîta le pas en décembre 1916. Les femmes de la Saskatchewan obtinrent le droit de voter en mars 1916, les femmes de l’Alberta, un mois plus tard.
La guerre porta également le mouvement de contestation des agriculteurs vers de nouveaux sommets. Les cultivateurs de l’Ouest se considéraient depuis longtemps victimes des grandes entreprises, les sociétés céréalières, les banques et les compagnies de chemin de fer, toutes installées dans le centre du Canada. Ils jugeaient que l’Ontario et le Québec menaient la danse, ce qui se traduisait par des tarifs plus élevés visant à protéger les fabricants du Canada central aux dépens des producteurs de l’Ouest. Pendant la guerre, les agriculteurs se sentirent doublement trahis. En effet, le gouvernement fédéral leur avait promis d’exempter leurs fils du service militaire obligatoire, pour ensuite revenir sur sa décision. Il imposa un plafond sur le prix du blé lorsqu’il était élevé, mais supprima le plancher lorsque les prix étaient faibles. La frustration croissante des agriculteurs mena à la création du parti Progressiste, qui fit élire 64 députés au Parlement, à Ottawa, lors de l’élection générale de 1921.
Pendant la guerre, les agriculteurs se sentirent doublement trahis. En effet, le gouvernement fédéral leur avait promis d’exempter leurs fils du service militaire obligatoire, pour ensuite revenir sur sa décision. Il imposa un plafond sur le prix du blé lorsqu’il était élevé, mais supprima le plancher lorsque les prix étaient faibles. La frustration croissante des agriculteurs mena à la création du parti Progressiste, qui fit élire 64 députés au Parlement, à Ottawa, lors de l’élection générale de 1921.
Alors que ce mouvement de contestation atteignait son paroxysme, l’Alberta et la Saskatchewan commencèrent à s’éloigner l’une de l’autre. Les agriculteurs de l’Alberta suivirent l’idéologie d’Henry Wise Wood, né au Missouri, qui faisait la promotion d’un concept alors radical, le « gouvernement collectif ». Wood rejetait non seulement les partis Libéral et Conservateur, mais également tout le système des partis. Jugeant que les partis étaient achetés par les grandes corporations, il exhortait les agriculteurs à se lancer en politique en formant une catégorie économique. Il encourageait également d’autres groupes, comme les syndicats organisés et les professionnels, à faire de même. Les groupes ainsi formés feraient ensuite front commun pour adopter des lois au bénéfice de toute la communauté. Attaqué pour ses doctrines qualifiées de « soviétiques » et étrangères aux traditions britanniques, Wood répondit qu’il conseillait aux agriculteurs de suivre tout simplement l’exemple des grandes entreprises, soit de s’organiser afin de protéger leurs propres intérêts.
Henry Wise Wood n’était pas qu’un autre leader du mouvement agricole exigeant une hausse du prix du blé et une baisse des frais de transport par train. Il était un visionnaire et un prophète. Il décrivait le groupe United Farmers of Alberta, dont il fut le président de 1916 à 1931, comme « l’enfant qui habite mon cœur et l’espoir de toute ma vie ». Ce mouvement incarnait le principe selon lequel la coopération devait être aux fondements de toutes les relations humaines. Sa philosophie était populaire en Alberta, en partie parce que les Américains formaient une grande proportion de la population. En effet, ils n’avaient aucun attachement particulier à la tradition parlementaire britannique et étaient attirés par des solutions reposant sur la démocratie populaire. En outre, comme l’Alberta fut la dernière province à être colonisée, ses agriculteurs étaient ceux dont la dette était la plus lourde et qui payaient les frais de transport les plus élevés. Ils étaient prêts pour un changement radical.
L’UFA demeura loin des grands partis traditionnels, en grande partie grâce à Henry Wise Wood. Même si l’idéal du gouvernement collectif de Wood ne se concrétisa jamais, l’UFA réussit à former un gouvernement en Alberta en 1921 et à rester au pouvoir jusqu’en 1935. Lorsque les progressistes fédéraux furent réintégrés au sein du giron libéral (le premier ministre Mackenzie King les qualifiait de « Libéraux pressés »), les députés de l’Alberta restèrent fidèles aux valeurs de l’UFA. Wood fit campagne en faveur de réformes démocratiques, du vote libre au Parlement, de l’élection des sénateurs, des élections à date fixe et du recours aux référendums et à la destitution, des idées qui furent plus tard reprises par le Parti réformiste de Preston Manning et ses successeurs.
Contrairement à l’UFA, la Saskatchewan Grain Growers’ Association collabora avec les Libéraux provinciaux et les maintint au pouvoir jusqu’en 1929, année où une coalition dirigée par les Conservateurs fut élue pour un seul mandat. La fin des années 1920 fut une période faste pour la Saskatchewan. Le gouvernement se vantait en 1927 que sa province était parmi les premières au pays en terme de richesse par habitant, première pour la production de blé, d’avoine, de seigle et de lin, première en élevage de chevaux, et première pour son exploitation commerciale des dépôts d’argile et ses réserves de sulfate de sodium. La Saskatchewan, avec ses 921 785 habitants en 1931, arrivait au troisième rang des provinces en population, derrière l’Ontario et le Québec. L’Alberta tirait de l’arrière, avec 731 605 habitants.
La Dépression de 1930 frappa durement l’Alberta, et la Saskatchewan encore plus. Le revenu par habitant en Alberta en 1933 ne représentait que 37,6 p. cent de ce qu’il avait été en 1928. En Saskatchewan, ce pourcentage était de 25,7. Les dépenses d’assistance en Saskatchewan, en 1937, dépassèrent 40 millions de dollars, une somme bien supérieure au budget provincial de la province en 1939, qui était de 23 millions de dollars. La situation était si difficile que le gouvernement dût imposer une nouvelle taxe de vente de 2 p. cent pour couvrir les billets à ordre remis aux enseignants au lieu de leur salaire.
Il est étonnant de constater qu’à tout problème politique, on peut toujours trouver un fond de théologie. Ce fut également le cas dans les années 1930. En Alberta et en Saskatchewan, les prédicateurs-devenus- politiciens s’employèrent à guider les populations hors du marasme, mais avec des résultats fort différents. William (Bible Bill) Aberhart, un directeur d’école secondaire, fréquenta les églises presbytériennes, méthodistes et baptistes avant de fonder son propre institut biblique prophétique de Calgary (le Calgary Prophetic Bible Institute, dont certains se moquèrent en le renommant le « substitut biblique pathétique de Calgary »). En 1925, il commença à diffuser ses émissions religieuses sur CFCN, une station de radio qui couvrait toute la province de l’Alberta ainsi que les provinces avoisinantes de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Les dimanches après-midi, il attirait 300 000 auditeurs, soit davantage que le programme humoristique de Jack Benny. Un garçon de ferme de Rosetown, en Saskatchewan, entendit Aberhart à la radio et décida de s’inscrire à l’institut biblique. Il s’installa chez les Aberharts, qui le traitaient comme un des leurs, le fils qu’ils n’avaient jamais eu. Ce jeune s’appelait Ernest Charles Manning, le successeur d’Aberhart en tant que premier ministre de l’Alberta, et le père de Preston Manning.
Les années 1920 furent une période d’intenses débats théologiques entre les fondamentalistes et les modernistes. La controverse atteint son paroxysme en 1925, lors du procès Scopes, où un enseignant du Tennessee fut accusé d’avoir enseigné la théorie de l’évolution dans une école publique. Aberhart appuya sans retenue les positions des fondamentalistes. Pour lui, tout devait reposer sur la Bible (la Bible, toute la Bible et rien que la Bible). Il jugeait que les interprétations libérales de la doctrine chrétienne ne pouvaient que mener à une « église sans foi », ressemblant davantage à un groupe d’action sociale qu’à une institution sacrée. Il était sceptique à l’égard du mouvement d’évangélisation sociale et de ses tentatives pour bâtir le « Royaume de Dieu sur terre ». Selon lui, les réformes proposées par ce mouvement étaient aussi inutiles « qu’un fermier qui tenterait d’assainir l’eau de son puits en repeinturant la poignée de la pompe. »
La Dépression incite Aberhart à s’intéresser à la politique. Il constate que certains de ses élèves arrivent à l’école le ventre creux car leurs parents n’ont plus les moyens de les nourrir. Un de ses élèves les plus prometteurs se suicidera après avoir fréquenté le monde des itinérants à la recherche de travail. Aberhart se rend à Edmonton à l’été de 1932 pour aider à la correction des examens provinciaux du secondaire. Un enseignant lui remet une copie de Unemployment of War, de Maurice Colborne, une version simplifiée du crédit social, qui était une théorie monétaire inventée par le major Clifford H. Douglas. Aberhart emporte le livre avec lui, dans sa résidence de l’Université de l’Alberta, et le lit d’un couvert à l’autre. Le lendemain, alors que le soleil inonde le campus, il regarde par la fenêtre et a la conviction d’avoir trouvé la solution à la crise économique.
Pendant ce temps, Thomas Clement (Tommy) Douglas, le fils d’un forgeron, s’inscrit en 1924 au Brandon College pour étudier la théologie. Le collège est en plein cœur du débat entre fondamentalistes et modernistes. Harris Lachlan MacNeill, professeur de grec et de latin, est accusé d’hérésie et, même s’il sera plus tard acquitté, l’expérience du procès éprouvera tant le personnel enseignant que les étudiants. MacNeill était l’enseignant préféré de Douglas, qui dira de qu’il « lui a appris à penser ». Après l’obtention de son diplôme, en 1930, le nouveau ministre du culte accepte un poste à la Calvary Baptist Church de Weyburn, en Saskatchewan, une ville de 5 000 âmes au milieu du dust bowl des Prairies. Il s’emploie immédiatement à aider les chômeurs et à améliorer le système d’assistance. Ses sermons portent sur des sujets tels que « Jésus et le capitalisme » et « Jésus et la guerre ». Il rejoint la Cooperative Commonwealth Federation (CCF) dont le manifeste, adopté à Regina en 1933, promet « d’éradiquer le capitalisme et de mettre en place un programme exhaustif de planification sociale qui mènera à l’établissement, au Canada, du Commonwealth coopératif ».
Alors que Douglas s’éloigne de l’évangélisation sociale pour se rapprocher du socialisme, Aberhart amorce une transition du fondamentalisme vers le crédit social. Il intègre des notions d’économie à ses prêches radiodiffusés et expose graduellement ses propositions de réforme monétaire à ses auditeurs. Ces derniers y répondent avec un grand intérêt, et en peu de temps, des clubs d’étude du crédit social verront le jour un peu partout dans la province. Aberhart crée la série Man from Mars, une émission de radio sur un visiteur extraterrestre qui vient sur terre pour trouver des idées en vue d’améliorer la vie sur sa planète. L’homme de Mars en vient rapidement à la conclusion que la Terre est « l’asile psychiatrique des autres planètes ». En effet, comment peut-on expliquer autrement le paradoxe de la pauvreté au sein d’une nation de richesse? Même si l’Alberta possède d’abondantes ressources naturelles, ses citoyens manquent de tout. Les biens s’empilent sur les tablettes des magasins, mais les consommateurs ne peuvent pas les acheter. Aberhart affirme qu’il n’y a pas assez d’argent en circulation car les banques veulent réaliser des profits aux dépens de tous les autres citoyens. Il attaque les grandes fortunes de la province et promet de restaurer le pouvoir d’achat des Albertains en remettant un « dividende de crédit social mensuel de 20 $ » à chaque adulte de la province.
Lors de l’élection de 1935, le parti du Crédit social remporte 56 des 63 sièges. Aberhart devient premier ministre, mais ne prononcera pas un seul discours à l’assemblée législative pendant quatre ans. Il préfère échanger directement avec les gens grâce à ses émissions de radio. En 1937, son gouvernement adopte une série de lois visant à instaurer le crédit social, mais elles sont immédiatement invalidées parce qu’elles contreviennent au pouvoir de réglementer les banques du gouvernement fédéral. Aberhart apprend la nouvelle alors qu’il prononce un discours lors d’un pique-nique près d’Edmonton. Lorsqu’il communique cette information à son public, tous réagissent fortement. Certains crient « Donnez-moi un fusil! ». Le premier ministre tente de calmer la foule : « Non, pas de ça, il ne faut pas que le sang coule! ». Malgré ces belles paroles, Aberhart blâme le gouvernement fédéral pour son incapacité à instaurer le crédit social et rejette l’offre d’aide financière du gouvernement fédéral car elle est subordonnée à la supervision, par les autorités fédérales, des pratiques d’emprunt et de budgétisation de l’Alberta. Aberhart autorisera sa province à faire défaut sur sa dette auprès de ses créanciers obligataires plutôt que de se plier aux diktats d’Ottawa.
De l’autre côté de la frontière, le CCF soutient un gouvernement central fort, jugé essentiel à la mise en place d’un programme socialiste. Seul le gouvernement fédéral a le pouvoir de planifier l’activité économique, de nationaliser les industries et les banques, et de bâtir l’État-providence. Pendant ce temps, les provinces peuvent prendre des mesures graduelles pour aiguiller le pays dans la bonne direction. Le CCF de la Saskatchewan, sous le leadership de Tommy Douglas, prend le pouvoir en 1944 et lance une véritable révolution. Lors de son premier mandat, le gouvernement crée trois nouveaux ministères (bien-être social, travail et coopératives), adopte une loi sur la protection des exploitations agricoles et instaure le premier syndicat de travailleurs en Amérique du Nord. La Saskatchewan est la première province à autoriser les fonctionnaires à se regrouper en syndicats (1944), la première à entériner une charte des droits interdisant la discrimination fondée sur la race, la couleur ou les croyances (1947), la première à mettre en œuvre un régime d’assurance automobile public obligatoire (1946) et à créer un régime d’assurance hospitalisation (1947).
Douglas adopte une approche du développement économique en trois volets, qui repose sur l’entreprise privée, les coopératives et les sociétés d’État. Ces dernières sont responsables des services publics (électricité et téléphone), des compagnies de transport (autobus et lignes aériennes) et des activités entrepreneuriales, comme l’exploitation des mines de sulfate de sodium, une filature de laine et une usine de confection de chaussures. En 1949, onze sociétés d’État garantissaient 3 000 emplois et enregistraient un chiffre d’affaires de 25 millions de dollars par année. La province vit une période de grande prospérité jusqu’aux années 1950; 90 000 habitants s’ajoutent à la population de la province entre 1951 et 1960. Cette croissance survient malgré la diminution des employés agricoles, attribuable à la mécanisation de l’agriculture, qui requiert maintenant d’importants investissements. La production accrue de pétrole, de gaz et d’uranium, et les débuts de l’industrie de la potasse, contribuent à diversifier l’économie et permettent à la province d’échapper à sa dépendance au blé.
La croissance d’après-guerre observée en Saskatchewan, même si elle est impressionnante, n’est pas comparable à celle de l’Alberta. Le puits Leduc, au sud d’Edmonton, donnera ses premières gouttes de pétrole le 13 février 1947, inaugurant ainsi un véritable boom pétrolier : la production passera de 7,7 millions de barils en 1946 à 143,7 millions de barils en 1956. L’Alberta dépasse la Saskatchewan en population, passant de 803 000 habitants en 1946 à 1 332 000 en 1961. Ernest Manning, qui succède à Aberhart en tant que premier ministre en 1943, abandonne en douce les principes du crédit social et s’installe plutôt dans un style d’administration efficace fondé sur une philosophie de l’individualisme, une forte opposition au socialisme, une rhétorique de la guerre froide et de l’antisyndicalisme. Le gouvernement laisse l’exploitation des ressources naturelles au secteur privé et utilise les redevances pour payer la construction des routes, des écoles et des hôpitaux, et pour offrir des services sociaux à ses citoyens.
La fin des années 1940 constitue un tournant. L’Alberta abandonne ses expériences politiques de la Dépression des années 1930 et mise tout sur les puits de pétrole. En 1965, Calgary accueille les sièges sociaux de 965 entreprises de l’industrie pétrolière et Edmonton, qui n’est pas en reste, se distingue comme un grand centre pétrochimique et de raffinage. La présence et les investissements américains dominent l’industrie, ce qui contribue à renforcer l’influence des Américains, présents depuis les débuts de la colonisation. L’attitude de « bravache » de ces derniers, combinée à une exploitation intensive des ressources pétrolières, se répercute sur la scène politique. L’Alberta devient la nouvelle frontière – impétueuse, hardie et indépendante d’esprit.
En Saskatchewan, on observe tout le contraire. Le parti socialiste né durant la Dépression fait maintenant partie des meubles, au sein des institutions et dans l’esprit des habitants de la province. Le gouvernement du CCF (Fédération du Commonwealth coopératif) conserve le pouvoir de 1944 à 1964, pour être alors délogé par les Libéraux de Ross Thatcher. En 1961, Tommy Douglas introduit une loi pour instaurer un régime d’assurance-maladie universel et public. Par cette décision, il transforme les soins de santé en bien public. Les médecins de la province déclenchent la grève le 1er juillet 1962, la journée même où le régime doit entrer en vigueur. Comme Douglas avait démissionné à titre de premier ministre en novembre 1961 afin de prendre la tête du Nouveau parti démocratique fédéral (nouveau nom du CCF), c’est à Woodrow Lloyd que revient la tâche d’instaurer ce nouveau régime, d’ailleurs fort éprouvante pour lui. « Jusqu’où devons-nous punir les gens?, écrit-il, y a-t-il des limites à ce à quoi nous pouvons les exposer? ». Des vandales inscrivent le mot « Commie » (communiste) sur les murs de sa maison et le ministre de la santé, Bill Davies, doit dormir avec une arme à feu à son chevet. La police de Regina poste des agents autour des maisons des ministres du cabinet. Enfin, le 23 juillet 1962, les médecins signent une entente pour mettre fin à leur grève. Le régime d’assurance-maladie se révèle si populaire qu’en 1968, le gouvernement du Canada l’applique à l’échelle du pays.
C’est également en 1968 qu’Ernest Manning quitte son poste de premier ministre de l’Alberta. Trois ans plus tard, le parti du Crédit social tombe dans l’oubli, balayé par les Progressistes-Conservateurs sous la gouverne de Peter Lougheed, âgé de 43 ans, qui admet librement qu’aucune différence idéologique réelle ne sépare son parti du Crédit social. En fait, il affirme vendre la même philosophie de la libre entreprise, mais dans un nouvel emballage. Les Conservateurs font campagne en adoptant le slogan « NOW » (maintenant). Chacun sait ce que cela signifie. Les Albertains souhaitent un gouvernement qui reflète la jeunesse, l’optimisme, l’énergie et le caractère de plus en plus urbain de la province.
En 1973, l’OPEP impose une hausse marquée des prix du pétrole, provoquant du même coup un autre boom économique en Alberta. Le PIB de la province doublera entre 1971 et 1981, et la population passera de 1,6 à 2,2 millions de personnes. Le gouvernement fédéral décide alors de geler le prix du pétrole au Canada en deçà du prix sur les marchés mondiaux, et introduit de nouvelles taxes pour transférer une partie de la richesse de l’Alberta vers Ottawa. La province perd ainsi environ 50 milliards de dollars en revenus dans les années 1970 et 1980. Lorsque le budget fédéral de 1974 établit que les redevances provinciales ne seront plus déductibles de la perception de l’impôt sur le revenu fédéral (ce qui accordait encore plus d’argent à Ottawa), Lougheed qualifie l’exercice comme étant « la plus grande arnaque de l’histoire canadienne ». En 1975, il exhorte les électeurs à soutenir son combat. « Il est temps pour les Albertains de se tenir debout… Je veux savoir si vous êtes derrière moi. » Il fut récompensé un taux d’appui de 63 %, et son parti obtint 69 des 75 sièges à l’assemblée législative.
En Saskatchewan aussi la bataille pour les ressources commence à se corser. Les marchés mondiaux ont soif des ressources de la province : blé, pétrole et potasse. Allan Blakeney, le premier ministre du NPD qui entre en poste la même année que Lougheed, consacre les revenus tirés de ces ressources au renforcement du legs social du CCF. Il introduit un supplément du revenu garanti pour les aînés, un régime de revenu familial pour les pauvres qui travaillent, un service de soins dentaires pour les enfants et un régime d’assurance-médicaments. Blakeney se joint au combat de Lougheed pour le contrôle des ressources naturelles. Les deux hommes mettent de côté leurs différends politiques afin de faire front commun contre Ottawa.
Mais à un égard, la politique de la Saskatchewan est différente de celle de l’Alberta. Lougheed préfère laisser l’exploitation des ressources au secteur privé, assurant les intérêts du public grâce à la réglementation et à la perception de redevances. Blakeney intervient directement par le truchement de sociétés d’État, telles que Saskoil, la Saskatchewan Mining and Development Corporation (essentiellement pour l’uranium) et la Potash Corporation of Saskatchewan. En 1979, la Crown Investments Corporation, la société de portefeuille de l’État, disposait d’actifs de 3,5 milliards de dollars et générait des revenus de 1 milliard de dollars.
La Potash Corporation (PCS) constitue à cette époque un pari risqué. Dans le discours du Trône de novembre 1975, le gouvernement annonce son intention « d’acquérir les actifs d’une partie ou de la totalité des mines productives de la province. » En outre, si la vente ne se matérialise pas de manière volontaire, le gouvernement se réserve le droit d’exproprier les actifs qu’il désire. Lorsque la loi est présentée, les Libéraux, alors dans l’opposition, y font une obstruction systématique. Ils affirment que la propriété des mines de potasse par le gouvernement est inutile et risque d’effaroucher les investisseurs. Finalement, le gouvernement n’aura pas à exercer ses pouvoirs d’expropriation. Il conclut une entente avec les entreprises privées pour acquérir 40 % de l’industrie.
Le vice-premier ministre, Roy Romanow, soutient en 1977 que « la potasse serait aux années 1970 ce que le régime d’assurance maladie a été aux années 1960 ». Mais sa prédiction ne se réalisera pas. Le parti Conservateur, dirigé par Grant Devine, défait le gouvernement Blakeney en 1982 et privatise toutes les sociétés d’État créées par le NPD vouées à l’exploitation des ressources. Après un débat acrimonieux et interminable (la clôture est invoquée pour la première fois dans l’histoire de la province), PCS est vendue. Le gouvernement Blakeney avait acheté les mines à une époque où les prix de la potasse étaient élevés, et le gouvernement Devine les revend alors que les prix sont faibles, le pire scénario possible dans le monde des affaires.
Saskatchewan a toujours eu un système de partis compétitif. À partir des années 1930, le NPD (alors le CCF) affronte les partis anti-NPD du jour, soit successivement les Libéraux, les Conservateurs et le Saskatchewan Party. Ces luttes constantes rendent la joute politique fort intéressante, mais entraînent également leur lot d’incohérences dans les politiques publiques à chaque transfert d’administration. L’Alberta, de son côté, est le royaume des longs règnes tranquilles, premièrement des Libéraux, ensuite des United Farmers of Alberta, du Crédit social et des Conservateurs. Le parti au pouvoir fait généralement face à une opposition faible, mais lorsqu’il est défait, il quitte la scène politique à tout jamais. Les partis au pouvoir en Alberta ont tous partagé la même philosophie antisocialiste, en faveur de la libre entreprise. Le Crédit social a, dans ce groupe, l’apparence d’un intrus, mais seulement en surface. Aberhart en voulait aux grandes richesses, mais pas au système capitaliste. Et de toute façon, lorsque le pétrole commença à couler, le Crédit social s’abandonna, lui aussi, aux joies du néolibéralisme.
L’uniformité politique de l’Alberta repose partiellement sur un sentiment régional d’injustice. Chaque premier ministre de la province, de William Aberhart à Ralph Klein, a rallié les électeurs autour de la défense des droits provinciaux. La Saskatchewan partage ce sentiment pro-Ouest, anti-Ottawa, mais dans une moindre mesure. En effet, la province a eu davantage besoin d’Ottawa que l’Alberta, ne disposant pas du même niveau de richesse. Elle ne peut pas mordre la main qui la nourrit. L’Alberta, de l’autre côté, verse davantage d’impôts à Ottawa qu’elle ne reçoit de la Capitale. L’influence américaine est également plus forte en Alberta, en raison de l’histoire de sa colonisation, mais également de la structure de son industrie pétrolière.
On ne peut non plus ignorer l’influence de leurs leaders respectifs. Si William Aberhart avait résidé à Weyburn et Tommy Douglas à Calgary, les histoires de ces deux provinces auraient sans doute été fort différentes. Même si les candidats du Crédit social ne connurent pas un immense succès en Saskatchewan, ils s’en tiraient mieux dans les régions de la province qui pouvaient syntoniser les émissions de radio de Aberhart. Jusque dans les années 1930, les deux provinces ont suivi des trajectoires historiques assez similaires. Leurs réactions fort divergentes à la Dépression les ont envoyées dans des directions opposées, une impulsion plus tard consolidée par le boom pétrolier de l’Alberta. La Saskatchewan possédait également du pétrole, mais cette industrie n’a jamais été développée au point de devenir le moteur de l’économie, comme c’est le cas en Alberta.
Les deux provinces centenaires ont connu les mêmes débuts, mais ont cheminé dans des directions opposées. À leur naissance, on les a pris pour des jumelles, mais de toute évidence, ce n’était pas le cas. Et pourtant, chacune à sa façon, à connu du succès et à contribué à construire le Canada. Nous admirons l’esprit d’entreprise audacieux et le populisme à l’américaine de l’Alberta, mais le legs de la Saskatchewan, à qui nous devons l’assurance-maladie et une plus grande justice sociale, est tout aussi impressionnant. Aucune de ces deux provinces ne s’est laissée décourager par les défis de la colonisation de l’Ouest, par les cycles en dents de scie d’une économie fondée sur l’exploitation des ressources ou par les difficultés de la Grande Dépression. Elles ont profité du moment et ont tiré le maximum de leurs forces. L’Alberta et la Saskatchewan sont les deux pôles de notre âme nationale, et leur 100e anniversaire mérite d’être célébré par tous les Canadiens.
James M. Pitsula est professeur d’histoire au département d’histoire de l’Université de Regina.
ET CETERA
Cet article est paru pour la première fois dans le numéro d’août/septembre du magazine The Beaver.
Métier critique

Catherine Voyer-Léger. Métier critique. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2014. 216 pages.
Au Québec, pendant que la culture est de plus en plus évacuée des médias au profit du divertissement, la critique culturelle, lorsqu’elle n’est pas décriée, ne fait pas toujours l’unanimité. S’interrogeant d’abord sur la mauvaise réputation de ce métier, Catherine Voyer-Léger explore la façon dont il est pratiqué et se demande ce que serait un espace critique idéal.
Mais qui sont les critiques culturels ? Pourquoi leur travail est-il important ? Pourquoi demande-t-on si souvent à des vedettes de jouer aux critiques dans nos médias ? Est-ce que les nouvelles technologies changent la donne ? Qui est responsable de s’assurer que l’espace critique est un lieu sain où la discussion sur l’art peut avoir lieu ? Ce sont autant de questions qui ouvrent des pistes de réflexion dans cet ouvrage d’une grande pertinence où l’auteure invite tous les gens concernés, y compris le public, à analyser notre rapport à la critique pour entreprendre une discussion de société qui dépasserait les procès d’intention, les blessures d’orgueil ou les querelles de clocher.
Acheter chez Renaud Bray
En décembre 2015, abonnez-vous au bulletin d’information Histoire à suivre et courez la chance de gagner ce livre!
Abonnez-vous à Histoire à suivre!
La langue des maisons du peuple Métis
Il y a sept ans, lorsque Ron Bazylak a acheté sa maison du 216 First Street de Duck Lake, en Saskatchewan, il ne savait pas quelle aventure l’attendait. Pendant sa jeunesse, il livrait l’épicerie de l’ancien combattant qui habitait cette demeure, mais il ne savait rien de la place qu’occupait cette maison dans l’histoire du Canada jusqu’au moment où il a tenté de retirer un crampon du mur du salon. « On a utilisé un arrache-clou et une barre à clous pour tenter de le retirer, se souvient-il, sans succès! » Sous les panneaux jaunes se trouvaient de solides billots, dressés à la hache par des vétérans de la Rébellion menée par Louis Riel en 1885, dont les premiers coups de feu ont été tirés près d’ici.
La maison de Ron Bazylak est l’une des deux dernières maisons métisses encore habitées. Ces constructions de rondins du district St. Laurent de Grandin, sur la rivière Saskatchewan Sud, sont différentes des autres habitations de bois rond que l’on voit se dégrader lentement dans la prairie. Les extérieurs sont résolument de type Georgien, avec un toit à pignon à inclinaison moyenne et une porte centrale, flanquée de deux fenêtres symétriques. Mais une fois à l’intérieur, les grands espaces communs rappellent davantage le tipi des Indiens des Plaines qu’une résidence géorgienne.
Cette combinaison de caractéristiques n’est pas le fruit du hasard. Comme l’a expliqué le professeur d’archéologie de l’Université Simon Fraser, David Burley, dans le journal Historic Archaeology, les Métis ont intégré des éléments provenant de différents milieux culturels : les traits anglais, français, écossais, cris, ojibways et assiniboines se sont fusionnés dans ce processus de créolisation, unis par une langue commune, dérivée du français et du cri des Plaines, appelée Michif. À l’instar de la grammaire michif, qui repose sur les langues des différents peuples fondateurs, les maisons métisses rassemblent des caractéristiques reflétant ces cultures multiples. La culture métisse s’est réellement développée dans le contexte du commerce de la fourrure de l’Ouest canadien. Vers le milieu du 19e siècle, les Métis formaient un groupe ethnique distinct et reconnaissable, notamment par une architecture qui lui était propre et des techniques de boucherie avec outils de pierre qui sont devenues, avec le temps, leur marque de commerce. En plus de s’adonner au commerce de la fourrure, les Métis, durant la première moitié des années 1800, ont participé aux grandes chasses au bison des rivières Rouge et Assiniboine du Manitoba. Mais lorsque les colons et les homesteaders jetèrent également leur dévolu sur les troupeaux en déclin, après 1860, de nombreux Métis furent obligés d’abandonner la chasse et de se déplacer vers l’ouest. En 1880, les Métis étaient en pleine transition, d’un peuple de chasseur à un peuple d’agriculteurs, et bon nombre d’entre eux s’installèrent dans la région des prairies de la Saskatchewan.
Ils s’établirent dans la jolie paroisse boisée de St. Laurent de Grandin, sur la rivière Saskatchewan Sud, à 90 kilomètres au nord de la ville actuelle de Saskatoon. Ils y ont construit leurs fermes et leurs villages, le plus connu étant celui de Batoche, qui sera au cœur de la Rébellion des Métis de 1885. Leur style architectural était non seulement unique au Canada, mais s’éloignait du style de structure de la rivière Rouge, qu’ils avaient laissé derrière eux. Des universitaires l’ont appelé le style St. Laurent.
Les maisons de style St. Laurent, construites de 1870 à 1940, étaient somme toute assez semblables. La plupart faisaient un étage à un étage et demi et étaient coiffées d’un toit à pignon à inclinaison moyenne. En outre, on y trouvait une grande aire ouverte au rez-de-chaussée, la seule division étant celle délimitant l’appentis adossé à un mur à l’arrière de la maison, bâti après la construction initiale, et qui servait de cuisine d’été ou de remise. Un escalier simple menant aux chambres était toujours adossé contre un mur. Des poêles de fonte, plutôt qu’un foyer, servaient au chauffage et le cellier était creusé sous le plancher de la pièce principale.
Comme pour la plupart des premiers colons des Prairies, les Métis adaptèrent les matériaux locaux avec succès. Naturellement, on se servit des pierres plates de la rivière pour les fondations. Les ouvrages étaient faits de rondins de peuplier blanc ou noir, de mélèze ou d’épinette, équarris ou dressés à la hache, et fixés aux coins à l’aide d’un assemblage ajusté à queue d’aronde. « La queue d’aronde était une technique plus rapide et plus solide que celle employée dans les maisons de la rivière Rouge », explique l’aîné métis, Ed Bruce. (Le style traditionnel de la rivière Rouge reposait généralement sur un assemblage à tenons et rainures, où des rondins équarris à l’horizontale étaient taillés de façon à s’imbriquer dans les rainures d’un rondin vertical). Le recours à des méthodes de construction plus durables révélait également le désir d’une installation plus permanente. Ed Bruce explique que les rondins des murs étaient souvent redressés par un chevillage placé verticalement dans le rondin même. Plus tard, on a eu recours au remplissage des murs extérieurs : des plâtres et argiles locaux étaient tenus en place par un réseau de branches de saule. Ce style aurait été influencé par les Ukrainiens qui se sont installés dans la région au début des années 1900. Les toits étaient recouverts de bardeaux de bois local.
La façade avant, qui distingue le style St. Laurent de celui des autres maisons de rondins, est particulièrement frappante. La porte centrale était flanquée de deux fenêtres symétriques. « La symétrie de la façade donnait à ces demeures l’apparence du style georgien, un rapprochement plutôt étonnant pour ce peuple qui, jusqu’à tout récemment, était encore composé de chasseurs de bison », écrit M. Burley, qui a mené une étude et établi un répertoire des maisons traditionnelles en 1986. D’autres universitaires croient que cette caractéristique aurait été inspirée par les loyalistes de l’Empire-Uni, qui appliquaient ces principes de la symétrie géorgienne. En effet, après 1870, la migration des Canadiens de l’Est dans la région s’intensifiera.
À l’intérieur, on observe d’autres caractéristiques qui distinguent les demeures métisses de celles des autres colons des Prairies, essentiellement, l’aire ouverte. M. Burley relie ce détail à un aspect unique de la culture métisse : sa vision du monde. Les données qu’il a recueillies montrent que les Métis forment une société « organique, informelle, sans frontière et ouverte, dont les traits se révèlent également dans leurs relations avec la nature et avec leurs pairs. » Même après la transition des Métis, devenus un peuple d’agriculteurs après avoir vécu de la chasse, les principes structurants de cette vision du monde continuent d’influencer leur relation avec la terre, les biens matériels, l’organisation spatiale et les relations sociales.
« Lorsque l’on entrait dans une maison de la rivière Saskatchewan Sud, on entrait de plain-pied dans l’univers domestique des Métis, un univers dépourvu de portes, ouvert à tous et marqué par la simplicité, écrit-il. L’intérieur de la maison reflète l’absence de frontières, un principe qui met en évidence le sens de la communauté, du consensualisme et de l’équité propre aux Métis. » Ainsi, dans cette pièce principale se déroulaient toutes les tâches du ménage : cuisine, repas et échanges. Lorsque les appentis furent ajoutés, un peu plus tard, ce modèle se transforma légèrement. Les petits ajouts à l’arrière de la maison devenaient des cuisines, laissant la pièce principale servir de lieu de rencontre et de réjouissances. Le deuxième étage, que l’on atteignait par un escalier adossé au mur du fond, servait toujours au repos. Les invités étaient généralement conviés à passer la nuit dans la pièce principale du rez-de-chaussée.
M. Burley compare les diverses caractéristiques culturelles intégrées à ces constructions à la langue michif : « Ces éléments correspondent aux mots qui composent cette langue, explique-t-il. Il y a des "mots" qui ont inspiré la construction de ces maisons… et le système qui relie ensemble tous ces éléments est la grammaire. »
Ces maisons traditionnelles ont peuplé la vallée jusqu’au début des années 1930, où les communications accrues avec le monde extérieur influencèrent la culture locale. Les voitures, l’électricité et la radio changèrent la vie des paroissiens de St. Laurent. Vint ensuite le bois des scieries, qui accéléra l’abandon des assemblages à queue d’aronde au profit des charpentes de bois.
L’équipe de M. Burley a consigné 24 maisons dans le style St. Laurent construites entre 1882 et 1940 qui sont toujours debout; aujourd’hui, il n’en reste que huit. Six de ces maisons se dressent, seules, au milieu d’un champ, vidées de leurs meubles ou remplies de foin, rappels poignants du riche héritage métis de la Saskatchewan. Une de ces maisons a été préservée au lieu historique national de Batoche et l’autre, celle de Ron Bazylak, reste encore sur pied, avec son crampon dans le mur.
Graham Chandler est un auteur de Calgary.
L’article est paru pour la première fois dans le numéro d’août-septembre 2003 du Beaver.
Terre-Neuve : Une union réticente
L’entrée de Terre-Neuve dans la Confédération a bien failli être marquée par un échec. Une très faible majorité accordée lors d’un second referendum aux forces dirigées par Joseph R. Smallwood (diffuseur, producteur de porcs, auteur) a mené ce dernier à une victoire plutôt ténue. Si l’on évoque cette union avec le Canada comme un adieu ou un abandon de l’identité de Terre-Neuve en tant que nation, un néophyte pourrait croire qu’une si faible victoire donnerait nécessairement lieu à une période d’acrimonie et de rancœur.
Mais ce ne fut pas le cas. Les Terre-Neuviens étaient peut-être fatigués de l’agitation qui entoura les deux campagnes référendaires menant au vote. Ou peut-être que la politique de l’époque était plus conciliante qu’aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, l’union de Terre-Neuve avec le Canada ne suscita pas de grands bouleversements ni d’émois particuliers, ce qui est en soit remarquable, d’autant que l’enjeu était d’une grande importance pour la population de la province, et l’issue du vote plutôt fragile.
C’est donc à partir de cet événement marquant, survenu il y a soixante ans, que j’ai décidé de me pencher sur l’histoire de Terre-Neuve et Labrador. La Confédération fut acceptée avec une étonnante facilité. Bien sûr, certains résistèrent. Quelques héros du mouvement anticonfédération continuèrent d’alimenter leur immense déception. Et comme la campagne avait été très émotive et ses résultats serrés, on a évidemment évoqué la possibilité que les résultats aient pu être « manipulés » et que les dés avaient été pipés par les forces écrasantes de la Grande-Bretagne et du gouvernement du Canada. Quelques mauvais romans et un navet tentèrent de creuser cette théorie. Mais en général, la Confédération, une fois instaurée, fut acceptée (n’en déplaise aux Oliver Stone locaux) et célébrée avec un relatif enthousiasme.
Cet accueil est attribuable à l’infatigable capacité de persuasion de Smallwood. Chaque homme est le héros de sa propre œuvre, et en matière d’ego, Smallwood ne donnait sa place à personne.
Smallwood vendit la Confédération aux Terre-Neuviens, après les faits, avec plus de passion et d’enthousiasme qu’il n’avait tenté de le faire avant. Selon ses propres mots, d’une grandeur difficile à surpasser « la Confédération est, après la vie même, le plus beau cadeau que Dieu ait fait aux Terre Neuviens ». Grâce à son talent oratoire, Smallwood trouva les mots pour relier la Confédération à la longue histoire de Terre-Neuve, marquée par l’isolement, la précarité, mais aussi la fierté, et d’en faire le point culminant de cette histoire. Le peuple n’avait pas été trompé, le peuple avait été libéré.
Mais au-delà du désir de Smallwood de passer à l’histoire, d’autres motifs contribuèrent à cette acceptation tacite de la Confédération. Et ces motifs sont en fait bien ancrés dans l’histoire.
Terre-Neuve était pauvre, très pauvre, avant la Confédération. Peu importe l’indice ou la norme retenue, on peut affirmer sans se tromper que la vie était particulièrement difficile pour les Terre-Neuviens. Les histoires racontées par les résidents de la province à partir de 1900 sont horrifiantes. Lisez les récits de Wilfred Grenfell en mission au Labrador. Ou lisez la fascinante correspondance d’un administrateur colonial dans les années 1930, publiée par Peter Neary, White Tie and Decorations. Chaque enfant né dans les années 1950 à Terre-Neuve a grandi en entendant des histoires de pauvreté, voire d’indigence, d’isolement, de santé précaire et même de mortalité.
Mais les difficultés forment le caractère, c’est indéniable. Et ces difficultés, auxquelles s’ajoute l’isolement, ont formé le caractère des Terre-Neuviens : stoïques, drôles, généreux, inventifs, tant en parole qu’en chanson. Mais à quel prix? Combien de possibilités manquées ou de talents perdus?
Le cœur de l’identité de Terre-Neuve et des Terre-Neuviens repose sur l’instinct de survie face aux conditions éprouvantes qui ont marqué l’histoire du pays. Mais même si chantons avec la même rage We’ll Rant and We’ll Roar Like True Newfoundlanders et même si nous sommes bercés par les mélodies harmonieuses qui contrastent avec la dureté de la vie des pêcheurs dans Let Me Fish Off Cape St. Mary’s, toutes ces œuvres musicales sous-tendent le même message sur l’expérience terre-neuvienne, c’est-à-dire le prix beaucoup trop élevé qui a été payé pour acquérir les qualités à la base de ce caractère national.
Qui d’autre aurait pu survivre ici? Qui d’autre aurait pu tirer de cette lutte implacable contre la calamité et les privations (les désastres en mer et les massacres en temps de guerre sont les terribles « réalisations » de l’expérience collective terre-neuvienne) un mode de vie aussi riche et empreint de chaleur et d’humanité?
L’essentiel de Terre-Neuve se trouve dans ces questions mêmes. Nous avons appris à apprécier nos liens avec la rigueur des lieux et réussi à transformer cette histoire de survie en triomphe de la collectivité, ce que peu de peuples sont parvenus à faire. En effet, cette vision est profonde et repose sur un grand paradoxe de l’histoire de Terre-Neuve : plus la vie était difficile, plus nous aimions Terre-Neuve. Cette vision est d’ailleurs reflétée dans cette description presque proverbiale de la province, ce « lieu terriblement merveilleux ».
La Confédération fut l’événement qui brisa ce cycle de misère. Nous faisions maintenant pleinement partie du continent, nous devenions une nation du 20e siècle et en l’espace d’une décennie, nous nous sommes dotés des systèmes et institutions à la base de toute société occidentale moderne.
« Plus jamais seuls » fut une phrase qui marqua la période postconfédération à Terre-Neuve. Mais chaque Terre-Neuvien ne peut s’empêcher de s’interroger, même soixante ans après les faits : le jeu en valait-il la chandelle? Avons-nous troqué notre caractère distinctif pour la vie meilleure que procure l’apport en biens et services? Mais cette réflexion était en fait plus vaste que cela… Les Terre-Neuviens avaient-ils acquis cette vie au détriment d’une certaine grandeur d’être? Évidemment, une telle réflexion fera sourciller le lecteur.
En effet, où est la grandeur dans la pauvreté ou la mortalité infantile, dans l’ignorance ou l’isolement? Mais pour ceux qui sont profondément attachés à cette terre et qui affectionnent ce lieu, caractéristique étrange de chaque âme terre-neuvienne, la question de ce qui a « disparu » avec la Confédération renvoie toujours à des éléments trop subtils ou trop difficiles à comptabiliser.
Sur le plan purement comptable, la Confédération n’a eu que du bon, c’est indéniable. La génération née depuis la Confédération est la première dans toute l’histoire de Terre-Neuve à avoir les moyens de réaliser son plein potentiel, et par moyens nous entendons des écoles, des hôpitaux, des moyens de communication et un niveau de vie qui ne se résume pas à la simple subsistance. La première génération pour qui le choix remplace la nécessité en tant que principale dynamique de vie, et ce, pour une majorité de Terre-Neuviens.
C’est là une des grandes valeurs de la Confédération, encore d’actualité. Mais ces choix décisifs marquent également une scission : l’accueil de la Confédération en 1949 était également un adieu. Adieu à un caractère et une identité uniques et profondément marqués par l’environnement. La vie à Terre-Neuve, caractérisée par les privations et les revers de l’histoire, est également une vie d’intensité, une vie diversifiée et une vie ancrée dans l’amour du territoire. La vigueur, l’inventivité, l’humour et la force de la culture terre-neuvienne sont sans doute un des étonnants miracles dont ce continent a été témoin.
La Confédération a été un abri contre le vent, mais pour certains Terre-Neuviens (et j’en fais partie, je crois), elle aura toujours un goût de renoncement, cependant sans amertume : elle marque la fin de notre épopée tortueuse, ardue, précaire, difficile et étrange qui a débuté par l’arrivée de Cabot. Comme je l’ai souligné au début de ce texte, la Confédération n’a pas provoqué de grandes vagues après son entrée en vigueur. Les Terre-Neuviens sont « devenus » Canadiens, une transition assez remarquable quand on s’arrête pour y penser, du jour au lendemain.
Même même soixante ans après les faits, on se demande toujours si cette fusion, rendue nécessaire par l’histoire et justifiée par les bienfaits que nous en tirerions, n’aura pas laissé échapper la gloire insaisissable née du paradoxe de ce « lieu terriblement merveilleux ».
Rex Murphy est un commentateur de renom qui contribue régulièrement à divers documentaires et émissions politiques pour l’émission de la CBC, The National. Il anime également Cross Canada Checkup à la CBC et est l’auteur de Points of View. M. Murphy est né à Carbonear, Terre-Neuve.
Cet article a été publié à l’origine dans le numéro de février-mars 2009 du Beaver.
Une brève histoire du gouvernement de Terre-Neuve
La loi et l’ordre, enfin : Quelque deux mille résidents de Terre-Neuve ont été soumis aux règles arbitraires des amiraux de la pêche jusqu’en 1729, année où le capitaine de la marine britannique, Henry Osborne, a créé des postes de constables et de juges de paix.
Statut colonial : Après avoir été longtemps considérée par la Grande-Bretagne comme un poste de pêche, et non une colonie, Terre-Neuve a obtenu en 1824 un gouverneur civil et un conseil législatif formé de membres nommés. En 1832, un conseil élu a commencé à siéger avec le conseil nommé.
Démocratie : Le vote en faveur du gouvernement responsable a mené à la nomination de Philip Francis Little au poste de « premier » premier ministre de Terre-Neuve, en 1855. La colonie est devenue un dominion en 1907.
Premières tentatives d’union avec le Canada : L’union avec le Canada fut envisagée dès 1860, mais le public rejeta cette idée lors de l’élection de 1869. Elle revient sur la table en 1895 après une série de catastrophes qui laisseront la province exsangue, mais les discussions n’aboutiront pas.
Gouvernement par commission : La Grande dépression place Terre-Neuve en situation de faillite et accule sa population à la famine. Confronté à une forte instabilité sociale, le gouvernement de Terre-Neuve demande l’aide de la Grande-Bretagne. Le gouvernement élu sera alors remplacé par une commission formée de membres nommés et qui dirigera la province de 1934 à 1949.
La dixième province : Avec le retour de la stabilité économique, les électeurs de 1948 sont appelés à faire un choix entre un gouvernement par commission, l’autonomie gouvernementale ou l’union avec le Canada. L’union l’emporte avec un suffrage de 52 % lors d’un deuxième référendum, et Joseph Smallwood devient le « premier » premier ministre en 1949.
Celle qui est derrière l’affaire « Personne »
On en connaît très peu sur Lizzie Cyr. Son dossier d’arrestation indique qu’elle mesurait cinq pieds six pouces, avait les yeux bruns et le teint foncé. Elle est née au Canada et est décrite comme une « S.M. » (ou Sang-Mêlé). Son occupation officielle était « épouse » et son occupation criminelle, « vagabonde » (ou prostituée). Ses photos signalétiques montrent une femme d’allure sympathique, mais timide, peut-être même un peu craintive. Cependant, de profil, avec ses yeux fixés vers le sol et son regard de victime, Lizzie Cyr a l’air bien plus vieille que les vingt-neuf ans inscrits à son dossier.
Elle est dénoncée à la police par John James Ryan le 17 mai 1917. Même si John et Lizzie se connaissaient depuis de nombreuses années, ils renouent six jours plus tôt. Lizzie avoue à John qu’elle est sans le sou et se retrouve à la rue, et ce dernier lui permet de passer la nuit chez lui. Ils ont une relation sexuelle, pour laquelle John lui paye dix dollars. Le lendemain matin, le samedi, elle se déclare malade et reste chez John pour une autre nuit. Le dimanche, 13 mai, John, déjà lassé d’elle, la met à la porte. Quelques jours plus tard, il tombe également malade et reconnaît les symptômes de la gonorrhée, qu’il avait déjà contractée sept ans plus tôt. Il décide donc d’éviter une visite chez le médecin et d’aller directement à la pharmacie pour obtenir des médicaments. Le lendemain, il voit Lizzie et lui propose ce qui suit : si elle paie pour son traitement, il ne la dénoncera pas. Lizzie refuse et John la dénonce. Elle est arrêtée l’après-midi même. Elle n’avait pas un sou en sa possession.
Lizzie fut accusée en vertu de l’alinéa 238a) du Code criminel, qui établissait ce qui suit :
Est une personne désoeuvrée, trouvée en état d’inconduite ou de vagabondage toute personne qui,
a) n’ayant aucun moyen de subsistance visible se trouve en situation de vagabondage ou loge dans une grange ou dans des installations sanitaires extérieures, ou dans tout immeuble déserté ou vacant, dans un chariot ou un wagon de train de marchandises, ou dans tout bâtiment de gare, et qui n’est pas en mesure de préciser son occupation ou qui n’a visiblement aucun moyen d’assurer sa subsistance et vit sans emploi.
C’était un incident sordide et assez fréquent qui aurait dû passer inaperçu, mais par un concours de circonstances particulier, l’arrestation et le procès de Lizzie Cyr devinrent l’événement déclencheur qui mènera, dix ans plus tard, à l’une des décisions les plus importantes de la jurisprudence canadienne, l’affaire Personne du 18 octobre 1929, et qui établit, une fois pour toutes, que les femmes sont en effet des personnes aux termes de la loi. Ironiquement, l’affaire impliquait une femme qui niait à une autre le droit à une défense juste et équitable.
Le procès de Lizzie Cyr eut lieu le 18 mai 1917, soit le jour suivant son arrestation, en l’absence de jury. Même s’il s’agissait d’un acte criminel, le vagabondage n’était pas jugé un crime assez grave pour être soumis à un jury. Par conséquent, le seul intermédiaire entre l’accusée et le pouvoir absolu des magistrats était son avocat, John McKinley Cameron.
Né à Pictou, en Nouvelle-Écosse, en 1879, John McKinley Cameron obtint son diplôme en droit à Dalhousie et devint membre du barreau en 1904. Pendant plusieurs années, il pratiqua le droit en Nouvelle-Écosse à titre d’avocat pour l’union des travailleurs miniers, mais en 1911 (ou 1909 selon certaines sources), il déménagea à Calgary avec sa famille. En 1914, il y ouvrit son propre cabinet, spécialisé en droit criminel. Cameron, un homme intelligent ayant une connaissance encyclopédique du Code criminel, se tailla rapidement la réputation d’être un avocat brillant, mais plutôt excentrique. Il aimait les plaisirs simples de la vie, notamment dormir dans le grenier de son garage en compagnie de ses chiens de chasse. Il avait une approche détendue à l’égard de la profession et apparaissait souvent en cour portant des habits mal assortis et froissés, et des bottes de caoutchouc. Cependant, son irrévérence à l’égard du code vestimentaire ne s’est jamais répercutée sur son travail. Cameron prenait sa carrière très au sérieux. Il acceptait des dossiers de clients qui souvent n’étaient pas en mesure de le payer, car ses motivations allaient bien au-delà de l’argent ou du prestige. Bon nombre de ses clients provenaient des bas-fonds de la société, notamment des mineurs, des Chinois, des immigrants, des joueurs compulsifs, des contrebandiers d’alcool et des prostituées.
C’est au printemps de 1917 que son chemin croisa celui d’une jeune femme nommée Lizzie Cyr (alias Waters). Le lecteur ne sera pas étonné d’apprendre qu’il accepta de la représenter.
Dès le départ, Cameron adopte une position offensive, affirmant que selon lui, les accusations ne sont pas fondées : « Il y a des centaines de femmes dans la ville de Calgary qui ne gagnent pas d’argent et qui ne sont pas des vagabondes ». Il déposera donc un plaidoyer de non-culpabilité pour sa cliente. « Je tiens également à mentionner que votre Honneur n’a ni la compétence, ni le pouvoir requis pour juger cette affaire », ajoute-t-il.
John Ryan sera le premier à témoigner. Cameron, faisant preuve à la fois de finesse et d’agressivité, utilise le propre témoignage de John pour remettre en question sa vertu et sa crédibilité.
Q. À quel moment avez-vous consulté un médecin au sujet de votre [gonorrhée]?
R. Je n’ai pas consulté de médecin à ce sujet. Lorsque j’ai ressenti les premiers symptômes, je suis allé à la pharmacie pour me procurer des médicaments.
Q. Et à quel moment cela s’est-il produit?
R. La journée avant hier.
Q. Quel médecin avez-vous consulté?
R. Je n’ai pas vu de médecin. Je suis allé voir M. McGill et je lui ai décrit mes symptômes. Il m’a dit « j’ai les médicaments qu’il vous faut ».
Q. Êtes-vous toujours sans domicile fixe?
R. Je ne suis pas sans domicile fixe. J’ai une maison et je travaille chaque jour.
Q. Avez-vous une famille?
R. Non, je ne suis pas marié. Je loue une maison et je suis là tous les soirs.
Q. Vous allez donc agir comme il se doit et laisser les filles tranquilles jusqu’à ce que vous soyez guéri?
R. Oui.
Cameron souligne ici que John Ryan est un risque pour la société tout autant que Lizzie en ce qui a trait à la transmission de la maladie. Non seulement s’agit-il d’une récidive, mais John avoue lui-même qu’il n’est pas un modèle de vertu. En couchant avec d’autres prostituées, il peut leur transmettre la maladie et ainsi contribuer à la propager dans toute la ville de Calgary.
Q. Hormis le fait d’avoir été infecté, avez-vous d’autres objections à formuler au sujet de Lizzie Cyr?
R. Mon objection, c’est que je ne voulais pas garder une prostituée chez moi et elle ne voulait pas partir.
Q. Vous avez donc amené une prostituée chez vous?
R. Oui, pour une nuit.
Q. Vous aviez déjà contracté la gonorrhée et avez cru bon d’inviter une prostituée chez vous… Êtes-vous certain de n’avoir rien à vous reprocher et de ne pas avoir contracté la maladie avec une autre femme?
Ici, Cameron remet en question l’origine de la maladie. De toute évidence, John n’était pas un homme sans reproches et avait sans doute eu des relations avec d’autres femmes par le passé. Comment pouvait-il savoir, hors de tout doute, que cette maladie lui avait été transmise par Lizzie Cyr? John a répondu que Lizzie était la seule femme avec laquelle il avait eu « des relations », ce à quoi Cameron a répondu « Vous êtes très raisonnable… ».
L’interrogatoire se poursuit :
Q. Quel est votre moyen de subsistance?
R. Je travaille.
Q. Travaillez-vous maintenant?
R. Eh bien, si je n’étais pas ici en ce moment, je travaillerais à la Central Methodist Church.
Q. Je crains que vous ne contaminiez les membres de l’église. Travaillez-vous toujours pour l’église?
R. Oui, l’adjudant m’a appelé à l’Armée du Salut.
Q. Lui avez-vous avoué que vous aviez la gonorrhée?
R. Non.
Q. Quel type de travail effectuez-vous à l’église, nous ne voudrions pas que contaminiez tous ses membres… Le 17 mai, on l’a accusée de n’avoir aucun moyen visible de subsistance. Ne saviez-vous pas qu’elle était une honnête femme mariée?
R. Je l’ai vu se promener dans le coin.
Q. Il faut être deux pour avoir une relation sexuelle. Êtes-vous un homme honnête?
John, de plus en plus irrité, répond : « Je travaille et je gagne ma vie… ».
Cameron a peut-être réussi à faire passer John pour un imbécile en cour, mais ce dernier était tout sauf idiot. Il savait très bien qu’en sa position d’homme possédant une maison et un emploi (dans une église, rien de moins!), les chances étaient de son côté. Sinon, il n’aurait sans doute pas dénoncé Lizzie à la police, puisqu’en posant un tel geste, il devait s’incriminer lui-même. Il connaissait aussi bien que Cameron les craintes de la société à l’égard des maladies vénériennes et les préjugés relativement à certains groupes de personnes.
Même si, par le passé, les autorités et le public avaient toléré le vagabondage et la prostitution à Calgary, les années 1910 ouvrirent la voie à une série de réformes sur les plans social et moral. Les puristes et les réformateurs des mœurs, prenant la forme de groupes religieux, de ligues de citoyens, du YWCA et du Conseil national des femmes, exercèrent des pressions sur les politiciens et les policiers afin qu’ils agissent pour freiner la contagion du vice dans la ville. Les forces policières de Calgary, dont l’effectif était insuffisant et mal formé, furent grandement améliorées sous la direction des chefs de police Thomas Mackie (1909-1912) et Alfred Cuddy (1912-1919). Cuddy a notamment lancé une campagne de nettoyage en profondeur, fermant toutes les maisons de débauche aux abords de la ville. En plus des craintes et de l’indignation exprimées à l’égard de la décadence du peuple, la peur des maladies vénériennes joua également un rôle important dans ce changement d’attitude à l’égard des prostituées. Même si les maladies comme la syphilis et la gonorrhée touchaient tous les paliers de la société, elles étaient essentiellement associées aux femmes « immorales ». L’historien David Bright écrit : « Les mesures de coercition, les inspections et les poursuites qui s’ensuivirent eurent pour effet de reléguer au second plan les droits individuels de ceux et celles qui étaient soupçonnés de transmettre la maladie, au profit de l’objectif ultime de protéger la sécurité de la nation ». De telles attitudes, ainsi que la discrimination tenace dont étaient victimes les femmes métisses et autochtones, constituaient des facteurs aggravants pour Lizzie Cyr.
Tout au long de son interrogatoire, John fait valoir le fait que Lizzie avait la gonorrhée et qu’elle présentait donc un danger pour le public dans son ensemble : « Elle est contaminée et ne devrait pas se promener ainsi ». Il l’a accusée d’avoir quitté son mari et a ensuite laissé entendre qu’elle entretenait une relation indécente avec un Chinois, une association qui à l’époque, compte tenu des sentiments antiorientaux qui prévalaient, aurait nui encore davantage à Lizzie Cyr. Lorsque John se présente chez Cyr le jour avant le procès pour lui réclamer le paiement, il tombe sur cet homme :
R. J’ai frappé à la porte, qui était verrouillée. Quelques minutes plus tard, elle a ouvert la porte. Un Chinois se trouvait dans la chambre avec elle.
Q. Le Chinois était-il là pour le service de blanchisserie?
R. La porte était verrouillée.
Q. Avez-vous prévenu le Chinetoque à son sujet?
R. Non, lorsque le Chinetoque m’a vu, il est parti.
Q. Vous ne savez pas s’il a emporté quelque chose avec lui?
R. Non, ils étaient ensemble dans la chambre et la porte était verrouillée.
Cameron n’insiste pas, mais interroge plutôt John au sujet de sa maladie :
Q. Comment saviez-vous que vous aviez la gonorrhée? Avez-vous consulté un médecin?
R. J’ai eu des écoulements.
Q. Quels types d’écoulements?
R. Des écoulements au niveau du pénis. Un homme qui a déjà eu la maladie en sait un peu plus à ce sujet.
Q. Avez-vous consulté un médecin?
R. Non...
William Symons, le policier qui a procédé à l’arrestation, est le prochain à être assermenté. Cameron l’interroge au sujet des circonstances entourant l’arrestation. Apparemment, Lizzie a admis avoir pris le dix dollars, mais rien ne permet de prouver l’origine de la maladie. « Que connaissez-vous des faits dans cette affaire? Vous ne savez pas si elle lui a transmis la gonorrhée? », lui demande Cameron. « Non, répond Symons, tout ce que je sais, c’est ce que Ryan m’a dit. »
La juge, Alice Jamieson, interrompt alors brusquement les procédures : « Lizzie Cyr, je vous condamne à six mois de travaux forcés à MacLeod ». Cette décision soudaine met fin abruptement à la plaidoirie de Cameron. Naturellement, il s’y oppose. Lizzie n’avait eu aucune chance de se défendre et Cameron était indigné. « Je vais m’assurer que votre décision soit infirmée », lance-t-il à la juge Jamieson.
La décision de la juge semble hâtive et dure, d’autant que sa nomination à titre de magistrate de police en 1916 visait justement à assurer des procès équitables pour les femmes délinquantes. L’historien John MacLaren écrit,
Ces femmes [magistrates] nourrissaient d’autres valeurs et croyances que leurs collègues masculins. Ces opinions se reflétaient dans leur approche à l’égard du vice en général, et du traitement des femmes perdues, incluant les prostituées, en particulier. Déjà confrontées à l’exploitation des jeunes femmes par leurs proxénètes et souteneurs, elles étaient indignées par la façon injuste, insensible et aléatoire avec laquelle le droit criminel était appliqué par les agents de police masculins, par les procureurs et les magistrats.
Cependant, cela ne signifie pas que les magistrates étaient tolérantes envers ces femmes, loin s’en faut. En fait, MacLaren cite la décision de la juge Jamieson à l’égard de Lizzie pour prouver ce point. Même si les magistrates étaient souvent plus conciliantes avec les jeunes délinquantes ou celles qui en étaient à leurs premiers démêlés, les délinquantes endurcies ou impénitentes étaient traitées plus durement. Les magistrates telles que Jamieson et Emily Murphy (la seule autre magistrate de police du Commonwealth) considéraient généralement que ces délinquantes pouvaient bénéficier d’un emprisonnement. Sans doute, le dossier de Lizzie a convaincu la juge que son redressement passait par une punition sévère. Dans les quatre années précédant son arrestation en 1917, Lizzie a été arrêtée deux fois pour ivresse et une fois pour vagabondage. La peine la plus sévère lui a été imposée pour cette dernière accusation : soixante jours de travail forcé. Lizzie a reçu la peine d’emprisonnement maximale qui pouvait être imposée en vertu du Code criminel. (D’une certaine façon, elle a eu de la chance, car la juge aurait pu lui demander de payer une amende de 50 $, en plus de sa peine d’emprisonnement!)
Bien sûr, la juge Jamieson n’avait pas la tâche facile. L’attaque de Cameron contre son autorité n’était sans doute pas la première, et ne sera pas la dernière. En effet, Cameron lui-même remettra en cause ses qualifications lors d’un autre procès, sept mois suivant celui de Lizzie. Cette situation était certainement une grande source d’anxiété pour la juge Jamieson. Dans une entrevue publiée dans le Calgary Daily Herald du 13 mars 1920, elle dit :
Je vous assure qu’être la première femme magistrate n’a rien pour susciter l’envie. J’ai dû combattre de nombreux préjugés de la part de certains membres de la profession juridique et du service de police. Lorsque je suis entrée en fonction au tribunal de la police, où l’on m’a accueillie avec froideur, c’est le moins qu’on puisse dire, je me suis dit : « Pourquoi suis-je venue ici… Je n’ai pas besoin de m’imposer cela. Mais j’ai relevé la tête et j’ai pensé : Eh bien, maintenant j’y suis, j’y reste! ».
Peut-être que la juge Jamieson voulait prouver qu’elle pouvait faire son travail et bien le faire; peut-être essayait-elle d’être le meilleur juge possible : parfois dur, mais toujours impartial.
Enfin, comme le souligne David Bright, la prostitution et le vagabondage en 1917 étaient des « crimes de situation ». Il n’était pas nécessaire de prouver un incident précis en cour, il suffisait de montrer que l’accusée menait un certain type de vie. Cela apparaît évident dans l’affaire Cyr. Dans le cadre de son témoignage, John mentionne plusieurs faits qui prouvent que Lizzie menait ce type de vie : elle avait la gonorrhée; elle était qualifiée de « femme facile »; elle « traînait dans le coin », ce qui sous-entendait qu’elle n’en était pas à sa première infraction et qu’elle était une prostituée endurcie; elle n’avait pas d’argent; elle avait quitté son mari et n’avait donc aucun moyen de subsistance; et enfin, elle était associée à d’autres éléments indésirables de la société. Évidemment, il est apparu évident pour la juge Jamieson que Lizzie menait une vie qui justifiait une condamnation et une peine de prison, même si sa décision ne reposait que sur des rumeurs.
John McKinley Cameron détestait perdre. En fait, il se présenta devant la Cour d’appel supérieure de l’Alberta plus souvent que tout autre avocat entre 1912 et 1932. Peut-être était-il un pauvre type à l’esprit étroit, ou peut-être était-il quelque chose de plus complexe. Mais après avoir perdu dans l’affaire Cyr devant la juge Jamieson au printemps de 1917, Cameron en appela non seulement de sa décision, mais également de son droit d’agir à titre de magistrate. Le 14 juin, le juge David Scott de la Cour suprême de l’Alberta, rejette sa requête, même s’il a lui même des réserves quant au droit pour une femme d’occuper une charge publique : « Même si je doute qu’une femme ait les qualifications requises pour être nommée à une telle charge, je crois que la légalité d’une telle nomination ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente requête. » Cameron déposera donc une autre requête, cette fois devant la section d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Les juges Beck Stuart, C.J. Harvey et J.J. Walsh la rejetèrent également. Le juge Stuart, pour sa part, n’a aucune appréhension quant aux capacités d’une femme à occuper une charge publique :
Je pense donc qu’en appliquant le principe général sur lequel repose le common law, soit l’application de la raison et du bon sens à la lumière des nouvelles conditions, ce tribunal se doit de déclarer que dans cette province et dans les conditions qui existent présentement, rien selon le common law ne justifie la disqualification d’une personne au titre de titulaire d’une charge publique pour le gouvernement du pays pour des motifs reliés au sexe. Ce faisant, je suis d’avis que nous revenons à la période plus libérale et éclairée du Moyen Âge en Angleterre et passons outre les préceptes plus sévères et étroits d’esprit qui ont caractérisé le milieu du 19e siècle dans ce même pays.
Cette décision fait de l’Alberta la première province à reconnaître juridiquement le droit des femmes, en tant que personnes, à occuper une charge publique. LES JUGES ÉTABLISSENT QUE LA NOMINATION DE MME JAMIESON EST LÉGALE annonce le Calgary Daily Herald du 26 novembre 1917.
Cependant, les politiques canadiennes ne reflétaient pas celles de l’Alberta. Emily Murphy, Henrietta Edwards, Nellie McClung, Louise McKinney et Irene Parlby, mieux connues sous le nom des Célèbres cinq, exhortent la Cour suprême du Canada à donner suite au précédent établi en Alberta. Le 24 avril 1928, la Cour rend une décision contraire à celle de la province, établissant que les femmes ne sont pas des personnes au sens juridique. Tenaces, les cinq femmes portent leur cas directement devant le Conseil privé britannique, outrepassant ainsi les pouvoirs juridiques canadiens. La Grande Bretagne infirmera la décision du Canada le 18 octobre 1929, affirmant, une fois pour toutes, que les femmes sont en effet des personnes au sens de la loi.
La juge Jamieson conserva donc son poste de magistrate de police tout au long de la lutte menée par les femmes pour être considérées comme des personnes au sens de la loi. En 1931, elle prit sa retraite, deux ans après la victoire de l’affaire Personne. Cameron poursuivit également sa brillante carrière. Il devint célèbre après avoir défendu le contrebandier d’alcool italien Emilio Picariello et son complice, Florence Losandro (voir le Beaver, juin/juillet 2004), accusés d’avoir assassiné le constable Stephen Lawson en 1923. Même s’il ne gagna pas ce procès, il resta convaincu que les deux hommes étaient innocents. Il continua à pratiquer le droit jusque dans les années 1930 et mourut en 1943.
Même si l’affaire Personne constitue une victoire pour la plupart des femmes canadiennes, elle fait tout de même une victime. La légitimité de la juge Jamieson étant confirmée, sa décision de condamner Lizzie Cyr le sera aussi. Lizzie fut emprisonnée six mois dans les baraquements de la Royale Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest à MacLeod, dans une cellule surpeuplée et mal ventilée, où elle fut exposée à des maladies telles que la typhoïde, la bronchite et la rougeole. On ne sait pas très bien à quels travaux forcés elle fut astreinte. Lizzie Cyr aurait par la suite, en 1922, travaillé comme serveuse à l’hôtel King Edward de Pincher Creek, une petite communauté au sud-ouest de Fort MacLeod, où se trouvaient d’autres Cyr, peut-être des membres de sa famille. Par la suite, Lizzie Cyr, également connue sous le nom de Waters, disparaît de notre histoire sans faire de bruit, une fin sans doute banale pour une prostituée métisse sans le sou.
Sarah Burton habite et travaille à Winnipeg.
Cet article est paru à l’origine dans le numéro d’octobre-novembre 2004 du magazine The Beaver.
Incendie au Parlement
Le matin du 25 avril 1859, lord Elgin, gouverneur général de la province du Canada, quittait l’édifice du Parlement à Montréal. Il venait de donner son assentiment au projet de loi d’indemnisation des pertes dues aux rébellions, une loi très controversée qui portait un rude coup au nouveau système de gouvernement responsable du Canada.
Le projet de loi autorisait l’indemnisation des populations de l’est du Canada (Québec) qui avaient subi des pertes lors des soulèvements de 1837–1838. Ce projet de loi aurait dû être adopté sans incident.
Un projet de loi similaire avait été adopté quelques années avant pour les victimes de l’ouest du Canada (Ontario) dans le cadre d’un vote majoritaire.
Alors que son attelage traverse la place du marché, alors très achalandée, une foule commence à l’encercler. Certains francophones le félicitent, mais les anglophones le moquent, ce qui ne le surprend pas vraiment.
Il avait en effet subi des pressions considérables pour opposer son veto à cette loi, soit en dissolvant le Parlement, soit en référant la loi au Parlement impérial, à Londres. « Les Tories ont recours aux menaces, à l’intimidation et à des interventions enflammées pour provoquer un coup d’État », écrit Elgin.
Mais il refusa de s’opposer à la décision de l’assemblée élue — un triomphe pour la démocratie naissante du Canada, mais un dur coup pour l’élite montréalaise pro-Tories, soit les gens d’affaires d’origine britannique. Pour eux, la loi récompensait les rebelles patriotes de langue française.
Soudainement, l’attelage d’Elgin est frappé par une lourde pierre. L’atmosphère devient tendue, les moqueries enterrent toutes les autres manifestations de joie.
Le même après-midi, la Gazette de Montréal imprime une version spéciale invitant la population à se réunir, à 20 heure :
La disgrâce de la Grande-Bretagne! Le Canada vendu et dilapidé!
C’est le début de la fin.
Anglo-saxons, vous devez vivre pour l’avenir. Votre sang et votre race seront maintenant supérieurs.
Une foule de membres respectables de la communauté anglophone se réunit à la Place d’Armes au centre de Montréal. Les vapeurs d’alcool imprègnent l’air. Des voix courroucées haranguent la foule. Bientôt, les manifestants se déplacent vers le Parlement, torches en mains.
Le grand édifice du Parlement, jolie structure de deux étages en pierre calcaire, s’étendait sur 106 mètres sur un côté de la place du marché et contenait deux bibliothèques et toutes les archives du gouvernement. Une extrémité accueillait l’assemblée élue et l’autre, la salle de l’Assemblée législative.
À l’intérieur, l’assemblée siégeait toujours et Augustin-Norbert Morin, un homme de forte stature encore reconnu pour sa participation active à la Rébellion de 1837, dirigeait calmement les discussions à partir de son siège de Président. Morin était un homme en contrôle et organisé qui dirigeait l’assemblée de main de maître. Malgré les bruits de la foule, la séance se poursuivit. Bientôt, des pierres fracassèrent les vitres, suivies de torches enflammées. Un jeune homme pénétra dans le hall de l’assemblée en courant et s’écria : « Je déclare ce Parlement dissous! »
En même temps, on brisa les conduites de gaz pour mettre le feu. Les rideaux s’enflammèrent et les membres surpris, provenant de villages lointains de la province du Canada (l’Ontario et le Québec d’aujourd’hui), commencèrent à se lever.
La voix calme et puissante de Morin les rappela à l’ordre : il insistait pour que l’on ajourne la séance dans les règles.
William Rufus Seaver, un pasteur qui était témoin de l’événement, décrit la foule comme « un groupe de voyous, même s’il s’agit de nos citoyens les plus dignes ». Il écrit ensuite que les manifestants se sont emparés de la masse d’or, symbole de l’autorité royale, et la transportent dans la rue sous les cris et les railleries ».
Une superbe peinture de la reine Victoria est rapidement retirée de son cadre et sauvée des flammes. Elle se trouve aujourd’hui à l’édifice du Centre du Parlement, devant la salle du Sénat, à Ottawa. D’autres peintures et documents précieux n’échapperont pas à l’incendie. En tout, 23 000 ouvrages des deux bibliothèques et des archives du Parlement seront perdus, la plupart irremplaçables.
Le gouvernement avait anticipé les troubles, mais n’avait que deux agents de sécurité à sa disposition immédiate. Lord Elgin jugeait que le recours à une protection trop soutenue ne ferait qu’exacerber le problème. Et sans doute était-il loin de penser que d’honorables hommes d’affaires s’en prendraient au siège du gouvernement.
Au cours des journées suivantes, les membres de l’assemblée, secoués, se réunissent pour une réunion spéciale à Bonsecours — un marché de deux étages qui existe encore aujourd’hui. Cette fois, ils seront sous la protection de soldats britanniques. Alors que les fumerolles s’échappent encore des ruines du Parlement, les membres forment un comité pour faire le point sur les lois qui ont été détruites par l’incendie.
La controverse entourant le projet de loi d’indemnisation des pertes dues aux rébellions ébranlait la colonie depuis la fin des soulèvements. La Rébellion des patriotes de 1837–1838, dont on se souvient toujours au Québec, a débuté lorsque les partisans de Louis-Joseph Papineau du Bas-Canada (Québec) et de William Lyon Mackenzie du Haut-Canada (Ontario) tentèrent de former une république et de mettre fin au régime colonialiste. Les forces britanniques étouffèrent ces soulèvements en condamnant certains de ses acteurs à la pendaison ou à l’exil, mais l’idéal du gouvernement responsable, conçu au cours de cette période, sera par la suite celui qui guidera le Canada vers son indépendance.
Dans la foulée de ces rébellions, des milliers de personnes des deux provinces qui étaient restées fidèles à la Couronne demandèrent une indemnisation. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne fusionna les deux provinces. La nouvelle province du Canada était maintenant majoritairement anglophone, le Haut et le Bas-Canada devenaient le Canada-Ouest et le Canada-Est, deux régions de la même province. La loi visant à indemniser les habitants du Canada-Ouest (Ontario) fut approuvée dans le calme, en 1845.
Mais l’offre d’une telle indemnisation aux populations du Canada-Est (Québec) essuya une farouche opposition.
Louis-Hippolyte LaFontaine fut le premier premier ministre de cette nouvelle démocratie parlementaire, baptisée par le feu. Il s’était engagé à indemniser tous ceux qui avaient été traités injustement par les soldats. En fait, dans l’esprit de ses électeurs francophones, le projet de loi d’indemnisation des pertes dues aux rébellions était devenu un symbole, la preuve que ce gouvernement les représentait réellement. Ils jugeaient qu’ils avaient subi des torts et que si le gouvernement ne faisait rien pour les redresser, alors ce n’était pas leur gouvernement.
Robert Baldwin, le chef réformateur hautement respecté du Canada-Ouest, faisait cause commune avec LaFontaine.
Ils croyaient que le gouvernement britannique respecterait leur droit de gouverner s’ils parvenaient à montrer qu’ils obtenaient le soutien majoritaire des populations du Canada-Ouest et du Canada-Est.
Ils remportèrent cette majorité lors de l’élection de 1848, en grande partie grâce au vote francophone du Canada-Est. LaFontaine, qui devint le premier premier ministre le 18 janvier 1849, demanda à Lord Elgin de lire de discours du Trône en anglais et en français à l’ouverture du Parlement.
Cette loi montrait que le Canada était maintenant dirigé par un gouvernement responsable et que le français était accepté comme une langue officielle du Parlement. Ne restait plus qu’à adopter le projet de loi d’indemnisation des pertes dues aux rébellions. Mais le gouvernement n’était pas encore au bout de ses peines.
Les Tories de Montréal se retrouvaient dans l’opposition pour la première fois depuis la création du Bas-Canada en 1791. Lors des élections précédentes, même s’ils étaient minoritaires, ils avaient l’attention du gouverneur, ils contrôlaient l’Assemblée législative et la Chambre haute, et ils avaient encore le dernier mot. Cette fois, les choses étaient différentes. Lord Elgin s’était engagé à respecter les décisions du parti qui gagnerait la confiance de la population.
En 1844, le siège du Parlement avait été déplacé de Kingston, en Ontario, à Montréal. Ce déménagement le rapprochait de l’élite financière anglophone qui contrôlait le Canada depuis la fin des années 1700. Cette dernière était furieuse qu’un premier ministre francophone, un patriote, un rebelle, ait été élu. Pour ces commerçants anglophones, LaFontaine insistait pour faire adopter le projet de loi d’indemnisation des pertes dues aux rébellions pour venger les patriotes qui avaient perdu leur combat.
Les émeutes qui avaient commencé par l’incendie du Parlement durèrent deux jours. Lors de ces manifestations, une foule s’en prit à la magnifique demeure de LaFontaine, dans le quartier Overdale de Montréal. Ils mirent le feu à son inestimable bibliothèque qui contenait des livres et des manuscrits. Ils détruisirent ses meubles et ses porcelaines, et incendièrent ses écuries.
D’autres partisans furent attaqués dans les rues. Elgin, pour sa part, resta caché dans sa maison. Dans une lettre qu’il écrivit à Lord Grey, le secrétaire de la colonie, le 30 avril, il se dit très inquiet de la situation : « Je crois fermement que si l’on se soumet à la volonté de cette foule, il deviendra impossible pour les autorités de cette province de gouverner aux termes de la Constitution… »
Elgin ne sortit de chez lui qu’une seule fois. À cette occasion, son attelage devint la cible de multiples jets de pierres. Sur le chemin du retour, il emprunta une autre rue pour éviter la confrontation, mais lorsque les manifestants en eurent vent, ils le poursuivirent, obligeant son cocher à fouetter les chevaux.
Après cet incident, il ne bougea plus de chez lui, protégé par ses gardes et sourd aux accusations de poltronnerie publiées dans les journaux tories. « Je suis prêt à faire face à l’opprobre général, disait-il, et si je peux l’empêcher, le sang ne sera pas versé à cause de moi. » Elgin savait qu’une confrontation aurait soulevé la population francophone, qui aurait pris la défense du gouvernement. Il en aurait résulté un véritable « choc des races ».
La situation se stabilisa pendant un temps, mais les troubles reprirent de plus belle en août, après qu’un groupe d’incendiaires furent arrêtés et accusés. LaFontaine fut attaqué deux fois en pleine rue.
Sa maison fut à nouveau ciblée, mais cette fois, il avait le soutien de ses amis. Ils se cachèrent derrière les volets la nuit du 18 août. Alors qu’ils attendaient dans l’obscurité, une foule s’approcha et commença à lancer des pierres. Les amis de LaFontaine tirèrent depuis leur cachette. À l’issue de cette échauffourée, sept des attaquants furent blessés et l’un deux, William Mason, mourut de ses blessures.
Les journaux tories jetèrent de l’huile sur le feu en condamnant ce meurtre d’un Anglo-saxon par un Français. « William Mason fut porté en terre, entouré d’hommes portant le brassard rouge, et lorsque LaFontaine témoigna lors de l’enquête sur la mort de Mason, un manifestant mit le feu à l’hôtel où se déroulaient les procédures.
Lord Elgin, qui aurait pu faire appel à l’armée pour écraser les manifestants, ne fit rien. Même ses partisans les plus fidèles ne pouvaient expliquer sa patience. Mais après un certain temps, n’ayant rien d’autre à se mettre sous la dent, les émeutiers finirent par se calmer.
La tactique d’Elgin avait fonctionné. En appuyant la décision de l’assemblée, malgré les doutes, les questions et la violence, Lord Elgin s’est révélé un acteur essentiel dans la naissance du gouvernement responsable au Canada.
Il y a plus de 150 ans, la démocratie canadienne a fait face à son premier grand défi : le transfert des pouvoirs du gouverneur à un Parlement élu a provoqué l’incendie de l’édifice du Parlement, mais le nouveau gouvernement a tenu bon et instauré une société moderne, bilingue et autonome. Alors que nous célébrons la Confédération, qui marque la naissance de notre pays, soulignons qu’elle n’aurait pas été possible sans la mise en place d’un gouvernement responsable, en 1849.
Lord Durham
L’Anglais qui assura la survie de la culture française. Par Richard W. Pound
Il est peut-être trop tard pour faire accepter Lord Durham comme celui qui a favorisé le développement de la langue et de la culture française en Amérique du Nord. Après tout, Durham s’attendait à ce que les Français soient assimilés au Canada anglais. Pour cette raison, et pour certaines de ses observations acérées sur le Bas-Canada, il est devenu l’une des cibles préférées de certains historiens.
Mais revenons à l’époque de Durham. Les rébellions de 1837-1838 au Bas-Canada n’étaient pas nées de la volonté du peuple, elles n’obtenaient pas l’appui du clergé de l’Église catholique romaine, elles n’intéressaient que certains membres des classes professionnelles et ont été facilement étouffées. Leurs chefs furent accusés ou s’exilèrent. Pour Durham, ce conflit était une question de race, et non de politique.
Les Patriotes étaient capables d’initiatives tactiques, en paralysant le gouvernement colonial, par exemple, mais ils n’avaient aucune stratégie pour améliorer les conditions de leurs compatriotes. Et ils attirèrent la colère de la minorité britannique du Bas-Canada qui jugeait avoir le droit d’exercer un contrôle politique sur la région, sans égard à son statut. Évidemment, c’était un point de vue déraisonnable, même si l’on admet que le suffrage universel n’arrivera que plusieurs générations plus tard et qu’à cette époque, il fallait être propriétaire pour avoir le droit de voter.
Des tensions entre les Anglais et les Français du Bas-Canada auraient inévitablement donné lieu à un conflit armé. Mais les Canadiens Français faisaient face à un dilemme, puisque la Grande-Bretagne aurait forcément pris le parti des colons d’origine britannique. Les Américains auraient pu intervenir, mais seulement dans un but intéressé; en effet, la survie de la langue, des coutumes et des institutions françaises ne leur était d’aucune utilité. Les Canadiens Français eux-mêmes étaient mal équipés pour faire la guerre et la France n’était ni prête, ni intéressée à leur venir en aide.
Les Canadiens Français avaient beaucoup à perdre si la guerre éclatait. Les protections garanties par la l’Acte de Québec de 1774 et par l’Acte constitutionnel de 1791 seraient abolies. Au mieux, ils pourraient conserver leur mode de vie traditionnel dans certaines communautés rurales isolées. Au pire, ils risquaient d’être engloutis dans le melting pot nord-américain.
C’est à cette époque trouble qu’intervient Lord Durham, de loin le plus important représentant de la Couronne britannique à visiter les colonies. Il arrive en mai 1838, fort de ses pouvoirs inégalés à titre de gouverneur général et de haut commissaire de l’Amérique du Nord. L’application de l’Acte constitutionnel de 1791 est suspendue. Non seulement Durham est-il appelé à gouverner, mais il doit également trouver une solution à la gouvernance future des colonies.
Personne d’autre dans l’Empire britannique n’avait la capacité ni la réputation nécessaire à la réalisation de cette tâche colossale. Malgré ces qualités, les jeux de coulisse à Westminster minèrent son autorité et il donna sa démission à titre de gouverneur général après seulement quelques mois passés au Canada. Cependant, il poursuivit la rédaction de son rapport et consacra tout le reste de sa courte vie (il mourut en 1840 à l’âge de 48 ans) à faire accepter ses recommandations.
Il est maintenant de bon ton de critiquer le rapport Durham. Les critiques soulignent le peu de temps qu’il a passé au Canada, son jugement sur les Canadiens Français qu’il qualifie de « peuple sans littérature et sans histoire », et sa conviction qu’ils seraient tôt ou tard assimilés à la société britannique. Il a également été pris à partie pour ses opinions sur le Haut-Canada et certaines de ses observations historiques.
Bon nombre de ces critiques sont valables, mais elles ne tiennent pas compte de la vision centrale et primordiale du gouvernement responsable contenue dans le rapport. Ce rapport se voulait essentiellement un document politique, Durham n’a jamais prétendu en faire une thèse sur l’histoire. Personne d’autre que Durham ne pouvait mettre de l’avant une telle idée de façon crédible, surtout devant les seuls intervenants qui comptaient réellement : les politiciens de Westminster. Durham s’est donné pour mission de convaincre Westminster du bien-fondé de ses conclusions, une tâche difficile compte tenu du niveau de désinformation des membres du Parlement impérial et de leur peu d’intérêt pour les questions coloniales, sauf lorsqu’il est question de se faire valoir sur la scène politique intérieure.
Sa vision globale reposait sur une forme de confédération de toutes les colonies canadiennes, mais l’idée était encore trop avant-gardiste. Elle a commencé à prendre racine lorsque la Grande-Bretagne a compris qu’elle ne serait jamais en mesure de gagner une guerre contre les États-Unis, un constat facile à prouver à la lumière des armées que les Américains avaient réussi à rassembler lors de la Guerre civile. Cependant, à court terme, la situation du Haut et du Bas-Canada se devait d’être réglée de toute urgence. Une majorité canadienne-française ne pouvait tout de même pas freiner le développement des Canadas.
La solution? Fusionner les deux provinces, démanteler la séparation survenue en 1791. Une seule assemblée législative comprendrait un nombre égal de représentants du Canada-Est et du Canada-Ouest. Cela garantissait une majorité au Canada anglais, suscitant la colère des Canadiens-Français, dont la population était plus nombreuse au Canada-Est (l’ancien Bas Canada). Mais il n’y avait aucune autre possibilité et la situation obligeait les deux parties à trouver des façons de travailler ensemble.
Près de trois décennies plus tard, la vision de Durham prendra vie dans la Confédération, qui protège les droits des Canadiens-Français. Dans des circonstances différentes, les choses auraient pu prendre une tout autre tournure.
Le Parlement en mouvement
Ottawa n’a pas toujours été la capitale du Canada. Voici quelques-uns des lieux que le Parlement a déjà occupés :
Kingston, Ontario, 1841–1843
Avec la nouvelle fusion du Haut et du Bas-Canada pour former la province du Canada, le gouverneur général Charles Sydenham choisit Kingston pour capitale. Les trois premières séances du Parlement se tiennent dans un hôpital vide, rénové pour accueillir les parlementaires.
Montréal, 1844–1849
Le Parlement se déplace à Montréal parce que le successeur de Sydenham, Sir Charles Bagot, croit que le Canada doit se doter d’un gouvernement qui représente aussi bien les Anglais que les Français. En outre, Kingston est jugée trop vulnérable, en raison de sa proximité avec la frontière américaine.
Toronto, 1849–1851
Après qu’une foule en colère ait mis le feu à l’édifice du Parlement à Montréal, la capitale se déplace à Toronto. Cependant, on cherche encore à trouver l’endroit idéal pour installer le siège du gouvernement.
Quebec City, 1852–1855
Le Parlement s’installe ici après que le gouvernement ait décidé d’exercer une rotation entre Toronto et Québec, tous les quatre ans. Le Parlement de Québec est accidentellement détruit par le feu en 1854, poussant ainsi le gouvernement à s’installer au palais de justice/salle de concert de la ville.
Toronto, 1856–1859
C’est au tour de Toronto d’accueillir le Parlement dans le cadre du système de rotation. Mais de nombreux députés jugent que ce déménagement tous les quatre ans est trop coûteux et votent, dans une faible majorité, pour faire de Québec la capitale permanente. Malgré cette décision, l’assemblée demande à la reine Victoria de trancher.
Québec, 1860–1865
Le Parlement revient à Québec, mais seulement temporairement. La reine Victoria surprend tout le monde en choisissant Ottawa, une petite ville rustique située à la frontière entre le Canada anglais et français. Il faut quatre ans pour construire les édifices du Parlement, qui ouvriront leurs portes en 1866.
Le Vieux-Québec : un joyau presque détruit

Photo: Mith Huang/Flickr.com
L’arrondissement historique de la Ville de Québec paraît immuable. Ses fortifications, ses bâtiments français du 17e siècle et ses rues de pierre ne semblent pas avoir été inquiétés par les aléas de la conservation historique comme si, de tout temps, il eût été naturel de préserver ce coin de pays. De nos jours, l’arrondissement jouit d’une protection solide, spécialement en raison de son inclusion à la Liste du Patrimoine mondial de L’UNESCO en 1985. Il en a toujours été de même, n’est-ce pas? La réalité est pourtant toute autre. Bien des éléments si distinctifs du Vieux-Québec sont passés à un cheveu de la destruction, et auraient été détruits, n’eurent été les éclairs de génie collectifs et individuels de gens préoccupés par le patrimoine immobilier québécois.
L’historique de la conservation des bâtiments du Vieux-Québec reste assez simple si l’on se contente d’énumérer les maisons historiques. Cependant, dénicher des décisions concrètement motivées par le désir de conservation pour des raisons patrimoniales pose défi, car les sources loquaces font défaut. Voici cependant quelques exemples d’aménagements intacts conservés avec une idée patrimoniale en tête.
Le plus vieil exemple de conservation dans l’arrondissement historique date probablement du 17e siècle, alors que presque tout était neuf à Québec. Les Ursulines, qui fondèrent la première école pour fille en Amérique du Nord en 1639, se relevaient alors du second incendie qui a frappé leur monastère, le 20 octobre 1686. Le bâtiment principal, l’aile Saint-Augustin, gisait en ruine. Heureusement, l’aile Sainte-Famille, épargnée par le brasier, était alors en construction. Comme la nouvelle aile ne suffisait pas à accueillir confortablement la communauté et l’école, les Ursulines firent allonger la maison vers le sud-ouest, en 1687. Or, deux structures à la valeur patrimoniale inégalée, le puits et l’âtre où Marie de l’Incarnation avait puisé de l’eau et préparé la sagamité, empiétaient sur le plan de construction. Au lieu de les détruire ou de les déplacer, les religieuses firent construire la rallonge en les englobant au sein du couvent. Ce faisant, elles préservèrent ce qui est aujourd’hui un des plus vieux aménagements coloniaux intacts de la Nouvelle-France. Cette partie du monastère reste cependant inaccessible au public, car elle se situe dans le cœur même du monastère, endroit où résident les religieuses encore aujourd’hui.
Il faut attendre la deuxième moitié du 19e siècle pour retrouver semblable initiative. En 1862, les Augustines situées à l’Hôpital Général décident de restaurer le moulin à vent de la communauté endommagé par l’incendie du quartier Saint-Sauveur. Les annales de la communauté notent que le bâtiment n’était plus en usage, ce qui montre que la valeur patrimoniale du moulin était supérieure à sa valeur d’utilité au moment de la reconstruction.
La volonté de préservation immobilière qui a eu le plus d’impact sur le Vieux-Québec est sans contredit celle de Lord Dufferin, gouverneur général du Canada de 1872 à 1878. En 1871, la Royal Artillery, dernier bataillon de l’armée britannique dans la forteresse de Québec, quitte la citadelle. Le gouvernement fédéral, gestionnaire des installations militaires, jugea inutile la préservation des fortifications et portes de la vieille ville, et ordonna de démolir le tout. Dufferin, arrivé au Canada en juin 1872, persuada John A. Macdonald de stopper les démolitions. Probablement inspiré par les travaux d’Eugène Viollet-le-Duc, le gouverneur général proposa une série de restauration et d’embellissements illustrés magistralement par John Henry Walker. La plupart de ces travaux n’auront pas lieu du temps de Dufferin, mais seront exécutés plus tard pour donner l’ensemble défensif que nous connaissons aujourd’hui.
À la même période, cependant, certains immeubles historiques de la ville de Québec étaient démolis, ce qui démontre que la volonté de préservation des monuments immobiliers ne résultait trop souvent que d’une initiative privée, et non pas collective ou étatique. L’exemple du Collège des Jésuites est probant. Le bâtiment, érigé en 1635, puis reconstruit en 1647 à la suite d’un incendie, accueillait l’institution qui forma les premiers érudits canadiens-français, dont Louis Jolliet. Même si la vocation de l’endroit changea à la suite de l’invasion britannique de 1759, devenant alors une caserne militaire, l’ensemble architectural resta généralement intact. Alors que Lord Dufferin était encore en poste, en 1877, le Collège des Jésuites fut détruit pour être remplacé, planifia-t-on, par le futur Parlement. Le terrain, jugé trop petit, fut vendu à la ville de Québec, qui y bâtit l’Hôtel de Ville. Ni le fait qu’il s’agissait de la première école du Canada, ni le fait que le bâtiment soit un des plus vieux exemples d’architecture religieuse du pays n’arrêta les démolitions.
Les premières actions gouvernementales concrètes visant la préservation du patrimoine immobilier viendront du gouvernement du Québec. En 1922 est adoptée une loi visant le recensement et le classement des monuments jugés historiquement ou artistiquement intéressants. L’église Notre-Dame-des-Victoires, considérée la plus vieille église en Amérique du Nord, est classée en 1929. Bien qu’il s’agisse du seul bâtiment classé grâce à cette règlementation, un changement de mentalité s’était opéré, et un précédent avait été créé. La culture industrielle, qui accélérait les constructions et les démolitions, ainsi que l’affaire du Manoir Louis-Joseph-Papineau soulevée par Marie-Louise Marmette Brodeur furent les principaux vecteurs de conscientisation du gouvernement. La Loi comporte toutefois une lacune majeure : le classement peut être refusé par le propriétaire, qui peut alors effectuer des modifications sans l’accord du gouvernement.
Plus de vingt ans s’écoulèrent avant que ne soient classés d’autres bâtiments de Québec, et que les propriétaires soient contraints d’obtenir une autorisation gouvernementale avant de procéder à des rénovations. Cela fut fait en vertu de la nouvelle Loi relative aux monuments, sites et objets historiques ou artistiques, adoptée en 1952. Bien que timide au départ, le nombre de classements explosa après l’indignation générale causée par la destruction de la tour de l’Hôtel-Dieu de Québec. En moins de 15 ans, près de 200 bâtiments ont été mis sous la protection de la Loi. Il s’agit là d’une volte-face remarquable de la part tant du gouvernement que de la société. En outre, l’année 1963 offrit une nouvelle innovation : la création de l’Arrondissement historique du Vieux-Québec, qui protège l’ensemble du territoire au sein des fortifications et autour de Place-Royale. Le caractère unique du Vieux-Québec était ainsi reconnu par le gouvernement du Québec.
En 1985 s’ajouta une couche supplémentaire de protection de la vieille ville. L’UNESCO intégra le Vieux-Québec dans sa prestigieuse Liste du patrimoine mondial, qui reconnait les lieux les plus importants pour l’humanité. L’inscription à la Liste aurait pu facilement achopper sans les efforts de préservation globaux et spécifiques faits au cours des décennies, à commencer par la décision pionnière de Lord Dufferin de sauvegarder l’ensemble fortifié. En effet, outre le fait que Québec soit le berceau de la culture française en Amérique, l’UNESCO a jugé que l’arrondissement était « un exemple exceptionnel d’une ville coloniale fortifié, de loin le plus complet au nord du Mexique », critère distinguant Québec de Montréal, par exemple, qui possédait jusqu’au 19e siècle un ensemble de fortifications comparable à celui de Québec.
Malgré les grandes victoires remportées, le travail des professionnels et des bénévoles de l’histoire n’est pas terminé, tant s’en faut. En réalité, depuis quelques décennies, se produit un phénomène alarmant quoique prévisible : le vieillissement des communautés religieuses. À travers le pays, plus d’une centaine de congrégations ont veillé à l’éducation, aux soins et à bien d’autres besoins de la population. Ces ordres ont accumulé au cours des siècles un patrimoine à la valeur historique inestimable constitué non seulement de bâtiments et d’objets religieux ou profanes, mais aussi de traditions orales et de cultures propres à chaque monastère, abbaye ou couvent. Plusieurs organismes s’occupent heureusement de préserver une partie - infime, mais infiniment précieuse - de ce patrimoine dit immatériel et de le faire connaître à l’aide de musées, de centres d’interprétation, de site Web, etc. Il est cependant impossible à ces professionnels et bénévoles d’effectuer ce travail sans un appui constant de la population.
Lorsque vous planifierez vos prochaines vacances en famille, posez-vous la question suivante : connaissons-nous vraiment notre propre patrimoine historique, culturel et naturel ? Sinon, préparez-vous à des surprises ! Le Canada est aussi diversifié qu’il est fascinant. Voyager dans son propre pays, c’est aussi encourager des gens passionnés et fiers de leur patrimoine. Ils vous transmettront leur passion à coup sûr.
Grandes femmes du Canada

Les femmes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta ont obtenu le droit de voter en 1916 et la Société Histoire Canada a donc décidé de marquer le centenaire de cet événement en célébrant les grandes femmes de notre passé.
Afin d’établir notre liste, nous avons fait appel à plusieurs sommités canadiennes, soit l’ancienne gouverneure générale, Adrienne Clarkson, l’auteure à succès Charlotte Gray, les historiennes Michèle Dagenais (Université de Montréal), Tina Loo (Université de la Colombie-Britannique) et Joan Sangster (Université Trent), et l’auteure et professeure d’anglais Aritha van Herk (Université de Calgary).
C’était un défi de taille qui les attendait car, en effet, comment évaluer la « grandeur » ? Les trente noms choisis ne constituent pas une liste définitive; certains de ces noms vous seront familiers, d’autres inconnus. Mais chacune de ces grandes femmes a joué un rôle constructif dans l’histoire du Canada.
Éditrice d’un magazine et championne du mouvement des femmes. Doris Anderson a longtemps été l’éditrice du magazine Chatelaine et chroniqueuse. Au cours des années 1960, elle a exercé des pressions en faveur de la création de la Commission royale sur le statut de la femme, qui a pavé la voie vers d’importantes percées en matière d’égalité des sexes. C’est grâce à elle que les femmes obtiennent les mêmes droits que les hommes dans la Charte des droits et libertés. Elle a écrit de nombreux ouvrages, notamment trois romans et une autobiographie, Rebel Daughter, et a été présidente du Comité canadien d’action sur le statut de la femme. Mme Anderson a également obtenu l’Ordre du Canada et a été lauréate d’un Prix Persons Case, en plus de recevoir plusieurs diplômes honorifiques. Photo: Barbara Woodley; courtesy of Library and Archives Canada/1993-234 NPC. Votez Doris Anderson
Grande artiste inuite. Née dans un igloo sur la côte sud de l’île de Baffin, Kenojuak Ashevak débute sa carrière d’artiste en 1958, lorsqu’un administrateur du gouvernement découvre son talent. Elle devient rapidement un modèle pour de nombreuses autres femmes inuites, qui se feront également connaître. Parmi ses œuvres les mieux connues, notons The Enchanted Owl, créée pour la collection de Cape Dorset en 1960; l’œuvre sera reproduite sur un timbre en 1970 pour marquer le centenaire des Territoires du Nord-Ouest et deviendra une pièce incontournable. Kenojuak Ashevak vivra la majeure partie de sa vie à Cape Dorset, où elle a eu de nombreux enfants et petits-enfants. Chaleureuse et réfléchie, elle reste une inspiration et un mentor pour de nombreux artistes inuits de deuxième et troisième génération. Photo: Ansgar Walk Votez Kenojuak Ashevak
Femme de la côte Ouest qualifiée de « Van Gogh du Canada ». Née à Victoria, Emily Carr grandit dans un milieu assez défavorisé. Elle étudie les arts à San Francisco, Londres et Paris, le financement de ses études étant un combat de tous les jours. Elle revient au pays en 1911, nourrie par le nouveau style moderne, et applique ses talents à ses thèmes favoris : les forêts humides de la côte Ouest et les villages et artefacts autochtones. Cependant, les critiques et les acheteurs canadiens ne sont pas prêts pour son œuvre et elle abandonnera la peinture pendant quinze ans. Ce n’est qu’après l’exposition organisée à la National Gallery en 1927 sur l’art de la côte Ouest qu’elle est reconnue à sa juste valeur. Au moment de sa mort, elle jouit d’une reconnaissance mondiale qui ne se dément pas, encore aujourd’hui. Votez Emily Carr
Première femme noire rédactrice en chef d’un journal en Amérique du Nord. Mary Ann Shadd a défendu sans relâche l’éducation universelle, l’émancipation des Noirs et les droits des femmes. Née au Delaware, Mme Shadd s’installe à Windsor dans l’ouest du Canada (aujourd’hui l’Ontario) pour enseigner, en 1851. Elle fonde le Provincial Freeman, dédié à l’abolitionnisme, à la tempérance et aux droits politiques des femmes. Pendant la guerre civile américaine, elle retourne aux États-Unis pour recruter des soldats afro-américains pour l’armée de l’Union. Après la guerre, elle déménage à Washington, D.C., pour enseigner et étudier le droit, et deviendra, à soixante ans, la deuxième femme noire aux États-Unis à obtenir un diplôme en droit. En 1994, Mme Shadd Cary est désignée Personne d’importance historique nationale au Canada. Votez Mary Shadd Cary
Activiste, animatrice à la radio et leader politique. Malgré une jeunesse passée dans un milieu riche et privilégié, Thérèse Casgrain juge que la vie doit être juste pour tous. Elle aide à fonder le Comité provincial du suffrage féminin en 1921 et animera plus tard une émission de radio fort populaire, appelée Fémina, à Radio-Canada. Dans les années 1940, elle devient la première femme leader d’un parti politique au Canada, le parti Co-operative Commonwealth Federation (CCF) aux tendances socialisantes. Au début des années 1960, elle fonde la branche québécoise du mouvement des femmes contre la menace nucléaire pendant la Guerre froide. Plus tard, elle devient présidente pour le Québec de l’Association des consommateurs du Canada. Thérèse Casgrain a beaucoup fait pour améliorer la vie des femmes canadiennes. Photo: Archives nationales du Québec Votez Thérèse Casgrain
Chef Kwakwaka’wakw, médiatrice culturelle et activiste. Née sur l’île de Vancouver, Ga’axstal’as, Jane Constance Cook, est la fille d’une femme de la noblesse Kwakwaka'wakw et d’un commerçant de fourrure blanc. Élevée par un couple de missionnaires, elle était très cultivée et a acquis une excellente connaissance des deux cultures et de leurs systèmes judiciaires respectifs. Alors que les nations de la côte Ouest sont de plus en plus assujetties au joug du colonialisme, Jane Constance Cook défend les droits d’accès aux terres et aux ressources des Premières nations. Elle témoigna lors de la Commission royale McKenna-McBride de 1914 et fut la seule femme du comité exécutif des Allied Indian Tribes of British Columbia en 1922. Toujours prête à défendre les femmes et les enfants, elle a également été sage-femme et guérisseuse, et a élevé 16 enfants. Votez Ga’axstal’as, Jane Constance Cook
Elle a contesté les pratiques ségrégationnistes en Nouvelle-Écosse. Bien avant le mouvement moderne des droits civils aux États-Unis, une femme noire de Halifax défendra l’égalité raciale dans un cinéma d’une région rurale de la Nouvelle-Écosse. En 1946, Viola Desmond, une coiffeuse, crée tout un émoi en refusant de s’installer dans une section du cinéma officieusement réservé aux personnes de race noire. Elle est traînée hors des lieux et emprisonnée. Même si les représentants de l’ordre refusent d’admettre qu’il s’agit d’une question raciale, son cas polarise la population noire de la Nouvelle-Écosse et l’incite à lutter pour le changement. En 1954, la ségrégation devient officiellement interdite en Nouvelle-Écosse. Photo: Public domain Votez Viola Desmond
Elle contesta des lois discriminatoires contre les femmes des Premières nations. Mary Two-Axe Earley devient activiste à l’âge de 55 ans, malgré la forte opposition des membres de sa propre communauté. Ses efforts permettront d’améliorer les vies de milliers de femmes autochtones et de leurs enfants. Née sur le territoire mohawk de Kahnawake, près de Montréal, Mary Two-Axe Earley a déménagé à Brooklyn, épousé un Américain d’origine irlandaise et a eu deux enfants. Elle deviendra veuve quelque temps plus tard. Comme elle avait perdu son statut d’Indien en épousant un non-Autochtone, elle ne pouvait plus retourner sur la réserve. Pendant plus de vingt ans, Mme Two-Axe Earley a exercé des pressions pour faire renverser cette loi discriminatoire. En 1985, elle obtient gain de cause. Sa ténacité bénéficiera à 16 000 femmes et à 46 000 de leurs descendants de première génération. Photo: CP/Toronto Star Votez Mary Two–Axe Earley
Peintre et artisane vitrailliste québécoise. Marcelle Ferron est la seule femme artiste à avoir signé le Refus Global, manifeste du groupe Les Automatistes, en 1948. Ses œuvres ont fait partie de toutes les grandes expositions des Automatistes. Sa technique devient avec le temps de plus en plus brutale; elle emploie des couleurs vives et réalise des œuvres très texturées. Marcelle Ferron abandonne la peinture pour s’adonner au vitrail après 1964. Ses œuvres de vitrail les plus connues sont celles des stations de métro Champ-de-Mars et Vendôme à Montréal, qui ont été installées en 1968. Le chef d’œuvre du métro Champ-de-Mars mesure soixante mètres de longueur et neuf mètres de hauteur, et baigne toute la station d’une lumière vive et colorée. Madeleine Ferron a également été professeure adjointe à l’Université Laval à Québec et a été nommée Grand officier de l’Ordre national du Québec en 2000. Photo: Copyright Pierre Longtin Votez Marcelle Ferron
Première femme échevine de l’Empire britannique. Lorsqu’Annie Gale et son mari, William, quittent l’Angleterre pour Calgary en 1912, elle est horrifiée par les coûts faramineux du logement et de la nourriture. Déterminée à changer la situation, elle participe à l’établissement d’une ligue des consommateurs locale. Mme Gale, qui s’est toujours portée à la défense des travailleurs et des femmes, contribuera à l’organisation de la Women’s Ratepayers’ Association. Ce sont d’ailleurs les femmes de ce groupe qui la poussèrent à se présenter au conseil municipal en 1917. Hannah Gale remporte un siège et devient la première femme élue à une charge municipale au sein de l’Empire britannique. Elle brise également de nouvelles règles en agissant à titre de maire intérimaire dans le cadre de son mandat. L’approche non partisane de Mme Gale a inspiré d’autres réformateurs, dont Nellie McClung. Votez Hannah (Annie) Gale
Une auteure dont l’œuvre est reconnue dans toute la francophonie. Anne Hébert a remporté tous les grands prix littéraires en France et en Belgique, ainsi que le Prix du Gouverneur général pour une œuvre de fiction à trois reprises. Elle a écrit des poèmes, des histoires, des nouvelles et des pièces de théâtre qui illustrent le tumulte des émotions humaines dans le contexte historique québécois. Anne Hébert a commencé à écrire très tôt et a travaillé pour l’Office national du film et Radio-Canada de 1950 à 1954. Elle est ensuite partie pour Paris, où elle est demeurée jusqu’à la fin de ses jours. Le thème d’une société conquise qui lutte pour se libérer et surmonter les obstacles alimente la trentaine d’ouvrages qu’on lui doit. Photo: lapresse.ca Votez Anne Hébert
Réformatrice du domaine de l’éducation et fondatrice de l’Institut féminin. Adelaide Hoodless a commencé sa carrière publique après la mort de son très jeune fils, qui avait consommé du lait contaminé. La tragédie la pousse à s’assurer que davantage de femmes soient éduquées dans le domaine des sciences domestiques et elle exerce des pressions pour que des cours d’économie domestique soient offerts dans les écoles publiques de l’Ontario. Elle a également joué un rôle prépondérant dans la création de trois facultés des sciences ménagères. En collaboration avec Lady Aberdeen, la femme du gouverneur général, elle fondera le Conseil national des femmes, les Infirmières de l’Ordre de Victoria et la Young Women’s Christian Association (YWCA). Photo: Wikipedia Votez Adelaide Hoodless
Poète et conférencière. Pauline Johnson (Tekahionwake) est reconnue pour ses poèmes sur le patrimoine autochtone. Fille de George Johnson, un chef mohawk, Pauline Johnson crée des contes sur les femmes et enfants autochtones campés dans des décors idéalistes, mais plus réalistes que ceux écrits par ses contemporains. Certaines de ses œuvres se retrouvent dans Songs of the Great Dominion (1884) par W.D. Lighthall, la première anthologie à inclure des poèmes d’auteurs canadiens-français et autochtones. Pauline Johnson traversera le Canada, les États-Unis et l’Angleterre pour faire découvrir ses poèmes. Ses odes patriotiques et ses nouvelles en feront une ambassadrice appréciée des Canadiens. Photo: Bibliothèque et Archives Canada Votez Pauline Johnson
Féministe, réformatrice sociale, conférencière, éducatrice et auteure. Marie Lacoste fut, dès son jeune âge, confrontée aux iniquités dont les femmes étaient victimes. Elle était très intelligente, mais a dû s’éduquer seule, en consultant les ouvrages de son père, car les universités francophones du Québec étaient alors interdites aux femmes. En 1908, elle contribue à la création d’une école pour filles qui permet à de jeunes femmes de poursuivre leurs études. Elle est un des moteurs de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, une organisation féministe francophone qui se porte à la défense de l’éducation, de l’équité, du droit de vote des femmes et d’autres causes sociales. Son travail a ouvert la voie au mouvement féministe québécois pendant la Révolution tranquille. Photo: Centre d'archives de Montréal Votez Marie Lacoste Gérin-Lajoie
Une des grandes femmes de la littérature canadienne. Née à Neepawa, au Manitoba, Margaret Laurence obtient son diplôme du United College (aujourd’hui l’Université de Winnipeg) et vit en Afrique avec son mari pendant plusieurs années. Ses premiers romans racontent son expérience dans ce pays, mais l’ouvrage qui l’a rendue célèbre, The Stone Angel, se déroule dans une petite ville du Manitoba, à l’image de celle où elle a grandi. Son œuvre présente une perspective féminine de la vie contemporaine à une époque où les femmes se libèrent de leurs rôles traditionnels. Mme Laurence a également joué un rôle actif dans la promotion de la paix grâce au Project Ploughshares et a été récipiendaire de l’Ordre du Canada. Votez Margaret Laurence
Première femme élue à la Chambre des communes. Agnes Macphail est née dans une région rurale de l’Ontario. Alors qu’elle n’était qu’une jeune enseignante, elle a commencé à s’intéresser à divers mouvements politiques progressistes, dont le United Farm Women of Ontario. Elle est également devenue chroniqueuse pour un journal. Elle a été élue à la Chambre des communes à titre de députée du Parti progressiste du Canada en 1921. Mme Macphail défendait notamment des dossiers touchant les régions rurales, les pensions pour les aînés, les droits des travailleurs et le pacifisme. Elle a aussi exercé des pressions en faveur d’une réforme du droit pénal et a créé la Elizabeth Fry Society of Canada. Elle a plus tard été élue à l’Assemblée législative de l’Ontario, où elle a formulé la première loi sur l’égalité salariale de l’Ontario, en 1951. Votez Agnes Macphail
Auteure, avocate, animatrice, romancière et politicienne canadienne. En 1963, Julia « Judy » LaMarsh devient la deuxième femme membre du Cabinet à la Chambre des communes, sous le gouvernement du premier ministre Lester Pearson, à titre de ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et de ministre du Sport amateur, de 1963 à 1965. C’est à cette époque que le Régime de pensions du Canada a été instauré et que le régime d’assurance maladie canadien a été élaboré. Mme LaMarsh a été secrétaire d’État de 1965 à 1968, fonction qui l’a amenée à superviser les célébrations du centenaire, à instaurer la nouvelle Loi sur la radiodiffusion, qui a établi les bases des politiques actuelles dans ce domaine, et à créer la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada. Photo: Copyright Health and Welfare Canada Votez Julia Verlyn LaMarsh
Romancière, réformatrice, journaliste et suffragette. Nellie McClung a dirigé la lutte pour les droits des femmes nord-américaines. Grâce à ses efforts, le Manitoba devient la première province à accorder le droit de vote aux femmes en 1916, suivi par l’Alberta et la Saskatchewan. Après son installation en Alberta, elle est élue à l’Assemblée législative de la province en tant que députée libérale d’Edmonton en 1921. Nellie McClung a souvent travaillé avec Irene Parlby du parti au pouvoir, le United Farmers of Alberta, sur des dossiers qui touchent les femmes et les enfants. Les deux ont été membres des Célèbres cinq. Nellie McClung a également été la première directrice du conseil des gouverneurs de la CBC et été choisie comme déléguée aux Nations Unies à Genève en 1938. Votez Nellie McClung
Une auteure dont l’œuvre demeure inoubliable. Lucy Maud Montgomery est reconnue pour avoir créé le personnage d’« Anne », l’orpheline aux cheveux roux de Anne of Green Gables (Anne aux pignons verts). Publié en 1908, le livre a fait connaître l’Île-du-Prince-Édouard partout dans le monde. Mme Montgomery a eu une carrière littéraire prolifique, publiant 20 romans, plus de 530 nouvelles, 500 poèmes et 30 essais. Élevée par des grands-parents très stricts, elle était une enfant solitaire et isolée, mais pourvue d’une imagination débordante. Plus tard, elle déménage en Ontario, où elle combat la mélancolie religieuse de son mari, tout en surmontant les difficultés d’être à la fois épouse, mère et maîtresse de maison. En plus de lutter contre sa propre maladie, elle intentera également des poursuites contre son éditeur. Longtemps après son décès, le legs de Mme Montgomery demeure bien vivant grâce à la popularité d’Anne, un personnage coloré dont la simple évocation suffit à le faire apparaître à notre esprit. Votez Lucy Maud Montgomery
A porté la violence domestique à l’attention du public. On connaît peu de choses sur la vie tragique d’Angelina Napolitano, hors du fait qu’elle était une immigrante italienne qui, en 1911, a tué son mari violent avec une hache pendant son sommeil. Elle est accusée de meurtre et condamnée à la pendaison. Comme la violence domestique ne pouvait pas être invoquée comme défense, l’affaire a suscité un immense débat et généré un véritable déferlement de pétitions exigeant qu’elle soit épargnée. Son cas porte la défense « des femmes battues » à l’avant-plan et met en lumière les iniquités de la loi. Le 14 juillet 1911, le cabinet fédéral transforme sa peine en emprisonnement à vie. Elle obtient une liberté conditionnelle en 1922 et meurt en 1932. Photo: Lina Giornofelice pictured as the lead character, Angelina Napolitano in the 2005 movie, Looking for Angelina. Votez Angelina Napolitano
Missionnaire chrétienne et porte-parole du peuple Ojibway. Nahnebahwequay, également connue sous le nom de Catherine Sutton, s’est élevée contre le ministère des Affaires indiennes, en 1857, qui interdisait aux peuples des Premières nations d’acheter des terres qu’ils avaient eux-mêmes cédées. Elle s’est rendue en Angleterre pour présenter sa cause devant le secrétaire des colonies et la Couronne britannique. Un groupe de Quakers de New York finança son voyage et lui remit une lettre d’introduction afin de rencontrer la reine Victoria, ce qu’elle fit le 19 juin 1860. Son intervention auprès du gouvernement britannique lui permit, à elle et à son mari, William, de racheter leurs terres, mais les autres familles des Premières nations n’eurent pas droit au même traitement. À son retour au Canada, elle continua de se porter à la défense des droits des Autochtones. Photo: Copyright Grey Roots Museum, Owen Sound Votez Nahnebahwequay, Catherine Sutton
Syndicaliste et activiste sociale. Madeleine Parent fut reconnue tard dans sa vie pour son activisme infatigable auprès des travailleurs, des femmes et des minorités. Mais dans sa jeunesse, elle était qualifiée de femme dangereuse et de traîtresse « séditieuse ». Dans les années 1940, Madeleine Parent organise en syndicat les travailleurs des grandes usines de textiles du Québec. Elle sera accusée, et plus tard acquittée, de conspiration séditieuse. Des années 1950 à 1970, elle dirige le Syndicat canadien des travailleurs du textile et de la chimie et déclenche de grandes luttes historiques pour les droits des travailleurs. Vers la fin des années 1980, Madeleine Parent continue de s’exprimer sur un vaste éventail d’enjeux de justice sociale. Ses idées radicales et de gauche définissent non seulement son personnage, mais également l’héritage qu’elle laissera à la société canadienne. Votez Madeleine Parent
Auteure francophone qui a donné au Canada l’un des romans les plus remarquables du vingtième siècle. Gabrielle Roy décrit la misère et l’espoir, la famille et l’isolement, et les tumultes de l’amour. Née à St. Boniface, au Manitoba, en 1909, Mme Roy est la plus jeune de onze enfants issus d’une famille pauvre de moyens, mais riche en histoires. Malgré les difficultés, elle parvient à financer son voyage en Europe en 1937. C’est là qu’elle commence à écrire. Elle revient au Canada en 1939 et publie son premier roman, Bonheur d’occasion, en 1945. Le roman remporte le Prix Fémina en France et sa traduction en anglais, The Tin Flute, le Prix du Gouverneur général du Canada. Elle gagnera deux autres prix du Gouverneur général, ainsi que de nombreux autres prix littéraires. Votez Gabrielle Roy
Épouse de l’explorateur David Thompson et interprète. Charlotte Small est née à l’Île-à-la-Crosse, un poste de traite qui se trouve dans ce qui est aujourd’hui le nord de la Saskatchewan. Elle est la fille d’une femme crie et d’un commerçant de fourrure blanc de la Compagnie du Nord-Ouest. Élevée dans la communauté de sa mère, sa connaissance de l’anglais et du cri en fait la compagne idéale pour David Thompson. Mariée dès l’âge de 13 ans à David Thompson, qui en avait 29, Charlotte Small accompagnera l’explorateur tout au long de ses voyages visant à cartographier la majeure partie de l’Ouest du Canada, couvrant ainsi quelque 20 000 kilomètres. Thompson admet que sa « charmante épouse » et sa connaissance du cri « me procurent de grands avantages ». Leur relation étroite et empreinte d’affection a duré 58 ans et ils eurent 13 enfants. Photo: As depicted on the cover of Woman of the Paddle Song written by Elizabeth Clutton-Brock. Votez Charlotte Small
Elle a organisé en syndicat les cols blancs et les employés de banque du Canada. Eileen Sufrin a mené la première grève des employés de banque à Montréal, en 1941. Cependant, sa plus grande bataille, et le fait saillant de sa carrière, fut sa tentative de syndicalisation des employés du magasin Eaton, le plus important grand magasin du Canada à l’époque. Des 30 000 travailleurs d’Eaton à travers le Canada, Mme Sufrin et son équipe réussirent à en syndicaliser 9 000 entre 1948 et 1952. Malgré ce résultat plutôt faible, pendant cette même période, la compagnie augmenta les salaires et pensions de ses employés, et améliora leur qualité de vie au travail, un exploit dont Mme Sufrin tire une grande fierté. Elle a obtenu la médaille du Gouverneur général en 1979 et figure parmi les sept femmes canadiennes honorées lors du 50e anniversaire de l’affaire « personne ». Votez Eileen Tallman Sufrin
: La première sainte autochtone d’Amérique du Nord. L’histoire de Kateri Tekakwitha en est une de résilience face aux incursions colonialistes, mais également de volonté, puisqu’elle n’a jamais renié ses traditions et valeurs, malgré sa conversion au catholicisme. Née en 1654 près du lieu aujourd’hui appelé Auriesville, à New York, Kateri Tekakwitha devient orpheline dès l’âge de quatre ans. À dix-neuf ans, elle se rend à la mission catholique de Kahnawake près de Montréal, où elle se lie avec un groupe de femmes dévotes. Elle consacrera le reste de sa vie à la prière, à la pénitence et aux soins aux personnes âgées et malades. Des miracles lui sont attribués peu après sa mort et sa sépulture devient un lieu de pèlerinage. Kateri Tekakwitha sera canonisée le 21 octobre 2012. Photo: Dorothy M. Speiser Votez Kateri Tekakwitha
Ambassadrice de paix et interprète pour la Compagnie de la Baie d’Hudson. Thanadelthur était membre de la nation Chipewyan (Déné) et fut capturée par les Cris en 1713 et réduite en esclavage alors qu’elle n’était encore qu’une jeune fille. Après un an, elle réussit à s’enfuir et à se rendre au poste York Factory de la Compagnie de la Baie d’Hudson, alors dirigé par James Knight. Thanadelthur demeura au poste afin de travailler pour James Knight, qui avait besoin d’un traducteur afin de conclure une entente de paix entre les Cris et les Chipewyan dans le but de favoriser le commerce. Accompagnée par un employé de la CBH et un groupe de Cris amis, elle réalisa une mission d’un an en territoire Chipewyan. Elle réussit à rapprocher les deux groupes, en les encourageant et en les réprimandant tout à la fois, et à conclure une entente de paix. Dans les archives de la CBH, on la prénomme la « femme esclave » ou la « femme esclave Joan ». Photo: This young Chipewyan woman from Cold Lake, Alberta, photographed by Edward Curtis in 1928, was popularized by historian Sylvia Van Kirk as a well-known representation of Thanadelthur. Votez Thanadelthur
Une héroïne légendaire qui protégea sa famille d’un raid iroquois. Vers l’âge de 14 ans, Madeleine, en l’absence de ses parents, défendit le fort familial contre un groupe d’Iroquois. On compte au moins cinq récits différents de cet exploit. Le plus plausible, écrit de sa main environ sept ans après les faits, laisse entendre qu’elle s’est échappée de ses attaquants en détachant son foulard, pour ensuite se précipiter dans le fort non défendu et fermer la barrière. Elle réussit, on ne sait comment, à tromper les Iroquois et à leur faire croire que de nombreux soldats défendaient le fort, et tira même une salve de canon. Le bruit alerta d’autres forts de la région et fit fuir les guerriers iroquois. Votez Marie-Madeleine Jarret de Verchères
Première femme à être nommée à la Cour suprême du Canada. Née dans une famille ouvrière d’Écosse, Bertha Wilson suit une formation en droit au Canada. Lorsqu’elle est nommée à la Cour suprême en 1982, elle est déjà forte d’une solide expérience à titre de juge à la Cour d’appel de l’Ontario, où elle est reconnue pour ses décisions sensibles dans les domaines des droits de la personne et de la répartition des biens matrimoniaux. Pendant ses neuf années à la Cour suprême, elle aidera ses collègues masculins à mieux comprendre les désavantages que présentent certaines lois d’apparence neutre pour les femmes et les minorités. Elle contribue ainsi à apporter des changements révolutionnaires aux lois canadiennes. Photo: Copyright Cochrane Photography Votez Juge Bertha Wilson
Une des premières travailleuses sociales professionnelles du Canada et première directrice du Bureau des services sociaux à Halifax. Jane Wisdom suit une formation et des études en travail social à New York car aucune école n’enseignait cette discipline au Canada. Elle revint à Halifax en 1916 pour diriger le nouveau Bureau des services sociaux. Elle s’installe à Montréal en 1921 pour poursuivre ses études et donner des cours dans le domaine du travail social. Elle poursuivra son travail à Montréal pendant 18 ans avant de retourner en Nouvelle-Écosse. En 1941, elle accepta le poste de premier agent de bien-être de Glace Bay, ce qui fit d’elle le premier agent municipal voué au bien-être en Nouvelle-Écosse. Photo: nsasw.org Votez Jane Wisdom
Merci de l’intérêt que vous portez aux grandes femmes de l’histoire canadienne. Nous vous invitons à voter pour votre personnalité préférée parmi les 30 femmes présentes sur notre liste. Vous pouvez aussi proposer le nom d'une femme que vous jugez exceptionnelle.
Annie Mae Aquash

Je m’imagine que le temps était froid et venteux le jour où on a assassiné Annie Mae. Je l’imagine devant le précipice, sachant que tout est terminé, priant pour ses filles. Était-elle terrifiée, ou a-t-elle été touchée par la grâce dans ces derniers moments? A-t-elle fait preuve de courage et était-elle convaincue que toutes ses actions en avaient valu la peine?
Annie Mae Pictou est née en Nouvelle-Écosse le 27 mars 1945 et été élevée dans la réserve de Shubenacadie et, plus tard, après le second mariage de sa mère, à Pictou Landing. Les réserves du Canada avaient peu à offrir à leurs résidents; ainsi, Annie Mae, comme bon nombre des Autochtones des Maritimes, émigra au Maine pour la récolte annuelle de bleuets et de pommes de terre. En 1962, elle partit pour Boston, avec Jake Maloney, un Micmac de Shubenacadie, et avec qui elle a eu deux filles, Denise et Deborah.
De nombreux Autochtones qui s’installent dans les villes finissent malheureusement dans les quartiers malfamés, et c’est exactement ce qui advint d’Annie Mae. Mais plutôt que de succomber à l’attrait des drogues et de l’alcool, elle s’employa à changer les choses. Elle a été l’une des premières organisatrices du Boston Indian Council, qui a mis sur pied des programmes de logement, d’emploi et de lutte contre les drogues et l’alcool. Elle a travaillé dans les premières « écoles de survie », où elle a enseigné à des jeunes autochtones, en veillant à renforcer leur fierté à l’égard de leur culture et de leur patrimoine.
Mais Annie Mae aurait souhaité que les écoles de survie entraînent des changements plus rapides. Lorsque le American Indian Movement occupa Wounded Knee en 1973, Annie Mae et son amant, Nogeeshik Aquash, décidèrent de se joindre aux manifestants. Elle laissa ses deux filles aux soins de sa sœur Mary et partit pour le Dakota du Sud, où elle fit passer de la nourriture et des médicaments à Wounded Knee, alors assiégée. Elle participa à la construction des bunkers et aux patrouilles de nuit avec les hommes. Elle épousa Nogeeshik à Wounded Knee, lors d’une cérémonie traditionnelle symbolisant leur engagement envers les valeurs de leur communauté. Annie Mae partageait son destin avec celui des guerriers.
Elle devint un leader du AIM (American Indian Movement), mais ne sacrifia en rien son lien avec les femmes, ni son engagement envers le travail communautaire. Elle s’entraînait physiquement avec les hommes et continuait de participer aux travaux des femmes. Toute sa vie, elle mit l’accent sur l’importance de l’éducation, d’une saine alimentation et de la résistance.
Cependant, le American Indian Movement dont faisait partie Annie Mae était déjà déstabilisé, infiltré par des agents du FBI. Le plus connu, Doug Durham, qui se faisait passer pour un indien un quart Chippewa, gravit rapidement les rangs de l’organisation et prit en charge la sécurité, malgré les doutes soulevés par Annie Mae et les autres femmes.
La révélation du rôle d’espion de Durham, et le fait qu’il s’en soit plus tard vanté dans les médias, mit les membres du AIM sur la défensive et les rendit paranoïaques; leurs soupçons tombèrent sur Annie Mae. Après la tuerie sur la propriété de Jumping Bull en 1975, où deux agents du FBI et un Autochtone furent tués, événement qui mena à l’emprisonnement du leader du AIM, Leonard Peltier, Annie Mae devint une cible du FBI. Elle fut arrêtée, interrogée plusieurs fois et libérée, contribuant ainsi à alimenter les rumeurs selon lesquelles elle agissait à titre d’informatrice.
Les dernières fois où sa famille eut de ses nouvelles, Annie Mae avait été arrêtée et savait sa vie en danger. Elle parlait d’hommes, mais également d’agents du FBI, qui la traquaient. Dans un moment de clairvoyance, elle demandera à sa soeur de conserver ses lettres afin que ses filles se souviennent d’elle. Elle n’appela pas à la maison le jour de Noël 1975 et le 24 février 1976, son corps fut retrouvé au bas d’une falaise à Wanblee, dans le Dakota du Sud. Personne ne fut accusé du meurtre pendant 27 ans.
Mais l’esprit d’Annie Mae refuse de mourir. Des films, des documentaires et des livres sur sa mort suspecte continuent de paraître, et les rumeurs continuent de circuler, dans la presse et sur Internet, au sujet de l’implication du AIM dans son exécution. Finalement, à la fin de mars cette année, on a procédé à une arrestation, possiblement suivie d’une autre.
L’homme accusé était un des responsables de la sécurité du AIM; il aurait eu 21 ans en 1975. Au moment de son arrestation, il était sans domicile fixe, à Denver. L’autre suspect, qui court toujours, aurait eu environ le même âge. Si ces deux hommes sont condamnés et emprisonnés pour le meurtre d’Annie Mae, pourra-t-on dire que justice a été rendue? Est-ce que cela suffira pour les familles, les amis et pour toutes ces femmes qui, comme moi, ressentent l’obligation de parler au nom des peuples autochtones pour que la mort d’Annie Mae n’ait pas été vaine?
La pièce d’Yvette Nolan, Annie Mae’s Movement, a été présentée à Whitehorse, Winnipeg, Toronto et Halifax. Elle est la directrice artistique de Native Earth Performing Arts à Toronto.
Cet article est paru à l’origine dans le numéro de décembre 2000-janvier 2001 du magazine The Beaver.
La reine des pirates du Canada
L’agile voilier s’est soudainement détaché du nuage d’épais brouillard suspendu au-dessus des eaux de la baie St-George, sur la côte ouest de Terre-Neuve. L’apparition d’un sloop à un seul mât dans ce décor glauque créait un effet mystifiant. Peinte entièrement en noir, son nom effacé, l’embarcation fendait le brouillard comme une lame.
L’équipage déroula le drapeau, un fanion noir décoré d’un crâne au-dessus d’un sabre d’abordage, et soudainement, le pont du navire se mit à grouiller d’activité : la centaine d’hommes se préparaient à une nouvelle journée de travail malhonnête. Ils installèrent douze grands canons sous l’œil vigilant de leur chef, un personnage imposant portant l’uniforme de la marine royale britannique et armé de deux pistolets et d’un sabre à courte lame.
Le capitaine avait l’air menaçant. De toute évidence, Maria Lindsey Cobham, la seule « reine pirate » du Canada, n’était pas un enfant de chœur.
Vérité ou fiction?
Pendant l’« âge d’or de la piraterie », que l’on situe de 1650 à 1720, il y avait peu de femmes en mer. On disait qu’elles portaient malheur, ou tout simplement qu’elles provoquaient des conflits entre les membres de l’équipage, privés de compagnie féminine depuis trop longtemps. La piraterie était un monde d’hommes. La plupart servaient sur des navires de guerre pour les Anglais, les Français et les Espagnols, et se retrouvaient sans travail dès qu’une trêve (précaire) s’installait. Les lois contre la piraterie étaient laxistes et difficiles à faire appliquer. En effet, le lien entre le corsaire et le pirate sans foi ni loi était pour le moins ténu.
« En temps de guerre, les gouvernements engageaient des corsaires pour attaquer des pêcheurs ennemis, et en période de paix, ils fermaient les yeux sur les pirates qui continuaient à s’en prendre à leurs ennemis », écrit l’historien de la marine, Dan Conlin, dans Pirates of the Atlantic: Robbery, Murder and Mayhem off the Canadian East Coast (2009).
Au moment où apparaît le couple Eric et Maria Lindsey Cobham, l’âge d’or est terminé. Les lois antipiraterie étaient appliquées avec plus de vigueur. Les Cobhams s’installèrent sur une région isolée de la côte ouest de Terre-Neuve en 1740. C’est de là qu’ils lancèrent leurs raids dans le golfe du Saint-Laurent, essentiellement contre des navires français.
Le couple a régné sans pitié sur les eaux de la région pendant près de 20 ans. Alors que les pirates la « belle époque » torturaient et tuaient quelques-uns des prisonniers faits sur les navires attaqués et libéraient les autres, les Cobhams assassinaient tous les membres d’équipage pour s’assurer qu’il n’y ait aucun témoin. Avant de remonter sur leur navire avec leur butin, ils coulaient celui qu’ils venaient d’attaquer. Puisqu’aucun survivant ne pouvait raconter ce qui était arrivé, les navires étaient simplement considérés « perdus en mer, sans survivant ».
Si l’on en croit les nombreuses légendes du folklore maritime sur Maria Lindsey, on pourrait en conclure que cette dernière avait toute la sensibilité d’un psychopathe. Elle aurait empoisonné tous les membres d’équipage d’un navire capturé pour le simple plaisir de les voir se tordre de douleur alors que le navire sombrait. À une autre occasion, on dit qu’elle aurait fait coudre de malheureux marins dans des sacs de jute, puis les aurait jetés à la mer pour les noyer, tout en prenant plaisir à les voir se débattre en vain. Elle aurait aussi utilisé ses prisonniers pour s’exercer au tir.
Même si certains s’interrogent sur la véracité de ces histoires et doutent même de l’existence des Cobhams, M. Conlin, l’historien et conservateur du Musée maritime de l’Atlantique à Halifax, pense que ces histoires sont sans doute vraies, avec quelques exagérations.
« S’ils avaient attaqué autant de navires qu’ils le prétendent, les Français s’en seraient aperçus et se seraient lancés à leur poursuite. Rien n’indique que cela se soit produit, explique M. Conlin. Ils étaient sans doute des « destructeurs », une sous-catégorie de pirates, mal définie mais fort dangereuse, qui s’en prenaient à des navires en détresse, assassinaient l’équipage et faisaient main basse sur tout objet de valeur. Ce genre d’incident n’était pas rare dans le golfe du Saint-Laurent, à différents degrés. Les Cobhams correspondent au type de pirates qui existait après l’âge d’or de la piraterie. Ils étaient généralement moins nombreux, mais plus cruels que ceux de la belle époque, qui a pris fin vers 1720.
Les légendes des exploits sanguinaires de Maria sont difficiles à vérifier. Les Cobhams n’ont jamais été traduits devant la justice, et aucun document officiel à leur sujet n’a été retrouvé.
« Il existe une foule de récits populaires, plus ou moins fiables, dans différents ouvrages parus à Terre-Neuve, explique M. Conlin. Tout cela découle d’une autobiographie écrite par Eric Cobham sur son lit de mort, en France, en 1780, et où il relate ses exploits sans aucune modestie. On ne sait pas si ce document a réellement existé. »
Un couple infernal
Philip Gosse a écrit au sujet de ce couple dans son ouvrage de 1924, The Pirate’s Who’s Who. Selon lui, le couple se serait rencontré au port de Plymouth, sur la côte sud-ouest de l’Angleterre. Ils avaient tous deux la jeune vingtaine et ce fut un coup de foudre instantané : il fut attiré par son sex-appeal, et elle, par son nouveau statut de pirate.
Maria Lindsey était une fille du coin, mais Eric Cobham venait de Poole (Dorset), un peu plus à l’est sur la côte sud. Il était l’un des milliers de jeunes garçons envoyés sur les navires de pêche vers Terre-Neuve. C’est donc sans surprise que l’on apprendra que Terre-Neuve est devenue une véritable « pépinière » de pirates en devenir.
Les pirates saisissaient leur butin en recourant à l’intimidation, mais leur nombre avait également un effet dissuasif assez convaincant auprès des équipages de la marine marchande, qui n’avaient d’autre choix que d’abandonner leurs marchandises sans livrer combat. Dans cette société sans foi ni loi, Eric Cobham n’eut pas à réfléchir longtemps avant de quitter le difficile métier de pêcheur pour embrasser une nouvelle vie de criminel. Alors qu’il n’avait pas encore 20 ans, il s’embarqua avec un groupe de contrebandiers et c’est ainsi que débuta sa carrière de pirate. Il ne lui manquait qu’un complice, et il la trouva dans une taverne de Plymouth, où elle servait à boire aux marins et leur offrait d’autres services de nature plus intime.
« Cobham, de passage à Plymouth, fit la rencontre d’une demoiselle nommée Maria, qu’il emmena à bord avec lui. Évidemment, cela devint une cause de jalousie, puisque les autres membres de l’équipage n’étaient pas autorisés à avoir des compagnes lors de leurs voyages », écrit Gosse.
La piraterie fut une véritable émancipation pour Maria, dont l’avenir à Plymouth se limitait à la prostitution et autres travaux dégradants.
En tant que pirate, elle était libre et indépendante, elle décidait de ses « horaires », et pouvait consacrer la majeure partie de sa journée à jouer aux cartes, à boire du rhum ou de la bière, et à manger des aliments fins. Les pillages et les massacres venaient agréablement pimenter ses journées.
Même si c’est elle qui a suivi son amant dans cette carrière de criminel, elle n’a jamais joué les seconds violons. Maria était sans conteste celle qui portait les culottes dans cette famille de pirates.
Malgré qu’ils ne se soient jamais mariés, Maria Lindsey et Eric Cobham formaient un couple qui a duré toute leur vie, une vie ancrée dans une quête sanguinaire pour l’argent et les sensations fortes.
Leur première aventure les mène à Bristol, un port de la côte ouest où l’activité commerciale était encore plus importante qu’à Londres. On dit que les Cobhams y auraient pris en otage un navire et volé 40 000 livres sterling en billets et en pièces.
Après leur traversée de l’Atlantique, ils arrivent à Nantucket, au Massachusetts, où ils capturent un sloop et prennent le large vers le nord à bord de leur nouvelle acquisition en direction de la pointe de l’île du Cap-Breton.
C’est là qu’ils trouvent le gros lot : une voie maritime vulnérable qu’empruntent des navires arrivant du golfe Saint-Laurent et faisant partie d’un triangle commercial. Les navires arrivaient à Terre-Neuve chargés de sel et de provisions, ramenaient des poissons salés vers les pays de la Méditerranée et revenaient ensuite vers l’Angleterre les cales pleines de vin, d’huile d’olive et de fruits séchés. Plus tard, l’ajout des fourrures à ce butin fit de ces navires une cible encore plus attirante, d’autant que les pirates des Caraïbes ne fréquentaient pas ces eaux nordiques.
« Le détroit anglais était devenu trop dangereux pour Cobham, qui décida de traverser l’Atlantique et de guetter les navires entre le Cap-Breton et l’Île-du-Prince-Édouard. Ce fut un pari très payant pour le pirate », écrit Gosse.
Les Cobhams devaient maintenant trouver un refuge sécuritaire pour cacher leur navire et le mettre au carénage. (Comme ils n’avaient pas accès à une cale sèche, les pirates mettaient leur navire au carénage ou le transportaient vers une plage sablonneuse à marée haute afin d’effectuer des travaux sur la coque exposée lorsque la marée redescendait. Le goudronnage de la coque évitait le problème persistant des fuites et l’enlèvement des mollusques permettait d’augmenter la vitesse du navire).
La reine pirate et son comparse avaient bien choisi leur navire. Même s’il était plus petit qu’un navire de guerre, leur sloop de 65 pieds n’avait un tirant d’eau que de huit pieds, lui permettant ainsi de naviguer dans des eaux auxquelles les navires de la marine n’avaient pas accès. Il était également apte à la navigation en mer et pouvait dépasser presque tous les autres navires en vitesse.
Le port que les Cobhams choisirent pour mettre leur navire en carénage était assez éloigné au nord des voies maritimes pour ne pas être découvert, mais à seulement deux jours de navigation du détroit de Cabot et du détroit de Belle Isle. Aucun navire de guerre ne pouvait les suivre à Sandy Point, à cette époque un banc de sable de deux kilomètres de long sur la côte ouest du sud de Terre-Neuve qui atteignait la baie St-George. (Aujourd’hui, ce banc de sable forme une île déserte, érodée par la mer). Les grands navires ne pouvaient pas traverser les hauts-fonds qui protégeaient Sandy Point.
Les biens volés étaient « blanchis » à Percé, dans la péninsule de Gaspé, où des navires légitimes embarquaient la marchandise de contrebande et la transportaient vers la France, sous le nez des navires de guerre de la marine royale. Le butin était vendu dans les « ports libres » français, où des aristocrates locaux s’adonnaient activement au marché noir.
Le sloop noir prenait les navires en embuscade les uns après les autres avec, dans son sillage, meurtres et violences.
« Maria prenait part à ces violences… et poignarda en plein cœur le capitaine d’un navire-prison de Liverpool, le Lion, avec son propre surin. À une autre occasion, pour satisfaire à l’un de ses caprices, un capitaine et deux de ses membres d’équipage furent attachés au guindeau alors que Maria leur tirait dessus avec son pistolet… En fait, le métier de pirate lui était venu tout naturellement », écrit Gosse dans The Pirate’s Who’s Who.
Maria portait toujours une veste d’officier de la marine britannique, selon David E. Jones dans son ouvrage de 1997 Warrior Women. Il ajoute qu’elle l’avait pris d’un jeune officier capturé lors d’un raid sur un navire de la marine royale.
« Elle le fit déshabiller sur le pont. Après avoir pourchassé le jeune homme avec son épée, elle lui prit son uniforme, un vêtement qui devint sa marque de commerce. Lorsque l’original fut trop usé pour être porté, elle en commanda de nouveaux sur le même modèle ».
L’équipage de Maria était principalement composé de déserteurs des flottes de pêche ou de la marine royale. Ceux de la marine étaient faciles à recruter. Ils avaient été forcés à prendre du service et, en cas de désertion, ne pouvaient pas quitter leur navire pendant une période de deux ans après avoir été repris. Les navires de la marine royale étaient souvent humides, sombres et terriblement sales, et la nourriture était recouverte d’asticots. D’ailleurs, le Dr Samuel Johnson décrira leur vie en mer comme suit : « c’est un peu comme être en prison, mais avec l’espoir de mourir noyé ».
Trahir le roi pour servir auprès de la reine pirate se traduisait par des rations d’alcool illimitées, par des punitions moins fréquentes et une meilleure nourriture.
Maria et Eric déjouèrent le destin pendant vingt ans. À la fin, ce fut le mari de Maria qui décida de quitter cette vie de débauche. Fatigués d’être continuellement en fuite et incroyablement riches, les Cobhams remballèrent leur attirail de pirate et levèrent les voiles vers la France. Ils y vendirent leur flotte de navires et leurs marchandises et achetèrent un joli domaine au Duc de Chartres, près du Havre.
Ils avaient maintenant leur propre port privé, du personnel et un endroit sûr, et fréquentaient la belle société française locale. Ils eurent également trois enfants. Eric Cobham se reconvertit en riche propriétaire terrien et pilier respectable de la communauté, complétant sa stupéfiante transformation en devenant un magistrat et ensuite un juge pour les tribunaux de France. Il occupa ce poste prestigieux, condamnant parfois certains de ses anciens comparses, pendant douze ans.
Avec les années, le couple de pirates s’éloigna. Eric accumulait les conquêtes, alors que Maria sombrait dans l’alcool, parfois agrémenté de laudanum, un opiacé reconnu pour ses propriétés antidouleur. Alors qu’Eric bâtissait sa réputation de Casanova, Maria s’enfermait et devint probablement folle.
Un saut fatal?
Un jour, Maria disparut, tout simplement. On lança des recherches, et après deux jours à ratisser les côtes, son corps fut retrouvé dans la mer, sous une falaise près du château des Cobham.
Une autopsie révélera des traces de poison. « Maria, remplie de remords, pourrait s’être empoisonnée au laudanum », conclut Gosse.
Peu de temps après, Eric Cobham la suit dans la tombe. Mais sur son lit de mort, il convoquera un prêtre et lui confessera ses nombreux crimes. On consigna ses confessions, plutôt décousues, et après sa mort, le prêtre tint sa promesse de publier ces récits.
Ce fut un véritable événement littéraire, mais qui n’eut pas l’heur de plaire aux trois enfants du couple. Ils furent horrifiés par ces révélations et étonnés de découvrir que leurs parents respectables avaient été des pirates sans foi ni loi. On dit qu’ils auraient acheté toutes les copies du livre pour les brûler, afin de se débarrasser de ce gênant héritage.
Mais il semblerait que l’on ait retrouvé une version fragmentaire de ce livre aux Archives Nationales à Paris, où elle resta cachée pendant tout le siècle dernier.
La vie de Maria Lindsey Cobham est-elle pure fiction ou réalité? Comme elle ne fut jamais prise, et ne subit jamais de procès, elle demeure une énigme.
Les historiens admettent que si son histoire est vraie, Maria Cobham aura sans doute été la seule femme pirate à terroriser le Canada Altantique.
Ses exploits sont encore transmis d’une génération de marins à une autre. Avouons que rien n’est plus passionnant qu’une bonne histoire de pirate!
Femmes fatales
La piraterie n’est-elle qu’un monde d’hommes? Oh que non! Ces femmes ont pillé et volé avec le même aplomb que les pires d’entre eux.
 Alvilda–Selon un document danois datant du XIIe siècle, Gesta Danorum, Alvilda était la fille d’un roi suédois du IXe siècle. Elle s’enfuit pour ne pas avoir à épouser le mari qui lui était destiné et se joignit à un équipage de femmes pirates, toutes habillées en hommes. Elles sillonnèrent la mer Baltique et firent équipe avec un groupe d’hommes pirates qui avaient perdu leur capitaine. Selon la légende, Alvilda fut finalement vaincue lors d’une bataille en mer par Alf, le prince du Danemark, l’homme qu’elle devait épouser. Elle accepta cette fois sa proposition.
Alvilda–Selon un document danois datant du XIIe siècle, Gesta Danorum, Alvilda était la fille d’un roi suédois du IXe siècle. Elle s’enfuit pour ne pas avoir à épouser le mari qui lui était destiné et se joignit à un équipage de femmes pirates, toutes habillées en hommes. Elles sillonnèrent la mer Baltique et firent équipe avec un groupe d’hommes pirates qui avaient perdu leur capitaine. Selon la légende, Alvilda fut finalement vaincue lors d’une bataille en mer par Alf, le prince du Danemark, l’homme qu’elle devait épouser. Elle accepta cette fois sa proposition.
 Anne Bonney–Fille illégitime d’un riche homme d’affaires de Cork et de sa servante, Anne Bonney grandit au début des années 1700 dans une riche plantation des Carolines américaines. Elle refusa d’obéir à son père qui voulait qu’elle épouse un homme riche et fut déshéritée après avoir convolé avec un marin sans le sou. Elle le quitta plus tard pour un capitaine pirate du nom de John Rackham. Habillée en homme, elle parcourut les mers des Caraïbes avec « Calico Jack » et participa à la capture de nombreux navires. Elle fut prise par les autorités près de la Jamaïque en 1720. Selon l’ouvrage de Charles Ellms de 1855, The Pirate’s Own Book, elle était enceinte au moment de son procès et, contrairement à son mari, ne fut pas exécutée.
Anne Bonney–Fille illégitime d’un riche homme d’affaires de Cork et de sa servante, Anne Bonney grandit au début des années 1700 dans une riche plantation des Carolines américaines. Elle refusa d’obéir à son père qui voulait qu’elle épouse un homme riche et fut déshéritée après avoir convolé avec un marin sans le sou. Elle le quitta plus tard pour un capitaine pirate du nom de John Rackham. Habillée en homme, elle parcourut les mers des Caraïbes avec « Calico Jack » et participa à la capture de nombreux navires. Elle fut prise par les autorités près de la Jamaïque en 1720. Selon l’ouvrage de Charles Ellms de 1855, The Pirate’s Own Book, elle était enceinte au moment de son procès et, contrairement à son mari, ne fut pas exécutée.
 Mary Read—Compagne d’Anne Bonney, Mary Read était également une enfant illégitime. Selon The Pirates Own Book, sa mère célibataire l’éleva comme un garçon. Elle était de forte constitution et servit avec distinction comme soldat, épousant un de ses frères d’armes. Après sa mort, elle prit la mer, en direction des Antilles. Mary Read se joignit finalement à l’équipage de Calico Jack. Elle y rencontra Anne Bonney et les deux restèrent amies fidèles tout au long de leurs aventures. Mary Read fut capturée en 1720, avec Calico Jack, Bonney et le reste de l’équipage. Comme Bonney, elle était enceinte au moment de son procès et son exécution fut retardée. Elle mourut de maladie avant d’être exécutée.
Mary Read—Compagne d’Anne Bonney, Mary Read était également une enfant illégitime. Selon The Pirates Own Book, sa mère célibataire l’éleva comme un garçon. Elle était de forte constitution et servit avec distinction comme soldat, épousant un de ses frères d’armes. Après sa mort, elle prit la mer, en direction des Antilles. Mary Read se joignit finalement à l’équipage de Calico Jack. Elle y rencontra Anne Bonney et les deux restèrent amies fidèles tout au long de leurs aventures. Mary Read fut capturée en 1720, avec Calico Jack, Bonney et le reste de l’équipage. Comme Bonney, elle était enceinte au moment de son procès et son exécution fut retardée. Elle mourut de maladie avant d’être exécutée.
 Madame Ching–Décrite dans le livre de 2004 de Gilles Lapouge Pirates and Buccaneers comme une « femme grossière au visage d’ours », Madame Ching terrorisait les côtes du sud de la Chine au début des années 1800. Veuve du capitaine pirate Ching-Yih, Madame Ching avait du talent pour la piraterie, élargissant la flotte de son défunt mari pour atteindre plus de 2 000 navires. À la fin de sa carrière, elle était une force incontestée dans la région. Elle réussit à obtenir un pardon pour elle et son équipage auprès de l’empereur chinois, qui lui confia le commandement d’une partie de sa flotte impériale. Elle mourut, très riche, en 1844.
Madame Ching–Décrite dans le livre de 2004 de Gilles Lapouge Pirates and Buccaneers comme une « femme grossière au visage d’ours », Madame Ching terrorisait les côtes du sud de la Chine au début des années 1800. Veuve du capitaine pirate Ching-Yih, Madame Ching avait du talent pour la piraterie, élargissant la flotte de son défunt mari pour atteindre plus de 2 000 navires. À la fin de sa carrière, elle était une force incontestée dans la région. Elle réussit à obtenir un pardon pour elle et son équipage auprès de l’empereur chinois, qui lui confia le commandement d’une partie de sa flotte impériale. Elle mourut, très riche, en 1844.
Et Cetera
Pirates of the Atlantic: Robbery, murder and mayhem off the Canadian East Coast by Dan Conlin. Formac Publishing Co. Ltd., Halifax, 2009.
Femmes architectes de Montréal
Dans les années 1960, Montréal était une véritable vitrine d’architecture moderne. De la Place Ville-Marie à la Place Bonaventure en passant par Expo 67, la ville vibrait au son des chantiers de construction. Des immeubles tout à fait remarquables poussaient comme des champignons, d’autant plus remarquables qu’ils avaient en grande partie été conçus par des femmes architectes. Comme le précise ce texte, adapté de Designing Women par Annmarie Adams et Peta Tancred de l’Université McGill, les femmes architectes de Montréal ont transformé bien plus que l’allure de la ville. Elles ont transformé toute une profession.
Dans les années 1960, marquées par le boom économique de l’Ouest et la résurrection de la politique et de la culture après la période conservatrice de l’après-guerre, Montréal s’est retrouvée au cœur du mouvement architectural moderne, pour des motifs liés autant aux circonstances qu’à la personnalité de la ville. Expo 67, la grande exposition mondiale sur l’Île Sté-Hélène et l’île Notre-Dame sur le fleuve St-Laurent, un des grands moments de créativité dans l’histoire canadienne, a permis de faire découvrir les œuvres des plus grands architectes du monde — des pavillons imaginatifs, audacieux et époustouflants. Montréal, alors la plus grande ville du Canada, était un lieu magique en cette année centenaire du Canada, un laboratoire ouvert à l’expérimentation dans le domaine de l’architecture.
Mais les fondements de cette explosion architecturale avaient été établis plusieurs années auparavant. La Place Ville-Marie, cette tour de bureaux cruciforme faite d’aluminium et de verre, a été construite entre 1958 et 1965. Un des plus beaux exemples de design du milieu du siècle au Canada, elle deviendra le symbole véritable du nouveau Montréal. La Place Bonaventure, construite entre 1964 et 1968, était alors une des plus grandes nouvelles constructions du monde moderne. Occupant un site de deux hectares et demi, elle comprenait 93 000 m2 de surface commerciale et 9 300 m2 d’espaces de bureaux, et reliait la gare et le métro. Audacieuse sur le plan structurel, coûteuse, massive et multifonctionnelle, la Place Bonaventure a eu d’importantes répercussions sur l’aménagement urbain de Montréal, lui donnant la réputation d’être une des villes souterraines les plus importantes au monde.
Eva Hollo Vecsei, qui s’est retrouvée au premier plan de la conception et la construction de la Place Bonaventure, a travaillé intensivement à ce projet sous la direction de Raymond Affleck, partenaire de la firme d’architecte ARCOP (Architects in Cooperative Partnership) & Associates. Cette femme architecte sera catapultée au cœur de la grande transformation architecturale de la ville. Née à Vienne en 1930, Mme Vecsei a immigré au Canada après la révolution hongroise de 1957. Elle avait déjà un portfolio fort impressionnant, ayant contribué à de nombreux projets à grande échelle, notamment des logements de mineurs en Hongrie et des écoles à Budapest. Pour l’époque et le lieu, soit le Canada d’après guerre, elle était une véritable figure d’exception. Les quelques femmes canadiennes inscrites dans les écoles d’architecture étaient presque invariablement reléguées à la décoration intérieure, à l’architecture résidentielle et à la préservation historique, des « ghettos » professionnels pour les femmes architectes de l’époque. Elles avaient rarement l’occasion de travailler aux grandes structures commerciales et industrielles qui transformaient le paysage d’une ville et, par conséquent, de se faire un nom dans l’industrie.
Mais Mme Vecsei a vécu dans une période et un lieu exceptionnels. Même si cette exposition, universelle rappelons-le, a été nommée, sans ironie, Terre des Hommes, la turbulence et les transformations sociales des années 1960 ont secoué les normes de la société nord-américaine, notamment le rôle des femmes. Le Québec a vécu des changements en profondeur en très peu de temps. Le décès du premier ministre Maurice Duplessis en 1959 et la défaite de son parti ultraconservateur, l’Union Nationale, lors des élections de 1960, marquèrent le début de la Révolution tranquille au Québec. Au cours des quinze années suivantes, la province passa d’un gouvernement de droite conservateur à un gouvernement nationaliste et séparatiste, le Parti Québécois, qui obtint le pouvoir pour la première fois en 1976. Ces bouleversements politiques reflétaient les grandes transformations sociales et économiques, notamment la diminution marquée de la population vivant de l’agriculture, le délitement de l’Église catholique romaine, la montée de la fonction publique et l’accès accru à l’éducation. C’est dans ce milieu que Mme Vecsei et plusieurs de ses collègues évolueront. Même si le Québec de 1942 fut la dernière province à reconnaître les femmes architectes, les premières expériences de ces pionnières furent vécues bien différemment de celles des autres femmes du reste du Canada. Montréal vivait une période d’effervescence sans précédent dans les années 1960 et les femmes architectes, plus que leurs contreparties ailleurs au pays, pouvaient occuper des rôles de premier plan dans la création du patrimoine bâti. Ce faisant, elles ont modifié leurs trajectoires professionnelles, détruit des mythes sur les femmes au sein de la profession, ouvert la porte aux autres femmes et, pour une bonne part, ont donné à Montréal son visage contemporain.
Leurs réalisations ne passèrent pas inaperçues, mais pas nécessairement pour leur valeur. Dans l’importante couverture médiatique qui suivra l’inauguration de la Place Bonaventure, on mettra beaucoup l’accent sur le fait qu’Eva Vecsei était une femme. Cette dernière n’apprécia pas les sous-entendus des journalistes et prit ses distances par rapport au travail traditionnel effectué par les femmes. Elle dira au Montreal Star en 1965 : « S’il-vous-plaît, ne me mettez pas dans la catégorie des femmes qui ajoutent leur petite touche rose… Je ne veux pas bâtir des maisons uniformes et identiques… Ce qui me passionne, ce sont les grandes structures qui permettent de s’exprimer et qui requièrent des solutions complexes. »
Elle n’était pas seule. Blanche Lemco van Ginkel, diplômée de l’école d’architecture de McGill, avait conçu les plans originaux d’Expo 67 avec son mari. Elle deviendra la première femme doyenne d’une faculté d’architecture en Amérique du Nord, à l’Université de Toronto, en 1980. Dorice Brown Walford a été une des architectes du très innovateur pavillon du téléphone à l’Expo et a ensuite travaillé à la conception de certains des plus grands centres hospitaliers de Montréal, incluant le Allan Memorial Institute de l’hôpital Royal Victoria. Pauline Clarke Barrable, membre de l’équipe d’architectes de la Place Bonaventure, est devenue l’architecte principale de la Banque Royale du Canada. Sarina Altman Katz a également été l’architecte principale pour les projets Habitat des bureaux de Moshe Safdie. Janet Leys Shaw Mactavish a créé des plans innovateurs pour plusieurs écoles de l’ouest de l’île de Montréal, notamment une école circulaire au milieu de laquelle se trouve un auditorium. Au Québec, la plupart des 18 femmes architectes membres de l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) avant 1970 faisaient tout sauf ce que l’on qualifiait alors de « travail de femme ». Elles ont plutôt acquis leur expérience en concevant des immeubles non résidentiels à très grande visibilité. Bon nombre de ces femmes ont d’ailleurs mentionné que leur collaboration aux plans de la Place Bonaventure a joué un rôle crucial pour la suite de leur carrière.
Bon nombre de ces femmes ont bénéficié d’une formation suivie à l’étranger. En Europe de l’Est, d’où provenait Mme Vecsei, les femmes architectes n’étaient pas une denrée rare. Blanche van Ginkel, une Anglaise, avait déjà travaillé en France avec le maître de l’architecture moderne, Le Corbusier, et s’était spécialisée en urbanisme. Dorice Walford, née à Moose Jaw, en Saskatchewan, a aussi travaillé avec Le Corbusier à Paris, ainsi qu’avec Skidmore Owings et Merrill, connus aujourd’hui pour des immeubles tels que la tour Sears de Chicago. Le fait d’être née ou formée en Europe de l’Est, où les femmes architectes représentaient après la guerre une part importante de la profession, leur a permis d’acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires pour se tailler une place sur la scène de l’architecture montréalaise, encore dominée par les hommes.
Certaines femmes ont également bénéficié du poste de leurs maris, également architectes, et qui connaissaient bien les difficultés de cette pratique. Cependant, même si certaines ont réussi à décrocher un poste en épousant un architecte, elles demeuraient invariablement sous-payées. Certains directeurs se demandaient même s’il était vraiment nécessaire de verser deux salaires, puisque la femme travaillait au même endroit que son mari. Néanmoins, certaines firmes ont réellement encouragé les femmes. En effet, ARCOP, deux autres cabinets de Montréal, soit Barott, Marshall, Merrett et Barott (BMMB), et David, Barott, Boulva (DBB), étaient reconnus pour engager des femmes.
Mais l’air du temps, plus que toute autre chose, eut un effet favorable sur le rôle des femmes en architecture. Dans les années 1960, Montréal était au carrefour de la créativité, du capital et de la remise en question des anciennes façons de faire, une ambiance générale qui a ouvert des portes aux femmes. Ce fut un moment décisif. Malgré les obstacles qu’elles devaient surmonter, les femmes architectes du Québec avaient enfin la possibilité de contribuer à la planification et à la conception de grands projets publics et commerciaux. La grandeur de projets tels que l’Expo 67, la rapidité avec laquelle ils ont été conçus et bâtis, les nouvelles façons de travailler en équipes (comme dans le cas de la Place Bonaventure) et le recours à de nouvelles technologies ont permis aux femmes architectes du Québec d’acquérir l’expérience requise pour occuper des rôles d’avant-plan au sein de la profession et ne plus se confiner à des tâches secondaires.
Après 1970, le nombre de femmes architectes au Québec grimpe en flèche. En 1992, 55 % de toutes les femmes architectes canadiennes étaient membres de l’Ordre professionnel des architectes du Québec. En fait, malgré un départ tardif en 1942, les Québécoises sont les plus nombreuses à représenter les femmes au sein de la profession au Canada. Elles sont essentiellement entrées en poste dans les années 1970 et 1980. Au début des années 1970, lorsque Mme Vecsei a commencé à travailler au projet controversé La Cité, un développement urbain polyvalent de 120 millions de dollars qui nécessitait la démolition d’un vieux quartier de maisons victoriennes, le fait qu’elle soit une femme n’a pas soulevé beaucoup d’intérêt, un contraste avec la couverture sur la Place Bonaventure, où l’on soulignait sa perspective à titre de femme et sa « beauté ».
Les reportages sur La Cité n’en feront aucunement mention.
Designing Women: Gender and the Architectural Profession Profession par Annmarie Adams et Peta Tancred est publié par les University of Toronto Press.
Encore une profession « envahie »
Un livre sur les maisons anglaises inspira Esther Marjorie Hill à devenir la première architecte canadienne reconnue par son ordre. « J’y pensais de plus en plus souvent, tout en cachant mes intentions au monde extérieur », confesse Mme Hill lors d’une entrevue en 1921. Après ses études à l’Université de l’Alberta, elle passe à l’Université de Toronto, où elle deviendra la première femme à être admise dans un programme d’architecture. Elle obtint son diplôme le 4 juin 1920 « sous les applaudissements nourris des étudiants », rapportera The Globe le lendemain.
Cependant, tous ne se réjouissaient pas de cette percée des femmes dans le monde de l’architecture. C.H.C. Wright, professeur de Mme Hill à l’Université de Toronto, choisit de boycotter la cérémonie. Le jour précédent, il aurait dit au journaliste du journal The Globe « la femme canadienne a encore envahi une autre profession. »
Mme Hill, une femme qui ne craignait pas la différence, accepta un poste de décoratrice pour le grand magasin Eaton de Toronto après avoir obtenu son diplôme. À son retour en Alberta, en 1921, elle constate que l’accueil qu’on lui réserve à titre de « lady architecte » est beaucoup plus froid que ne lui avait laissé espérer sa cérémonie de remise des diplômes. Son dossier d’inscription à la Alberta Association of Architects fut refusé. S’attendant sans doute à recevoir sa demande, l’Association décide d’imposer une nouvelle exigence, soit une année complète d’expérience professionnelle. Ce n’est qu’en 1925, à la suite d’études supérieures en urbanisme à l’Université de Toronto, d’un cours d’été à l’Université Colombia et d’un stage dans une firme d’architectes de New York que Mme Hill fut finalement acceptée par l’Association de l’Alberta, et deviendra la première femme architecte canadienne professionnelle.
Cependant, Mme Hill ne fut pas la seule victime de cette résistance au sein de la profession. La première femme à s’inscrire auprès de l’Association des architectes de l’Ontario (AAO) était Alexandra Biriukova, mieux connue pour sa conception d’une des grandes réalisations du modernisme canadien, la maison de l’artiste du Groupe des sept, Lawren Harris. Comme bon nombre des femmes architectes qui pratiquèrent au Québec une génération plus tard (voir l’article principal), elle arrivait d’Europe de l’Est et avait déjà une formation d’architecte. Malheureusement pour l’histoire de l’architecture canadienne, elle remit sa démission de l’AAO en 1934 et consacra le reste de sa vie à soigner les tuberculeux, à Toronto.
Pendant la période précédant la Seconde Guerre mondiale, il n’y avait que cinq femmes architectes, incluant Mme Hill. Par rapport à d’autres pays, l’entrée des femmes canadiennes dans la profession fut tardive. Louise Blanchard Bethune fut la première femme à devenir membre du American Institute of Architects, en 1888. Ethel Charles devint une architecte agréée dès 1898, en Angleterre.
Après un second stage à New York, Mme Hill revint en Alberta en 1928 pour travailler avec une firme d’Edmonton, notamment au projet de bibliothèque publique de la ville. Le travail se faisant plus rare pendant la Dépression, elle se mit au tissage, fabriqua des gants et des cartes de souhaits, et enseigna. Elle déménagea à Victoria en 1936, mais sa pratique en architecture ne débuta réellement qu’après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’elle commença à dessiner des maisons modernes et pratiques pour les anciens combattants et leurs familles, au coût de 50 $ par maison. Ses maisons sont faciles à reconnaître : elles sont généralement de forme rectangulaire et les côtés longs encadrent l’entrée principale. Les maisons de Mme Hill comprennent également de larges avant toits, des plafonds à gorges, de grandes fenêtres, un foyer surélevé, des vestiaires, plusieurs meubles intégrés et de grands espaces de rangement.
Comme pour de nombreuses femmes architectes du Canada anglais, les cuisines représentaient une part importante de leur travail. Et comme les cuisines sont souvent les premières pièces que l’on rénove dans les vieilles maisons, les cuisines de Mme Hill sont pratiquement disparues, cachées dans les murs de maisons conçues pas d’autres (hommes) architectes. Les cuisines de Mme Hill étaient efficaces et épurées, et comportaient des détails astucieux, comme des comptoirs élevés (90 cm) aux coins arrondis, des plateaux tournants, des électros encastrés et des passe-plats entre la zone cuisine et la zone repas. Elle a reçu une rémunération de 60 $ pour une cuisine de Victoria conçue en 1966, pour une maison bâtie en 1930.
Sans doute que sa propre cuisine lui a servi de modèle, puisqu’elle installa son bureau au rez-de-chaussée de la maison de ses parents, peu après le décès de son père en 1960. Le télétravail était et demeure une approche plus fréquemment adoptée par les femmes architectes. Mme Hill ne s’est jamais mariée et semble n’avoir eu ni employés, ni associés. Son père, Ethelbert Lincoln Hill, qui a été bibliothécaire en chef à la bibliothèque publique d’Edmonton de 1912 à 1936, fut un personnage important dans sa vie. C’est même elle qui a tissé les étoffes dont étaient faits les costumes et manteaux de son père.
Parmi les bâtiments publics plus imposants auxquels a collaboré Mme Hill à Victoria, notons le Glenwarren Lodge, la première résidence pour aînés au Canada. Elle a également conçu l’annexe de l’église Emmanuel Baptist en 1955, aujourd’hui le théâtre Belfry.
Marjorie Hill est décédée en 1985 à l’âge de 89 ans en nous léguant des maisons et des bâtiments distinctifs. Même si, en tant que femme, elle a été une pionnière au sein de la pratique de l’architecture au Canada, elle demeure peu connue. Espérons que sa contribution sera un jour reconnue à sa juste valeur.
Cet article est paru à l’origine dans le numéro de décembre 2000-janvier 2001 du magazine The Beaver.
Sur les traces d'Abraham Ulrikab
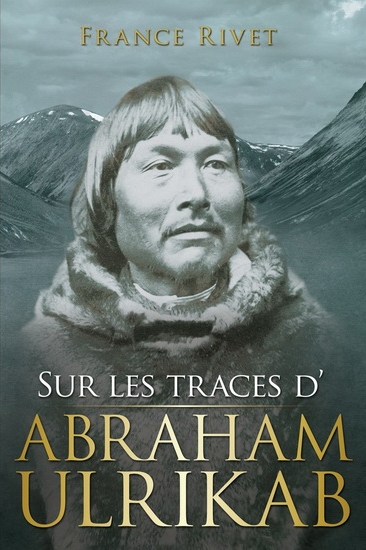
France Rivet. Sur les traces d'Abraham Ulrikab. Gatineau, Horizons polaires, 2015. 360 pages.
Résumé :
En août 1880, deux familles inuites du Labrador acceptent l'offre du Norvégien Johan Adrian Jacobsen de devenir la plus récente attraction des spectacles ethnographiques organisés par l'Allemand Carl Hagenbeck. Parmi eux, Abraham Ulrikab (Abraham, le mari d'Ulrike), un homme chrétien de 35 ans, qui espère ainsi gagner suffisamment d'argent pour lui permettre d'améliorer les conditions de vie de sa famille lorsqu'ils seront de retour à Hebron l'année suivante.
Le groupe est exhibé à Hambourg, Berlin, Prague, Francfort, Darmstadt, Krefeld et Paris. Très vite, les Inuits comprennent leur erreur et ils n'ont plus qu'un souhait, celui de rentrer chez eux.
« Un an à passer c'est bien trop long parce que nous voudrions rentrer vite dans notre pays, parce que nous sommes incapables de rester toujours ici. Oui vraiment! C'est impossible! »
Malheureusement, le destin en décide autrement. Moins de quatre mois après leur arrivée en Europe, le groupe est décimé par la variole. Trois d'entre eux meurent en Allemagne. Les cinq autres, y compris Abraham, meurent à Paris.
Bien qu'Abraham et Johan Adrian Jacobsen aient tous deux laissé des journaux personnels, l'histoire des « Esquimaux » du Labrador est, jusqu'à ce jour, restée incomplète. Où les Inuits ont-ils été enterrés? Qu'est-il advenu de leurs restes? Qu'est-il advenu de la calotte crânienne de la femme païenne que Jacobsen a cachée dans ses vêtements et a transportée avec lui jusqu'à Paris? Qu'est-il advenu des artefacts recueillis par Jacobsen dans des sépultures au Labrador?
En 2010, après sa lecture du journal d'Abraham, et intriguée par toutes ces questions sans réponses, France Rivet s'est mise à fouiller. Des chercheurs avaient étudié le dossier des « Esquimaux » avant elle mais personne ne s'était encore rendu à Paris pour chercher les traces que les Inuits y avaient laissées. De découverte en découverte, des pans insoupçonnés de l'histoire sont apparus. Quatre ans et trois voyages de recherche en Europe plus tard, Sur les traces d'Abraham Ulrikab révèle les résultats de cette investigation.
Finalement, 133 ans après la mort d'Abraham, de Maria, de Nuggasak, de Paingu, de Tigianniak, de Tobias, de Sara et d'Ulrike, les événements qui se sont déroulés à Paris avant et après leur mort sont désormais élucidés. Ceci dit, le dernier chapitre n'a pas encore été écrit puisque cette recherche a mis en lumière la possibilité de changer le cours de l'histoire d'Abraham : son vœux exprimé de rentrer au Labrador pourrait devenir une réalité.
Il revient à la communauté inuite du Labrador d'écrire ce nouveau chapitre, au cours des mois et des années à venir, alors qu'elle débattra du rapatriement de leurs restes. Nous souhaitons ardemment que ce livre lui fournisse toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse prendre une décision éclairée qui lui permettra d'éventuellement boucler la boucle sur cette tragique histoire.
Acheter chez Renaud Bray
Kaléidoscope Expo 67 - Dix scènes de Terre des Hommes
La preuve que les années soixante ont bel et bien existé
J’ai déjà entendu parler d’une fille de Hamilton, en Ontario, qui portait une jolie petite tenue et a décidé d’abandonner le groupe d’élèves de son école catholique dès leur sortie du métro à l’île Sainte-Hélène, et c’est là qu’elle a rencontré Yvan, ou quelque chose du genre, d’Outremont et ensemble ils ont visité le pavillon soviétique et celui de l’Homme à l’oeuvre, ils ont également pris place à bord du minirail bleu mais la file d’attente pour entrer au Labyrinthe était trop longue, alors ils ont vu le film à 360o sur le Canada et tout le monde était si gentil partout et si élégant, et elle a embrassé Yvan à Katimavik et il l’a amenée voir les feux d’artifice à La Ronde et ensuite elle est retournée en Ontario avec les soeurs et aujourd’hui, elle a des filles plus âgées qu’elle à cette époque, mais elle se souvient de ce moment comme des scènes d’un film de Claude Lelouch avec des écrans partagés et une trame musicale pop et elle se demande souvent ce qu’il est advenu de ce garçon, Yvan, et essaie de se souvenir de l’endroit où elle avait acheté sa belle petite tenue, et elle se dit, ouais bébé, c’était ça les années soixante, Expo 67 à Montréal, à Terre des Hommes.
D’accord, je ne sais pas si l’on peut vérifier chaque détail de cette histoire. En fait, si vous avez moins de cinquante ans, vous êtes probablement trop jeune. Plus de soixante-quinze, et vous aviez à l’époque près de quarante ans et n’étiez plus tout à fait « dans le vent ». Oui, j’aborderai des faits historiques dans cet article. Mais si vous ne pouvez plus supporter la vantardise des baby-boomers au sujet de leur génération « exceptionnelle », alors mieux vaut lire la section des critiques de livres ou autre chose, car ce sera tout de même difficile à éviter.
En plein coeur de l’exposition, le grand auteur montréalais, Hugh Hood, déclara : « C’est trop, bébé; c’est totalement différent, une synesthésie romantique, en plein ça. » Nous parlions vraiment de cette façon à l’époque, comme si le fait d’être jeune et de vivre l’Expo 67 c’était un peu comme « se trouver au paradis ».
Un désastre annoncé
« J’habitais à quelques mètres du boulevard Pie-IX, qui semblait être la route principale empruntée par les camions chargés de la terre visant à remplir le site. Pendant environ un an, la rue, une grande artère de Montréal, fut couverte de terre. Par temps pluvieux, on pataugeait dans la boue. »
— Alan, un Montréalais, dans la vingtaine en 1967.
Moscou avait été choisie ville hôte de l’exposition universelle de 1967. Ce n’est qu’après le retrait des Soviétiques que Montréal eut sa chance. Le projet prend du temps à se mettre en branle. Le gouvernement Diefenbaker n’était pas très intéressé. Personne ne croyait les promesses ambitieuses du maire, Jean Drapeau. Le plan visant à construire de nouvelles îles dans le fleuve Saint-Laurent semblait complètement fou. Au cours de l’année 1964, les fonctionnaires du gouvernement cherchaient des façons de reporter l’exposition universelle. Les Canadiens s’attendaient à ce que l’événement soit une honte, une catastrophe et un déshonneur pour la nation.
Mais les nations du monde entier signèrent leur accord. L’idée des îles ne semblait plus aussi stupide. Et sur ces îles commencèrent à se dresser des structures et des pavillons tous plus époustouflants les uns que les autres. À ce moment précis de l’histoire de l’Expo, Montréal puisait dans ce qu’il y avait de meilleur, partout dans le monde. Dès son ouverture, le 28 avril 1967, c’était l’endroit où tous rêvaient d’aller. Les Canadiens venaient de réaliser qu’ils avaient toujours su que ce serait merveilleux.
Les trois Pères de l’Expo : Drapeau, Dupuy, Churchill
Drapeau était un petit homme énergique et volontaire. La rumeur selon laquelle Montréal aurait un métro et une exposition universelle commençait à faire son chemin, on entendait parler de la construction de nouvelles îles, un concept plutôt étonnant. Et un jour, au Ed Sullivan Show, voilà qu’on présente Jean Drapeau! C’est à ce moment qu’on s’est dit : « Mon Dieu, c’est donc vrai tout ça ». Montréal était une ville fière en 1967, elle passait à l’histoire, elle était au centre du Canada.
— Carol, une Montréalaise, âgée de 18 ans en 1967.
Jean Drapeau a été le maire de Montréal pendant la majeure partie de la période s’échelonnant de 1950 à 1986, et même si l’Expo 67 n’était pas son idée, c’est grâce à lui qu’elle s’est concrétisée. La fin de sa carrière sera difficile, il est taxé de mégalomane et les Jeux olympiques entraîneront une lourde dette, mais au début des années soixante, il offre à Montréal sa Place des Arts et un nouveau métro, et il donne naissance à une nouvelle vague de développement urbain… et à l’Expo.
Pierre Dupuy, grand diplomate canadien, sera nommé commissaire général de l’Expo en 1963. Dupuy niera fermement avoir « vendu le Canada et l’Expo au reste du monde ». Il affirme qu’il a tout simplement convaincu les nations du monde de l’intérêt qu’elles auraient à participer à la plus grande exposition universelle jamais organisée. Soixante-deux pays répondirent à l’appel, un record. Cinquante millions de personnes visitèrent l’exposition, soit deux fois plus que ce l’on avait prévu.
Dupuy recrute rapidement une équipe de Canadiens anglophones et francophones pour bâtir son Expo. Le colonel Edward Churchill, un ingénieur des Forces canadiennes responsable de la construction, se servit d’un ordinateur pour établir un calendrier des travaux reposant sur le concept de « chemin critique » . À cette époque, la gestion informatisée et le recours à un chemin critique étaient des notions si novatrices qu’elles semblaient presque magiques. Mais au-delà de toute cette modernité, Churchill n’avait qu’une obsession : le respect des échéanciers.
Le triomphe du design
Nous avons été tellement impressionnés par Habitat, que d’idées nouvelles et incroyables! La façon dont les appartements sont disposés en angle et sans symétrie, tout le contraire de ce l’on observe dans un gratte-ciel. Une réalisation à la fois complexe et fascinante, quel que soit l’endroit ou l’on pose les yeux.
— Blanche, dans la quarantaine à l’époque, qui a pris le train de Penticton, en C.-B., avec son mari et ses trois adolescents.
On avait conçu et construit tout le secteur de façon à ce que l’on puisse en faire le tour. Même les poubelles étaient design! Elles étaient utiles et s’intégraient au décor général.
— John de Toronto, dans la trentaine, avec ses jeunes enfants. — John de Toronto, dans la trentaine, avec ses jeunes enfants.
En 1968, Robert Fulford publiera Portrait de l’Expo, un livre-souvenir qui est également un essai critique perspicace. Il avait deviné que le principal héritage de cette exposition serait l’architecture. Habitat 67, un complexe d’appartements préconstruit tout à fait inusité, établit la réputation de Moshe Safdie. Fulford adorait le pavillon américain de Buckminster Fuller, un dôme géodésique spectaculaire, le plus grand jamais construit, et le pavillon aérien de l’Allemagne, une innovation dans le domaine des constructions à structures flottantes. Un architecte visitant l’Exposition a affirmé qu’il « s’agissait de la plus époustouflante collection de structures qu’il ait jamais vue ».
Mais Expo 67, ce n’est pas que des bâtiments. Expo 67 est un des premiers lieux en Amérique du Nord bâtis en fonction du plaisir des visiteurs, un endroit où s’entremêlent éducation, loisirs et commerce, un lieu où les foules peuvent se promener, admirer le paysage, manger des mets exotiques, magasiner et voir un spectacle. Granville Island à Vancouver, les Waterfront Properties à Halifax, the Forks à Winnipeg et cet endroit sur les rives de la rivière Bow à Calgary ont tous un petit quelque chose d’Expo 67. Fulford souligne le travail d’un designer colombien, Luis Villa, pour ses concepts d’une grande élégance qui relient l’ensemble des infrastructures.
Terre des Hommes, un monde en fête
Nous visitions Terre des Hommes avec l’école et on essayait de nous enseigner des choses, alors que les plus vieux d’entre nous ne faisaient que s’amuser. Ils visitaient d’autres pays! On savait très bien que l’année suivante, ils les visiteraient « pour de vrai », sac au dos. À l’Expo, tout était si nouveau et si international.
— Rita, Montréalaise, âgée de 12 ans.
Pierre Dupuy a affirmé que dans la plupart des autres expositions universelles, on choisissait un thème qu’on s’empressait ensuite d’oublier. Terre des Hommes/Man and His World, une image inspirée par l’auteur et visionnaire français Antoine de Saint Exupéry, était un thème fort. L’Expo sera la première manifestation d’une philosophie humaniste reposant sur le partage, les possibilités technologiques, les prouesses créatives et une confiance absolue dans le pouvoir de l’humanité et son potentiel. En fait, l’Expo témoigne du triomphe du monde occidental. La République populaire de Chine de Mao Tse Tung n’est pas représentée (mais Taïwan le sera), l’Afrique à peine, et l’Amérique latine n’y fait que de timides apparitions. Dans le roman de Stephen Gill intitulé Immigrant, ce dernier raconte qu’un visiteur sud-asiatique se fait demander un autographe simplement du fait qu’il est exotique. Cette confiance dans la capacité de l’humanité à réaliser de grandes choses était présente partout. Le monde de l’homme était voué à l’excellence, tout n’était qu’une question de perfectionnement.
« La découverte de la fierté »
On pouvait voir l’Expo 67 à bord du bateau qui entrait dans le port de Montréal. Tôt le matin, l’éclat du dôme géodésique de Buckminster Fuller reflétait l’espoir et l’optimisme. J’étais impatiente de vivre le Canada, de vivre une nouvelle vie. Montréal était une ville merveilleuse, et ma première image du Canada me vient de l’Expo.
— Trysh, une immigrante de Grande-Bretagne, au début de la vingtaine.
Pierre Dupuy intitula ses mémoires Expo 67 ou la découverte de la fierté. « Que se passe-t-il avec notre voisin d’habitude si ennuyeux? » se demandaient les Américains. Les Britanniques affirment que l’Expo a de l’éclat et du sex appeal, tout en étant… Canadien? Selon Dupuy, cette poussée de confiance et de fierté à l’égard de cette grande réalisation et de sa reconnaissance internationale changera le Canada à tout jamais. Le jour de l’ouverture, le journaliste Peter C. Newman écrivit : « C’est la plus grande chose que nous ayons réalisée en tant que nation ».
Il y a un moment dans presque chaque décennie où le Canada « devient une nation », et l’Expo 67 fut certainement un de ces moments. Alors que les merveilleuses célébrations du centenaire battent leur plein, au cœur d’Expo 67, jamais les Canadiens n’ont été plus fiers ni plus patriotiques.
Le pavillon du Canada prend l’allure d’une vaste pyramide inversée et est baptisé Katimavik, signifiant « lieu de rencontre » en inuktitut. Il n’y a pas grand-chose à y faire, mais l’endroit devient en quelque sorte un lieu de recueillement. « Tout le monde était si heureux, se souvient un Canadien, nous ne savions pas ce que le reste du pays pensait de nous, et du jour au lendemain, nous allions à la rencontre d’autres Canadiens qui avaient un secret : nous avons réellement un pays à nous. À chaque moment, nous rencontrions des gens, nous leur touchions, nous nous exclamions "je ne peux pas croire que tout cela soit vrai" ».
Une nouvelle relation avec le cinéma
De merveilleux films, projetés sur les murs et sur les plafonds, partout! Le fameux film Ontari-ar-ario et toutes ces images fractionnées. J’ai vu la naissance d’un bébé au cinéma, je n’avais jamais vu rien de tel.
— Judith, douze ans, venue d’Espanola, en Ontario, avec sa mère.
Je me souviens du film projeté à 360°, sans doute une technique périmée aujourd’hui, mais je me rappelle distinctement m’être accrochée à la rampe pendant la scène de l’hélicoptère.
— Barbara, début de la vingtaine, Britanno-Colombienne fonctionnaire à Ottawa.
Avec Expo 67, le film déborde des salles fermées à un seul écran et où le public est immobile. L’événement devient une vitrine de l’innovation dans ce domaine : interactivité, écrans multiples et omniprésence. Les gens ne visitaient pas l’Expo pour les films, mais ceux qui furent présentés annonçaient ce que serait le cinéma du futur.
Mais c’était bien plus que du cinéma. En 1968, Robert Fulford écrit : « À l’Expo, on a entrevu un monde où toutes les ressources qui auparavant étaient réservées aux industries privées et au monde du showbusiness, soit le film, l’éclairage, les environnements soigneusement organisés, pouvaient maintenant être exploitées par des professionnels de l’éducation, dans les écoles, les galeries et les musées ». L’éducation au moyen de l’électronique. Pour le meilleur et pour le pire, c’est la voie que nous suivons depuis cette époque.
« Aujourd’hui, l’Expo fait partie de l’identité québécoise »
En 67 tout était beau/C’etait l’année d’l’amour, c’était l’année d’l’Expo
— Le groupe québécois Beau Dommage, avec le « Blues d’la métropole », 1975.
« Tout le monde a sauté sur cet événement extraordinaire qu’était l’Expo 67 pour bâtir une image flatteuse et enthousiaste du Québec », écrit l’anthropologue de l’Université Laval, Pauline Curien. Sa thèse de doctorat de 2003 sur l’Expo 67 analyse la façon dont l’Expo a contribué à créer une nouvelle image du Québec français, soit le moment où le monde moderne a cessé d’être une menace. En 1967, le Québécois francophone moderne supplante l’image folklorique du Canadien-Français dans l’imaginaire populaire. À l’Expo, les Québécois choisiront tout simplement la modernité.
Les pavillons du Québec et de l’Ontario semblaient avoir été intervertis, ce qui ne passa pas inaperçu auprès des visiteurs. Alors que le pavillon-tente « aérien » de l’Ontario symbolise la joie de vivre, le cube de verre du Québec représente l’énergie, la technologie et l’élégance urbaine. Pauline Curien prétend que le pavillon du Québec renvoyait l’image d’une société libérée de son passée et tournée vers l’avenir, où foi, tradition et Église catholique cédaient le pas à la raison, à la modernité et à l’État.
L’Expo 67 prouve que les familles catholiques canadiennes-françaises traditionnelles avaient donné naissance à l’un des peuples les plus cool du monde. Le Québec y a découvert ce dont il était capable. Le message que véhicule l’Expo sur sa portée mondiale, ses prouesses techniques et les gloires du monde moderne est également une découverte pour le jeune Québec.
Les Filles de l'Expo
Ma sœur a travaillé à l’Expo. Elle portait une tenue d’hôtesse conçue par John Warden. On allait à Montréal pour voir les filles, c’était l’époque des mini-jupes et des « pantailleurs », tout le monde était beau!
— Carol, Montréal, 18 ans.
En lisant les documents et les guides de l’époque, on pourrait croire qu’il n’y avait jamais eu de jolies filles avant, ou encore que les hommes ne les avaient jamais remarquées! Même après quarante ans, je m’étonne encore de lire des textes sur 1967 où l’on parlait des filles de l’Expo, comme si elles faisaient partie du design, du décor, des objets de beauté que l’on admire béatement. Les hôtesses étaient belles et bilingues et elles portaient de jolies petites tenues, leurs cheveux étaient longs et droits. En fait, elles représentaient toutes les filles de Montréal cet été-là. C’était vraiment une Terre des Hommes! Aujourd’hui, je crois que personne n’oserait donner un tel nom à une exposition.
Être là, tout simplement
Les foules – j’adorais les foules, joyeuses, contentes de faire partie de la fête, j’aime les foules quand elles sont comme ça. Les gens parlaient français, c’était chic et de bon goût, et on ne s’ennuyait pas un instant. Toute l’ambiance de l’Expo était si rafraîchissante, si nouvelle, si « dans le vent ». La Ronde était un endroit merveilleux!
— Elaine, 21 ans, du New Hampshire, qui visita l’Expo à plusieurs reprises.
J’ai vu l’orchestre du Bolshoï à la Place des Arts. Quand je repense à la richesse des œuvres présentées à la Place des Arts cet été-là! Ce fut un moment fascinant pour notre culture canadienne : nos artistes se retrouvaient aux côtés des meilleurs au monde. Toute cette richesse culturelle m’émerveille encore. C’est là que je suis tombé en amour avec Montréal.
— Guenther, 17 ans, de Cambridge, en Ontario.
Un moment d’euphorie sans précédent, un éclair de lucidité qui nous a fait comprendre ce que c’était que d’être Canadien.
— Gunda, une jeune adulte de retour au Canada après un séjour en Europe.
Il y avait foule. Dès les premiers jours jusqu’à la fermeture en octobre, on a accueilli bien plus de visiteurs que ce l’on avait prévu. L’hébergement était problématique. Il y a eu des scandales sur l’approvisionnement en nourriture, des moments de panique lors des longues files d’attente qui faisaient le tour des pavillons les plus populaires, tous les jours.
Quarante ans plus tard, les seuls qui se souviennent de ces détails sont les parents accompagnés de leurs jeunes enfants. Pour les autres, les foules étaient plaisantes, la nourriture excellente et nouvelle, et les souvenirs des longues files d’attente sont depuis longtemps effacés. Mais encore aujourd’hui, tous ceux qui étaient là évoquent le plaisir de faire partie d’Expo 67, tout simplement.
Christopher Moore est un historien et un auteur de Toronto et un chroniqueur régulier de Canada’s History. En 1967, à 17 ans, il partit de la Colombie-Britannique pour visiter l’Expo à Montréal, sans cependant avoir l’occasion d’embrasser une fille. Il remercie ses amis et associés, partout au pays, qui lui ont fait part avec tant d’enthousiasme de leurs souvenirs d’Expo 67. Le livre de Robert Fulford Portrait de l’Expo, est une source exhaustive d’information sur le sujet.
Choisir de grandes femmes

Michèle Dagenais, professeure titulaire au département d'histoire de l'Université de Montréal
La Société Histoire Canada a demandé à six femmes distinguées qui excellent dans leur domaine de créer une liste de trente personnalités féminines ayant marqué l’histoire de notre pays. Après un avoir parcouru le dossier de chacune de ces femmes, un vote des six juges a permis de dresser un palmarès des 10 femmes les plus marquantes de notre histoire. Les résultats ont surpris certaines personnes, y compris les juges elles-mêmes.
Nous vous invitons à écouter une entrevue que nous avons réalisée avec l’une des membres du jury, Michèle Dagenais, professeure titulaire au département d’histoire de l’Université de Montréal.
VOTEZ pour une des grandes femmes du Canada !
De retour à la maison après plus d’un siècle
Pour compléter l’article intitulé Tragedy in the Zoo de l’auteure France Rivet publié dans le numéro février/mars 2016 du magazine Canada’s History, nous vous proposons de visionner une entrevue réalisée avec l’auteure dans le cadre de l’émission 64’ Le monde en français diffusée sur la chaîneTV5 Monde. Madame Rivet relate l’histoire de deux familles inuites du Labrador décédées en Europe alors qu’elles étaient exhibées dans des zoos et raconte aussi les efforts déployer pour rapatrier les restes de ces individus.
Pour en savoir plus :
Baladodiffusion - Sur les traces d’Abraham Ulrikab - Durée: 13 minutes 50 secondes
Émission radiophonique: Soirée boréale
Soirée boréale est une émission de radio quotidienne diffusée en français sur la vie des Autochtones et des habitants du Nord-du-Québec. Joignez-vous à Caroline Nepton Hotte tous les jours afin de découvrir la vie politique, économique, culturelle et traditionnelle au nord 50e parallèle.
Entendre la baladodiffusion
Site Web
Grande voyageuse, photographe, rédactrice pigiste, chercheuse, éducatrice, France Rivet consacre sa passion et ses énergies à faire découvrir les richesses des régions polaires. Pour en savoir plus au sujet de ses projets et en apprendre davantage au sujet des familles inuites du Labrador décédées en Europe alors qu’elles étaient exhibées dans des zoos, vous pouvez visiter Polarhorizons.com
Accéder au site Web d' Horizons polaires
Lecture :
France Rivet. Sur les traces d'Abraham Ulrikab. Gatineau, Horizons polaires, 2015. 360 pages.
Acheter chez Renaud Bray
L’autre Marie Morin: Une femme abandonnée en Nouvelle-France, 1667-1748
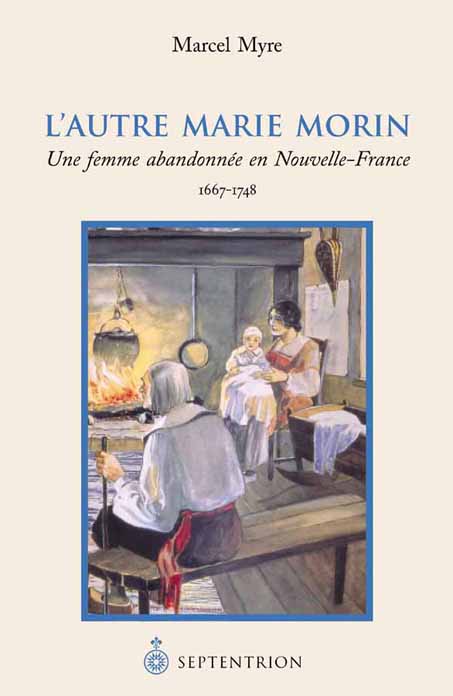
Marcel Myre. L’autre Marie Morin: Une femme abandonnée en Nouvelle-France, 1667-1748. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2004. 200 pages.
Marie Morin, la religieuse, est un personnage bien connu dans l’histoire de la Nouvelle-France. Elle est l’auteure des Annales de l’Hôtel-Dieu de Montréal, une institution dont elle a été l’économe et la supérieure.
Une autre Marie Morin vivait à Montréal, à cette époque, dans des conditions bien différentes. Née dans un milieu modeste, mariée à 12 ans, elle est abandonnée par son mari qui s’enfuit en Nouvelle-Angleterre avec sa demi-sœur. Marie Morin connaît ensuite diverses aventures, se marie deux fois, donne naissance à dix enfants et meurt dans la solitude à l’Hôtel-Dieu.
Acheter chez Renaud Bray
En mars 2016, abonnez-vous au bulletin d’information Histoire à suivre et courez la chance de gagner ce livre!
Abonnez-vous à Histoire à suivre!
Un visage, un nom

Dans l’édition avril/mai du magazine Canada’s History nous vous proposons un article intitulé Perfect Picture de l’auteure et archiviste Bronwen Quarry. L'article porte sur la photographe canadienne Lorene Squire reconnue pour ses clichés remarquables réalisés dans les années 30 dans le Nord canadien. Pour compléter ce portrait, nous vous proposons de découvrir le projet Un visage, un nom piloté par Bibliothèque et Archives Canada.
Le projet vise à trouver le nom des Inuits représentés dans certaines collections photographiques de la bibliothèque. « Il s'agit d'un projet permanent, qui aide les jeunes du Nunavut à établir des liens avec les aînés de leurs collectivités et à mieux comprendre leur passé. Il contribue aussi à combler l'écart culturel et la distance géographique entre le Nunavut et les régions du Sud du pays ».
Les photos numérisées dans le cadre du projet Un visage, un nom proviennent de collections publiques et privées et portent sur une période allant de la fin des années 1900 aux années 1970.
Les photos présentées dans le cadre du projet proviennent des collections de :
Visiter le site Web Un visage, un nom
Ernest Dufault alias Will James

Pour l’édition avril/mai du magazine Canada’s History, l’auteur Brian Brennan signe un article intitulé Outlaws portant sur les hors la loi célèbres ayant marqués l’histoire de l’Ouest canadien. Parmi eux, un Canadien français a marqué l’imaginaire de plusieurs en devenant une véritable légende. Ernest Dufault, alias Will James, a eu un parcours étonnant qui mérite qu’on s’y attarde de nos jours. Ainsi, pour compléter l’article de Brian Brennan, nous vous proposons différentes ressources vous permettant de mieux saisir le phénomène Will James.
Cinéma
Alias Will James
Office national du film du Canada, Jacques Godbout, 1988, 83 min 27 secondes
Synopsis:
Comment un Québécois pure laine a-t-il pu devenir un romancier américain célèbre et le cow-boy le plus authentique de Hollywood? En fabulant! Alias Will James raconte l'histoire invraisemblable d'Ernest Dufault qui, avec la complicité tacite de sa famille, a réussi à séduire (et tromper) pendant trente ans la royauté européenne et la société américaine. Voleur de chevaux, vagabond, artiste et écrivain, Will James est encore aujourd'hui, dans le Far West américain, un personnage mythique.
Alias Will James par Jacques Godbout, Office national du film du Canada
Entrevue
Sur les traces de Will James
Radio-Canada Première
La croisée, le jeudi 4 septembre 2014, 10 minutes 07 secondes
Le cinéaste québécois Claude Gagnon parle de Will James et de son film en préparation.
Écouter la baladodiffusion de l'entrevue
Le public peut suivre la préparation du film et aider le cinéaste Claude Gagnon en le suivant via son blogue et sa page Facebook:
Blogue Sur les traces de Will James
Page Facebook du projet de film
Lecture
 Will James. L'Enfance d'un cow-boy solitaire. Montréal, Les Éditions du Boréal, 1989. 78 pages
Will James. L'Enfance d'un cow-boy solitaire. Montréal, Les Éditions du Boréal, 1989. 78 pages
Pour le public américain, Will James a été pendant longtemps une incarnation du légendaire cow-boy solitaire du Far West. Dans ce livre supposément autobiographique qu'il fit paraître en 1930, «Will James» se recrée une enfance à sa mesure.
Acheter chez Archambault
Musique
Will James
par Luce Dufault
La chanson fut écrite et composée par Nelson Minville pour la petite nièce de Will James, la chanteuse Luce Dufault.
Le Canada, terre d’asile
Dans l’édition avril-mai 2016 du magazine Canada’s History, Allan Levine signe un article intitulé Slow Road to Tolerance. Sur l’échiquier mondial, le Canada fut souvent montré en exemple au cours de sa jeune histoire comme un modèle à suivre en ce qui a trait à l’accueil et l’intégration des immigrants. Terre d’accueil, riche diversité culturelle et tolérance sont des épithètes souvent accolées au Canada. À qui ou à quoi devons-nous cette réputation? Levine, dans son article cherche l’origine et les traces de ce Canada ouvert sur le monde.
En complément, nous vous proposons un certain nombre de ressources vous permettant de mieux comprendre l’histoire de ce Canada terre d’accueil de millions d’immigrants.
Exposition en ligne
Le vécu des immigrants. Immigrer et s’installer en terre canadienne.
Bibliothèque et Archives Canada

La création de ce site Web répondait à deux objectifs. D'abord faciliter, pour les généalogistes et autres chercheurs, l'accès à certains documents sur l'immigration qui se trouvent dans les fonds de BAC et qui sont fréquemment consultés, telles les listes de passagers et les concessions de terre. Dans la section Trouver un immigrant , les chercheurs pourront apprendre comment accéder aux documents relatifs à un immigrant particulier; dans la section La trace documentaire des immigrants, ils recevront de l'information concernant les principales « collections » de BAC sur l'immigration.
En deuxième lieu, le site se veut un témoignage unique de l'immigration que le pays a connue de 1800 à 1939. En visitant la section intitulée Les vestiges du passé. Directives, débats et rêves, les usagers pourront accéder à une exposition virtuelle dont les textes ont été écrits par des spécialistes, et qu'illustre une vaste documentation puisée dans les archives sur l'immigration conservées à BAC.
Exposition en ligne
À la croisée des cultures : 200 ans d’immigration au Canada (1800-2000)
Musée canadien de l’histoire

Depuis les années 1960, le Musée canadien des civilisations collectionne des artefacts issus de l'immigration et recueille des informations sur les traditions culturelles. Il s'agit des artefacts apportés au pays par les immigrants, des articles créés par les immigrants et leurs descendants en empruntant des matériaux canadiens et des idées locales, et des articles qui continuent à être utiles et fonctionnels dans les foyers d'immigrants. Le Musée collectionne aussi des documents historiques, sociaux, familiaux et culturels afin de mettre en contexte ces artefacts et leurs origines culturelles.
Le Musée canadien des civilisations continuera à suivre et à documenter les changements sociaux et le dynamisme culturel de la population grandissante du Canada. Il continuera aussi à collectionner des artefacts et des documents associés au patrimoine culturel divers du pays, à préserver, à promouvoir et à étudier ce patrimoine, et à le présenter au public.
Film documentaire
Au Canada
Office national du film du Canada,
2014, 21 minutes 48 secondes
Film bilingue de 20 minutes qui présente les histoires et expériences personnelles de différents immigrants au Canada de partout autour du monde. Les impressions personnelles et les réflexions partagées dans le film touchent les thèmes du voyage, de l’arrivée et de l’appartenance. au Canada est à la fois animé, drôle et pousse à la réflexion et présentera le coté personnel de l’expérience de l’immigration canadienne.
Au Canada par ONFB, Office national du film du Canada
Film documentaire
Le défi de l'intégration
Émission : Les Beaux Dimanches.
Date de diffusion : 19 janvier 1992.
Les Archives de Radio-Canada.
Société Radio-Canada.
Durée : 51 min 21 s
De 1945 à 1992, le Canada a accueilli plus de 6 millions d'immigrants. La majorité d'entre eux se sont installés à Toronto, Montréal et Vancouver, et forment désormais des communautés importantes.
Diffusé dans le cadre des Beaux Dimanches, ce documentaire explique la situation de quelques groupes d'immigrés : les sikhs, les Chinois, les Jamaïcains et les musulmans. Confrontés aux défis de l'intégration, ceux-ci souhaitent conserver leurs coutumes et leurs institutions.
Exposition
L’histoire du Quai 21
Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Entrez dans le passé et dans l’expérience de ce que c’était d’immigrer par le Quai 21 entre 1928 et 1971. Découvrez l’histoire de famille d’un Canadien sur cinq.
Ligne du temps
Le Canada, terre d’asile – ligne du temps
Source: Gouvernement du Canada
1776 : 3 000 loyalistes noirs, parmi lesquels se trouvent des hommes libres et des esclaves, fuient l’oppression de la Révolution américaine et se réfugient au Canada.
1781 : Les Butler’s Rangers, membres d’une unité militaire loyale à la Couronne stationnée à Fort Niagara, sont parmi les premiers réfugiés loyalistes à quitter les États Unis et à s’établir dans la péninsule de Niagara, sur la rive nord des lacs Érié et Ontario.
1783 : Sir Guy Carleton, gouverneur de la province britannique de Québec, et qui allait devenir plus tard lord Dorchester, fait transporter en toute sécurité 35 000 réfugiés loyalistes de New York à la Nouvelle Écosse. Certains s’établissent au Québec; d’autres s’installent à Kingston et à Adolphustown, en Ontario.
1789 : Lord Dorchester, gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique, reconnaît solennellement les « premiers loyalistes », à savoir les sujets loyaux à la Couronne qui ont fui l’oppression de la Révolution américaine pour s’établir en Nouvelle-Écosse et au Québec.
1793 : Le Haut Canada est la première province de l’Empire britannique à abolir l’esclavage. En conséquence, au cours du XIXe siècle, des milliers d’esclaves noirs fuient les États Unis pour se réfugier au Canada avec l’aide du « chemin de fer clandestin », un réseau abolitionniste chrétien.
Fin des années 1700 : Les Scots Highlanders, des réfugiés victimes des Highland Clearances menées au cours de la modernisation de l’Écosse, s’établissent au Canada.
1830 : Des Polonais fuyant l’oppression russe se réfugient au Canada. L’année 1858 marque la première migration massive de Polonais qui veulent échapper à l’occupation prussienne du Nord de la Pologne.
1880-1914 : Des Italiens fuient la dévastation causée par l’unification de leur pays, où les réformes entreprises par le nouvel État chassent les fermiers de leurs terres.
1880-1914 : Des milliers de Juifs persécutés fuyant les pogroms de la région du Pale cherchent asile au Canada.
1891 : Début de la migration de 170 000 Ukrainiens, fuyant principalement l’oppression dans les régions soumises à l’autorité austro-hongroise. C’est la première vague d’Ukrainiens cherchant asile au Canada.
1920-1939 : Deuxième vague d’immigrants ukrainiens, qui fuient le communisme, la guerre civile et l’occupation soviétique.
1945-1952 : Troisième vague d’immigrants ukrainiens, qui fuient le régime communiste.
1947-1952 : 250 000 personnes déplacées de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est viennent au Canada. Ce sont des victimes du national-socialisme (nazisme), du communisme et de l’occupation soviétique.
Années 1950 : Le Canada reçoit des Arabes palestiniens, chassés de leur patrie par la guerre israélo-arabe de 1948.
Années 1950 à 1970 : De nombreux Juifs affluent au Canada, fuyant le Moyen Orient et l’Afrique du Nord.
1951 : Création de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés.
1956 : 37 000 Hongrois fuient la tyrannie soviétique et trouvent refuge au Canada.
1960 : Le premier ministre John Diefenbaker, dont le grand-père était un réfugié allemand des guerres napoléoniennes, présente la première Déclaration des droits du Canada.
Années 1960 : Des réfugiés chinois fuient la violence communiste de la Révolution culturelle.
1968-1969 : 11 000 réfugiés tchèques fuient l’invasion communiste des Soviétiques et des forces du Pacte de Varsovie.
1969 : Le Canada signe la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et son Protocole; il s’engage ainsi à ne pas renvoyer une personne dans son pays d’origine si cette dernière a des motifs de craindre d’être persécutée.
Années 1970 : Le Canada accueille 7 000 Chiliens et d’autres réfugiés latino-américains arrivés spontanément après le renversement violent du gouvernement de Salvador Allende en 1973.
1970-1990 : Privés de libertés politiques et religieuses, 20 000 Juifs soviétiques s’établissent au Canada.
1971 : Après des décennies de refus du droit de participer adéquatement au gouvernement central pakistanais, des milliers de musulmans bengalis immigrent au Canada lors du déclenchement de la guerre de libération du Bangladesh.
1971-1972 : Le Canada admet quelque 228 Tibétains. Avec leurs compatriotes, ces réfugiés fuyaient leur patrie après son occupation par la Chine en 1959.
1972-1973 : À la suite de l’expulsion des Asiatiques d’Ouganda par Idi Amin, 7 000 musulmans ismaéliens s’enfuient et sont amenés au Canada.
1979 : Des réfugiés iraniens s’enfuient de leur pays à la suite du renversement du schah et de l’imposition d’un régime intégriste musulman.
1979-1980 : Plus de 60 000 réfugiés de la mer trouvent refuge au Canada après la victoire des communistes pendant la guerre du Vietnam.
Années 1980 : Des Khmers cambodgiens, victimes du régime communiste et des répercussions de la victoire communiste dans la guerre du Vietnam, s’enfuient au Canada.
1982 : La Constitution du Canada est modifiée pour y enchâsser la Charte canadienne des droits et libertés.
1986 : Le Canada reçoit de l’Organisation des Nations Unies la médaille Nansen pour sa tradition humanitaire exceptionnelle d’accueil des réfugiés.
Années 1990 : Au début des années 1990, les demandeurs d’asile au Canada viennent de tous les pays du monde, en particulier de l’Amérique latine, de l’Europe de l’Est et de l’Afrique.
1992 : 5 000 musulmans bosniaques fuyant le nettoyage ethnique lors de la guerre civile en Yougoslavie sont admis au Canada.
1999 : Le Canada évacue par avion vers une destination sûre plus de 5 000 Kosovars, dont la plupart sont des musulmans.
2006 : Le Canada réinstalle plus de 3 900 réfugiés karens provenant de camps en Thaïlande.
2008 : Le Canada entame le processus de réinstallation de plus de 5 000 réfugiés bhoutanais, processus qui s’échelonnera sur les cinq prochaines années.
2010 : Des réfugiés de plus de 140 pays ont été réinstallés ou se sont vu octroyer le droit d’asile au Canada.
2011 : Le Canada accroît ses programmes de réinstallation des réfugiés de 20 % sur une période de trois ans.
Bacchus en Canada: Boissons, buveurs et ivresses en Nouvelle-France
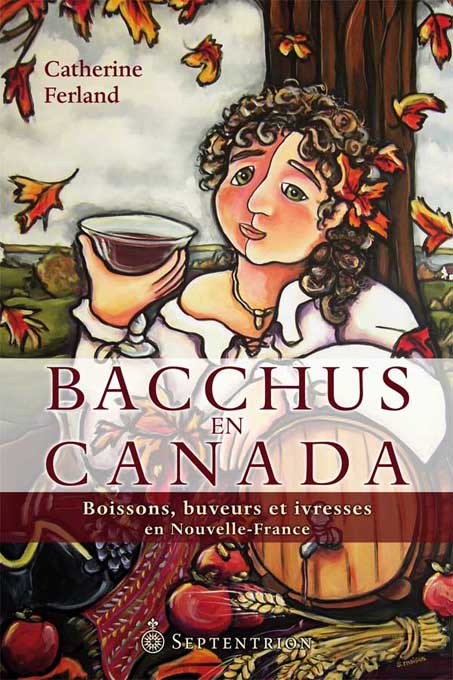
Catherine Ferland. Bacchus en Canada : Boissons, buveurs et ivresses en Nouvelle-France. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2010. 432 pages.
Résumé :
En flânant dans les ports et aux abords des navires, en marchandant avec un négociant en vins, en s'attablant dans un cabaret aux côtés d'ouvriers, en s'immisçant dans une soirée de la noblesse coloniale, en visitant un village amérindien, Catherine Ferland reconstitue toute la chaîne de consommation de l'alcool en Nouvelle-France. Elle aborde la production et l'importation des boissons alcooliques, la manière dont elles se distribuent géographiquement et socialement dans la colonie et termine par l'ivresse. Que peut-on retenir de cette incursion dans les XVIIe et XVIIIe siècles canadiens? Quelles sont les continuités dans les manières de boire, de France à Nouvelle-France?
Acheter chez Renaud Bray
En avril 2016, abonnez-vous au bulletin d’information Histoire à suivre! et courez la chance de gagner ce livre!
Abonnez-vous à Histoire à suivre!
Le téléroman québécois 1953-2008
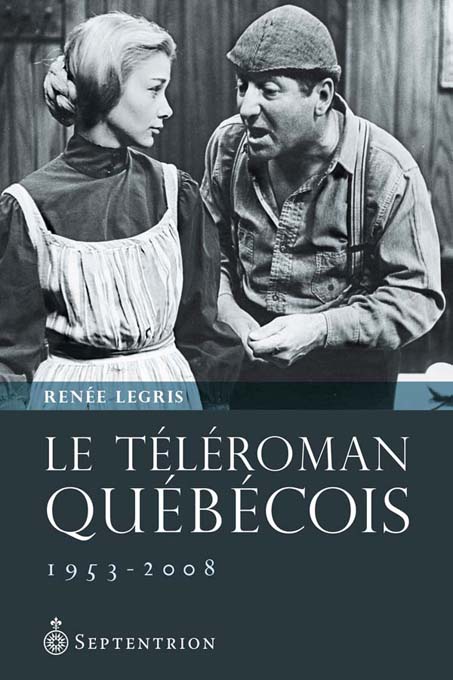
Renée Legris. Le téléroman québécois 1953-2008. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2013. 440 pages.
Résumé :
Reflet d'une époque, les téléromans et les téléséries font partie de l'imaginaire collectif québécois. Les Belles Histoires des pays d'en haut, Le temps d'une paix, Quelle famille!, L'or du temps, Lance et compte, Shehaweh et bien d'autres ont tous, chacun à leur façon, marqué les téléspectateurs. Renée Legris propose un regard critique sur la production depuis ses origines et présente une analyse des grandes oeuvres de ce genre télévisuel qui tient du théâtre et du feuilleton et nous fait ainsi revivre une partie de notre passé. L'auteure se penche sur les transformations apportées aux représentations sociales dans les téléromans, tant rurales qu'urbaines, ouvrières ou bourgeoises, marquées par une vision de la modernité. Elle traite aussi de la culture de mort et de violence, de l'hédonisme et du fétichisme sexuel devenu plus explicite au fil des ans. Une grande place est faite aux représentations des rôles attribués aux femmes et le volet religieux n'est pas non plus en reste. Finalement, Renée Legris pose la question de l'éthique dans le traitement de ces thèmes, car la diffusion des images n'est pas innocente pour une société.
Acheter chez Renaud Bray
En mai 2016, abonnez-vous au bulletin d’information Histoire à suivre! et courez la chance de gagner ce livre!
Abonnez-vous à Histoire à suivre!
Madeleine Matou, la femme du meurtrier de Boucherville 1665-1699
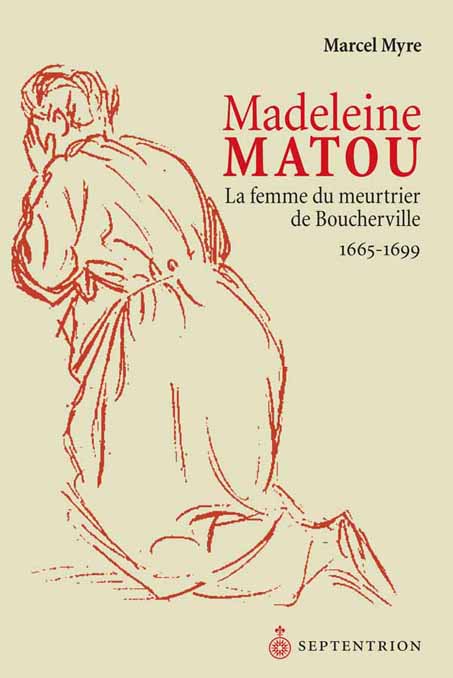
Marcel Myre. Madeleine Matou, la femme du meurtrier de Boucherville 1665-1699. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2006. 154 pages.
Madeleine Matou est une femme totalement inconnue en Nouvelle-France. Née dans un milieu modeste, très jeune elle devient domestique dans de riches familles de Montréal. Après un mariage prometteur avec Jean Hautdecœur et la naissance de quatre enfants à Boucherville, la vie bascule pour cette valeureuse femme. Son mari commet un meurtre sordide et il est pendu en public dans la basse-ville de Québec.
Expulsée de Boucherville, remariée à un voyageur souvent absent et irresponsable, Madeleine Matou donne naissance à trois autres enfants. Dans la misère la plus complète, elle décède à l'âge de trente-quatre ans en accouchant d'un enfant. Son deuxième mari abandonne aussitôt ses enfants et s'enfuit aux Grands Lacs pour épouser une Amérindienne.
Humiliés par le crime de leur père, ses enfants adopteront le patronyme du deuxième époux de leur mère. C'est ainsi que de nombreux descendants de notre héroïne porteront le nom Daigneault.
Acheter chez Renaud Bray
En juin 2016, abonnez-vous au bulletin d’information Histoire à suivre et courez la chance de gagner ce livre!
Abonnez-vous à Histoire à suivre!
Terre-Neuve-et-Labrador au cours de la Première Guerre mondiale

Dans l’édition juin / juillet 2016 du magazine Canada’s History, l’auteur et journaliste Rex Murphy propose un article complet portant sur la Bataille de Beaumont-Hamel dont on commémore cette année le centième anniversaire. Pour ceux et celles qui aimeraient en apprendre davantage au sujet cette opération militaire, nous vous proposons la visite d'un site web vraiment complet, offert en anglais et en français, et élaboré par la Memorial University of Newfoundland. Vous y trouverez des images d'archives, des images vidéo, des enregistrements sonores et différents articles.
Visiter le site Web
Pour en savoir plus au sujet de la Bataille de Beaumont-Hamel, voici aussi d'autres ressources utiles:
Anciens Combattants Canada
Lieu historique national du Canada Beaumont-Hamel
Les Terre-Neuviens par le Musée canadien de la guerre
Le monument commémoratif de Terre-Neuve à Beaumont-Hamel par le Musée canadien de la guerre
Moments marquants — Jour du Souvenir — Historique du 1st Newfoundland Regiment

Toujours dans le but de commémorer le centenaire de la Bataille de Beaumont-Hamel, nous vous proposons de visionner un court documentaire préparé par la chaîne de télévisionCPAC.
Synopsis :
Le 1er juillet est un jour qui suscite des sentiments contradictoires chez les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador. Alors que la plupart des Canadiens dans le reste du pays célèbrent cette journée, pour eux, c'est un jour de commémoration et de deuil appelé Jour du Souvenir.
Le 1er juillet 1916, 801 membres du 1st Newfoundland Regiment ont combattu dans la Bataille de la Somme, à Beaumont-Hamel, en France. Seuls 68 d’entre eux furent en mesure de répondre à l'appel le lendemain matin. Rares étaient les foyers sur cette île qui n’avaient pas été touchés par le carnage survenu ce jour-là. Un historien a noté qu’aucune autre unité ayant combattu dans la Première Guerre mondiale n’était autant associée à la collectivité dont elle était issue. Cette perte humaine a profondément marqué l’histoire et la culture de Terre-Neuve et Labrador.
Voir le documentaire Moments marquants — Jour du Souvenir — Historique du 1st Newfoundland Regiment
Francophones et bâtisseurs
Les nations fondatrices du Canada — britannique, française, amérindienne et inuit — ont joué en parts égales un rôle déterminant dans l’histoire du Canada. L’impact de ces peuples est certes inégalement documenté, mais chacun d’entre nous sait que sans une seule de ces nations à la base de notre pays, le Canada serait complètement différent de la collectivité multiculturelle qui nous rend si uniques à travers le monde. Terre d’accueil, souvent d’opposition, mais surtout de collaboration, notre fédération se démarque par son ouverture d’esprit à l’autre. Tout au long de son histoire, certaines personnes se sont démarquées par leur avant-gardisme, leur courage et leur désir de faire du Canada un endroit égalitaire, où les cultures se rencontrent et se comprennent. Pour rendre honneur à ces hommes et ces femmes qui ont tout tenté pour faire de leur monde un meilleur endroit où vivre, des milliers de personnes devraient être présentées.
La visée de cet article était beaucoup plus modeste, nous avons concentré nos efforts à dresser une liste des Canadiens-français les plus marquants de l’histoire du pays, ce qui a mené à des choix déchirants, mais nécessaires. Ces francophones, qu’ils soient d’ascendance européenne ou autochtone, ont œuvré sans relâche pour bâtir ce qu’ils jugeaient être le meilleur Canada qui soit. Leurs efforts ont mené à des changements durables dans la société et la culture canadiennes de leur époque, changements qui résonnent encore aujourd’hui, dans le Canada du 21e siècle. Les grands Canadiens-français n’appartiennent pas tous au passé. Ils ont une place essentielle dans le présent et l’avenir de notre pays, tout comme les Canadiens-anglais, les Amérindiens, les Inuits et toutes les autres nations qui sont venues enrichir notre culture aux multiples facettes.
Jeanne Mance
Infirmière et fondatrice de l'Hôtel-Dieu
Née en 1606 dans la bourgeoisie de Langres, au nord-ouest de la France, Jeanne Mance est la cofondatrice de Montréal avec Paul de Chomedey de Maisonneuve et Madeleine de Chauvigny de la Peltrie, et la fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Éduquée chez les Ursulines, puis probablement garde-malade dans un hôpital de sa ville natale, Mance entend parler en 1640 de nouvelles fondations féminines en Nouvelle-France, soit les Ursulines et les Augustines de Québec. Elle trouve du financement chez Angélique Bullion, importante, mais anonyme bienfaitrice de la Nouvelle-France. Jeanne Mance se rend ensuite à La Rochelle pour y affréter un navire, et y rencontre Maisonneuve. Deux vaisseaux partent vers la colonie française en mai 1641. Après un voyage sans encombre, le navire où se tient Jeanne accoste à Québec. Les futurs fondateurs de Montréal passent l’hiver à Sillery, où Mme de la Peltrie décide de se joindre à la mission. En mai 1642, le groupe arrive à Montréal. Les décennies suivantes apportent maints défis à la future métropole : guerre avec les Iroquois, désertion des appuis envers Montréal et rappel de Maisonneuve en France. Heureusement, la situation rentre dans l’ordre en 1662 lorsque les Prêtres de Saint-Sulpice prennent Montréal en main. Par sa persévérance et son dévouement envers Montréal, Jeanne Mance a donné le coup d’envoi à cette ville qui sera la plus importante au Canada entre 1880 et 1950. Son courage hors du commun a fait d’elle un exemple suivi par nombre de Canadiennes dans l’histoire.
Alphonse Desjardins
Cofondateur des Caisses Populaires Desjardins
Né à Lévis en 1854, Alphonse Desjardins est le pionnier des coopératives de crédit en Amérique du Nord. Huitième enfant d’une famille modeste, Desjardins se distingue dans le cours commercial au Collège de Lévis, avant d’occuper plusieurs emplois dans l’armée, comme journaliste, puis comme sténographe à la Chambre des communes fédérale. Il siège également au conseil de la Chambre de commerce de Lévis pendant 13 ans. Scandalisé par les révélations faites par le député Michel Quinn à propos des prêts usuraires qui sévissent au pays, il entreprend d’établir la première coopérative de crédit du continent américain. Inspiré par plusieurs modèles économiques européens, le visionnaire fonde Caisses Desjardins en 1900 et inverse la tendance bancaire de l’époque en offrant à la classe populaire des moyens d’obtenir du crédit et de faire fructifier du capital. Malgré un blocage du Sénat canadien, Desjardins obtient du gouvernement du Québec une structure juridique essentielle à l’essor de l’entreprise. Puis, appuyé par le clergé catholique et par des nationalistes tels Henri Bourassa, il voyage pour ouvrir des Caisses. Entre 1907 et 1915, une centaine d’établissements sont ouverts au Québec, dans l’Ontario francophone et dans les paroisses franco-américaines. À partir de 1914, la maladie l’oblige à ralentir ses activités. Enfin, le 31 octobre 1920, alors que 219 caisses populaires sont en activité, Alphonse Desjardins s’éteint après avoir semé sur son parcours les graines de l’une des plus importantes institutions canadiennes.
George-Étienne Cartier
Père de la Confédération
George-Etienne Cartier est connu comme l’un des Pères de la Confédération canadienne. Ses idéaux d’un Canada regroupant les nations britannique et française ont été la base de la création de notre pays moderne. Cartier nait en 1814 à Saint-Antoine-sur-Richelieu dans une famille marchande et étudie le droit au Collège de Montréal, avant d’être admis au Barreau. Militant pour les droits de la minorité francophone dans la colonie britannique qui allait devenir le Canada, l’avocat participe aux Rébellions de 1837 du côté des patriotes, avant de s’exiler au Vermont. De retour au pays l’année suivante, Cartier s’implique davantage dans le monde politique en devenant le bras droit de Louis-Hippolyte La Fontaine. Elu à Verchères, il devient ensuite premier ministre du Canada-Uni avec John A. Macdonald, ce qui lance les préparatifs vers une fédération des colonies britanniques. Les conférences de Charlottetown, Québec et Londres mettent Cartier à l’avant-plan, où l’avocat convainc l’assemblée de faire du Canada une fédération de provinces telles que l’on connaît le pays aujourd’hui. Il persuade également les Canadiens français qu’une telle union serait plus favorable à la cause franco-catholique qu’une alliance avec les Etats-Unis. Une fois la Confédération prononcée, Cartier joue un rôle capital dans le ralliement du Manitoba et de la Colombie-Britannique au nouveau pays. L’homme politique permet également le rapatriement des Territoires du Nord-Ouest et de la Terre de Rupert après d’intenses négociations à Londres. Pour permettre une liaison efficace entre le centre politique qu’est Ottawa et le reste de la fédération, Cartier utilise son influence pour que soit construit un chemin de fer transcontinental. Après une courte maladie, George-Etienne Cartier, cet artisan de la Confédération canadienne et promoteur de l’union des nations française et britannique du Canada, décède en 1873.
Louis Riel
Chef métis et père du Manitoba
Célèbre chef métis, Louis Riel a été le premier véritable militant pour un Canada incluant à la fois les Britanniques, les Canadiens-français, les Amérindiens et les Métis. Il a forcé les Canadiens à réfléchir sur l’identité canadienne et sur l’importance de l’union des peuples au sein de la Confédération. Né à la Rivière-Rouge (Winnipeg) en 1844, Riel est sensibilisé par son père à la cause des Métis, qui subissent la voracité de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Après des études à Montréal, Riel revient dans sa région natale et milite sans relâche pour que le Manitoba soit intégré à la fédération canadienne en tant que province, et non en tant que territoire, ce qui aurait pu compromettre les droits des Autochtones dans l’Ouest. Suite aux moyens de pression utilisés par Riel, le Métis doit s’exiler aux Etats-Unis pendant dix ans. À son retour, réclamé par les Métis lorsque le gouvernement fédéral refuse de leur garantir la propriété de leurs terres, Louis Riel organise une résistance en s’alliant aux Autochtones et en formant un gouvernement provisoire. Ce faisant, Riel souhaitait obtenir des concessions, même de force. Le gouvernement répond en envoyant la police montée, et un affrontement éclate à Beardy’s reserve. Les troupes fédérales eurent le dessus et, après s’être retranché à Batoche, son quartier général, le Métis se rend dans l’espoir que son procès lui permette d’exposer ses idées sans propagande gouvernementale. Malgré un discours enflammé, Riel est condamné à mort et pendu le 16 novembre 1885. Sa mort ne cause pas la fin de son influence, loin de là. Les réflexions causées par la résistance et le courage de Riel ont modifié à jamais la nation canadienne. Son nom résonne encore aujourd’hui comme celui d’un visionnaire, qui concevait le Canada de manière multiculturelle, un avant-gardisme exceptionnel pour son époque.
Marie Guyart de l’incamation
Fondatrice de l’ordre des Ursulines
Marie Guyart de l’Incarnation, religieuse ursuline, est la fondatrice de la première école pour filles en Amérique du Nord. Née à Tours en France, en 1599, elle se marie à Claude Martin, duquel elle met au monde un fils du même nom. Après la mort de son mari, Marie administre l’entreprise de son beau-frère, avant d’entrer dans les ordres en 1631. Peu de temps après, l’ursuline voit lors d’un rêve le dessein que lui réserve Dieu : fonder une école pour les Amérindiennes en Nouvelle-France. Avec l’aide et en compagnie de Madeleine de Chauvi-gny de la Peltrie, Marie et deux autres ursulines traversent l’Atlantique pour fonder le premier établissement d’enseignement pour filles en Amérique du Nord. Trois hospitalières, qui vont fonder le premier hôpital en Amérique du Nord, et plusieurs jésuites sont également du voyage. Le 2 août 1639, soit le lendemain de leur arrivée à Québec, les ursulines enseignent déjà aux fillettes tant autochtones que françaises. En quelques années, Marie de l’Incarnation maîtrise quatre langues amérindiennes, écrit plusieurs dictionnaires et enseigne tant aux enfants qu’aux adultes, en plus de diriger la communauté à travers la reconstruction du monastère, qui avait été détruit par le feu en 1650. Son apport à la société du « Pays de Canada » est indéniable, car, en compagnie des hospitalières, les ursulines ont offert à la Nouvelle-France des institutions essentielles à la viabilité d’une colonie à long terme. Marie Guyart de l’Incarnation décède en 1672, laissant à ses successeures une mission d’éducation qui se poursuit encore aujourd’hui.
Wilfrid Laurier
Premier premier ministre francophone
Wilfrid Laurier, le premier premier ministre francophone du Canada, est un des plus ardents défenseurs du caractère multiculturel du Canada. Né en 1841 à Saint-Lin, dans les Laurentides, Laurier a reçu une éducation dans les deux langues officielles, avant d’étudier le droit à McGill. En 1871, il devient député à l’Assemblée nationale du Québec, mais démissionne pour se présenter aux élections fédérales de 1874, où il remporte la victoire dans sa circonscription. Alors que l’Affaire Riel divisait les Canadiens, le député défend le métis et tente de concilier les différences de points de vue dans une idée d’unité canadienne. Sa vision le porte à la tête du Parti Libéral, puis du Canada en 1896. Malgré un désir que le Canada soit indépendant dans ses décisions, l’impérialisme l’emporta, et le Canada entre dans la Guerre des Boers en tant que dominion britannique, mais en n’envoyant que des volontaires. Cependant, jusqu’à sa défaite aux élections de 1911, le premier ministre résiste à la force de l’Empire en prenant des décisions autonomes, dont la fondation de la Saskatchewan et de l’Alberta, en 1905. L’essor économique de l’Ouest canadien ainsi que l’établissement du chemin de fer sont parmi les plus grandes réussites de son gouvernement. En 1911, les libéraux sont défaits par les conservateurs de Robert Borden, principalement en raison d’une proposition de libre-échange avec les États-Unis qui avantageait les agriculteurs, mais nuisait aux hommes d’affaires. Cette réciprocité économique, très avant-gardiste pour l’époque sera finalement mise en place en 1988 par Brian Mulroney. La dernière intervention politique de Laurier fut de s’opposer à la conscription lors de la Première Guerre mondiale, qui nuisait à l’unité canadienne. Wilfrid Laurier décéda en 1919, léguant une idée d’un Canada uni dans ses nations fondatrices, idée aujourd’hui à la base même du Canada.
Jean Talon
Intendant de la Nouvelle-France
Par ses réformes de la Nouvelle-France, Jean Talon a été un élément déterminant dans le développement de la colonie française. Il naît en 1626 dans la Champagne française, et étudie chez les Jésuites de Paris. Sa carrière militaire débute en France dès 1653, puis en 1665, il est nommé Intendant du Canada, de l’Acadie et de Terre-Neuve par Louis XIV. Il s’agit du deuxième intendant de la colonie, mais le premier à se rendre au Nouveau-Monde et à s’impliquer réellement dans son essor. Peu après son arrivée en Nouvelle-France, Talon multiplie les réformes afin d’améliorer le sort des Canadiens. Il remet en place des tribunaux, dont il assume l’arbitrage lors de la transition. Puis, en diversifiant une économie jusqu’alors centrée sur les fourrures, il valorise l’agriculture, la manufacture, la pêche et la foresterie. Il organise un système de peuplement basé sur les soldats démobilisés et les Filles du Roy, ces orphelines auxquelles le roi offrait une dot pour aller se marier au Canada. Grâce à ces efforts démographiques, la population triple en quinze ans. Talon contribue également à la stabilisation du pays lors des guerres contre les Iroquois en veillant à l’approvisionnement adéquat des troupes. En novembre 1672, l’intendant retourne à la mère patrie pour des raisons de santé, et se voit récompensé de ses services par des charges honorifiques ainsi qu’un titre de noblesse. Tout au long de son mandat, Jean Talon a été un dirigeant à la fois soucieux de l’élite, mais également près du peuple, n’hésitant pas à se rendre en personne dans les chaumières lors des recensements pour s’enquérir des préoccupations des habitants. Son œuvre tant administrative que sociale a permis au Canada de connaître son premier âge d’or.
Louis Robichaud
Champion des Acadiens
Louis Robichaud a été premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1960 à 1970. Pendant son mandat, il a été la source de changements majeurs dans la législation et la société néobrunswickoises. Né en 1925 dans le village de Saint-Antoine, Robichaud étudie à Bathurst et décide d’orienter sa carrière vers la politique plutôt que vers la prêtrise. Après avoir obtenu des diplômes de l’Université Sacré-Cœur de Bathurst et de l’Université Laval à Québec, le futur chef du gouvernement est élu, à 27 ans seulement, dans la circonscription de Kent. En 1958, il est porté à la tête du parti libéral, et, deux ans plus tard, il remporte les élections, devenant le premier premier ministre acadien élu de la province. Les années qui suivent font entrer le Nouveau-Brunswick dans une ère de renouveau social et politique à forte tendance progressiste. Le projet le plus ambitieux du nouveau Premier ministre est d’offrir aux Acadiens une opportunité de développement social et professionnel équivalent à ceux des anglophones de la province. Chances égales pour tous — tel est le nom du programme — a d’abord visé à centraliser l’administration régionale, l’éducation, la santé, l’assurance gouvernementale et la justice vers la province, ce qui a permis d’équilibrer la répartition des richesses sur le territoire du Nouveau-Brunswick. Puis, en fondant l’Université de Moncton, où le français est la langue première, et en ajoutant le français aux langues officielles, Robichaud donnait aux Acadiens une réelle opportunité de conserver et de promouvoir leur culture, en plus d’accroître le nombre d’Acadiens employés de l’État. Battu aux élections de 1970, Robichaud démissionne un an plus tard, avant d’être nommé sénateur en 1973, poste qu’il occupe jusqu’en 2000. À son décès en 2005, Louis Robichaud laisse derrière lui un héritage durable d’ouverture d’esprit et de tolérance exemplaire.
Louis-Joseph Papineau
Chef des patriotes et politicien
Louis-Joseph Papineau est un personnage hautement controversé. De héros, défenseur des droits des Canadiens-français, à traître à la nation et au Commonwealth, Papineau a eu une influence indéniable sur la politique canadienne de son époque et de la suivante. Né à Montréal en 1786, il a grandi dans la seigneurie familiale, puis a terminé ses études de droit au Petit Séminaire de Québec, mais ne pratique le droit que sporadiquement et se tourne rapidement vers la politique. Après avoir été élu à l’Assemblée du Bas-Canada, Papineau devient chef du Parti canadien, le futur Parti patriote. Il milite alors pour une plus grande autonomie du Bas-Canada, dominé par une minorité d’influents Britanniques. De politicien modéré, le chef se radicalise et bloque le processus politique du Bas-Canada en exigeant des réformes. Dès 1830, il attaque ouvertement les institutions impériales, spécialement le Conseil, dont les membres non élus contrôlent le pays. En 1834, le Parti canadien obtient une large majorité à l’Assemblée, et prépare une série de réformes, les 92 Résolutions, qui permettraient aux Canadiens-français d’obtenir le pouvoir au Bas-Canada à l’aide d’un gouvernement responsable, projet appuyé par le Gouverneur général de l’époque, Lord Durham. Le rejet univoque de ce plan par Londres soulève l’ire de la population canadienne-française, dont les éléments les plus radicaux prennent les armes. Mal organisée, la rébellion est réprimée, et Papineau s’exile aux États-Unis, puis en France après l’échec d’une seconde insurrection. Il reçoit l’amnistie en 1844, et revient au pays. Constatant que l’Acte d’Union avait affaibli encore davantage les Canadiens-français en politique, il s’oppose à la nouvelle entité qu’est le Canada-Uni, et réclame le gouvernement responsable, ce qui sera accordé en 1848. Il ira même jusqu’à prôner l’annexion du Canada-Est aux États-Unis. Papineau quitte la politique en 1854 et se retire dans sa seigneurie, où il décède en 1871.
Henri Bourassa
Rédacteur en chef et politicien
Henri Bourassa, né en 1868 à Montréal, a profondément marqué la politique canadienne par ses positions nationalistes qui ont un écho encore de nos jours. Au long de sa carrière tant en politique qu’en journalisme, il militera pour la protection des minorités — les Canadiens au sein du Commonwealth et les Canadiens-français hors Québec. Son indépendance d’idée, qu’il affirmera sans équivoque en refusant tout salaire de député, fera de lui le modèle politique de sa génération et de la suivante. Fort d’un héritage politique reconnu dans son Outaouais natal — Henri est le petit-fils du patriote Louis-Joseph Papineau — Bourassa est élu maire de Montebello, puis de Papineauville avant d’être porté à la Chambre des communes comme libéral sous Wilfrid Laurier. Il commence dès lors à contester la tendance impérialiste du cabinet, qui engage les Canadiens dans des guerres sans consultation populaire. Bourassa démissionne et devient député indépendant. Réélu à trois reprises et de retour sous la bannière libérale, le politicien multiplie les discours réclamant l’indépendance complète du Canada, et va même jusqu’à s’opposer à la participation du dominion à la Première Guerre mondiale. Pour diffuser ses idées, il fonde en 1910 le journal Le Devoir. L’affaire du Règlement 17 et la crise de la conscription, deux conflits qui oppressent sans équivoque les Canadiens-français, soulèvent particulièrement ses passions. En 1919, l’épouse de Bourassa décède des suites d’une longue maladie. Il commence à délaisser la politique, mais son influence est pourtant encore bien réelle. En effet, son projet d’autonomie canadienne face au parlement britannique devient réalité en 1931, lorsque le Canada devient indépendant. Puis, dans les années 1960, alors que Bourassa était mort depuis plus d’une dizaine d’années, l’idée d’un Canada biculturel se fraye un chemin jusqu’au parlement canadien, où elle est véhiculée par Pierre Elliott Trudeau. Ces valeurs d’inclusion de l’autre dans la nation canadienne et d’autonomie politique du pays sont toujours bien ancrées dans le Canada d’aujourd’hui.
Thérèse Casgrain
Feministe et réformatrice
De militante pour le droit des femmes à première chef élue d’un parti politique canadien, Thérèse Forget a modifié à jamais le paysage politique canadien. Elle voit le jour en 1896 à Montréal d’un père homme d’affaires et politicien, sir Rodolphe Forget, et de lady Blanche MacDonald. Elle se marie en 1916 à Pierre Casgrain, politicien qui deviendra Président de la Chambre des communes, puis Secrétaire d’État sous W.L. Mackenzie King. Après la Première Guerre mondiale, Thérèse Casgrain milite activement pour les droits de l’homme en siégeant à différents conseils fédéraux instituant des réformes sociales, en présidant la Ligue pour les droits des femmes et en fondant plusieurs associations agissant pour le bien-être de la société. Son principal combat, et sa plus grande réussite touche le droit de vote universel dont les femmes du Québec étaient alors privées. En 1940, plus de vingt ans après que le droit de vote pour tous ait été institué au fédéral, le premier ministre Adélard Godbout l’accorde aux Québécoises. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Madame Casgrain est récompensée par l’Ordre de l’Empire pour ses services à la Commission des prix et du commerce, qui a réussi à limiter l’inflation de manière remarquable. À partir de 1942, elle se présente comme candidate libérale indépendante à l’élection partielle de la circonscription de Charlevoix-Saguenay, sans succès. À cette époque, très peu de femmes se présentaient aux élections, et seule une poignée d’entre elles atteignent la Chambre des communes. En 1951, elle est élue chef du Parti social-démocratique du Québec, devenant ainsi la première Canadienne élue à la tête d’un parti politique. Elle est ensuite nommée sénatrice par Pierre Elliott Trudeau. Jusqu’à son décès, en 1981, Mme Casgrain a milité pour les droits de l’homme. Elle laisse derrière elle un héritage d’avant-gardisme politique et de persévérance dans ses idées, menant à un Parlement et à un Sénat canadiens de plus en plus égalitaires.
Le long chemin vers la tolérance
Difficile de dire à quel moment le Canada a commencé à être plus ouvert à la tolérance et au multiculturalisme. Peut-être après l’Holocauste.
Les nouvelles de l’extermination massive des Juifs en Europe commencèrent à circuler vers 1942. Même si ces histoires étaient difficiles à croire, et souvent reléguées aux dernières pages des journaux, elles devenaient impossibles à ignorer. Un reportage de la Presse canadienne à Londres, en Angleterre, datant du 24 juin 1943 rapportait, dans un article horrifiant, que les Juifs de la Pologne occupée étaient « ébouillantés » par les nazis. L’histoire du reporter Scott Young reposait sur des informations fournies par des mouvements clandestins polonais qui rapportaient l’existence de camps d’extermination dirigés par les nazis dans l’est de la Pologne. L’article était cependant inexact quant au mode d’extermination, puisque des millions de Juifs furent tués par le gaz Zyklon B et non par la vapeur, mais il était juste dans son affirmation que des assassinats massifs prenant des proportions dépassant tout entendement se produisaient dans l’Europe occupée par les nazis. À partir de 1943, les journaux et magazines commencèrent à publier de plus en plus d’articles sur ces exterminations. Ce n’est que plus tard, lors des procès de Nuremberg, que la population découvrit la portée réelle de ce qui s’était produit dans ces camps. Ces procès donnèrent lieu à la création d’un nouveau mot visant à décrire cette horreur : le génocide.
Les révélations sur l’Holocauste marquèrent le début d’un changement graduel des attitudes à l’égard des Juifs et d’autres minorités, le premier pas d’un très long voyage sur la voie du multiculturalisme dont les Canadiens sont aujourd’hui si fiers. En octobre 1946, à la fin du premier procès de Nuremberg impliquant des criminels de guerre nazis, un sondage de la firme Gallup révélait que les Canadiens considéraient les Juifs comme l’un des groupes d’immigrants les moins désirables, tout juste devant les Japonais, bons derniers. Les immigrants allemands étaient les plus populaires, et ce, malgré les atrocités commises pendant la guerre. Le Canada, qui affichait une sympathie apparente pour les survivants de l’Holocauste, continuait de mettre des bâtons dans les roues des réfugiés juifs et d’autres pays de l’Europe de l’Est qui voulaient entrer au pays. Ils continuaient de susciter la méfiance des Canadiens.
Les principes définissant le Canada comme un pays blanc, anglo-saxon et chrétien remontaient à plus d’un siècle. J.S. Woodsworth, disciple de l’Évangile sociale et un des fondateurs de la Fédération du commonwealth coopératif (prédécesseur du Nouveau parti démocratique), était un politicien canadien exemplaire. Et pourtant, il a écrit dans son livre datant de 1908, Strangers Within Our Gates, que pour prospérer, les nouveaux immigrants devaient assimiler les valeurs et coutumes de la société canadienne, telles qu’édictées par la majorité blanche, anglo-saxonne et protestante. Selon Woodsworth, les Britanniques, Scandinaves, Allemands et Français faisaient de bien meilleurs Canadiens que les « Hébreux », les « Slaves » et les « Orientaux ». Les « Nègres » et les peuples des Premières nations étaient, selon lui, encore plus méprisables.
Avant 1950, peu de Canadiens d’origine britannique ou française auraient adopté la position de Jane Addams, activiste sociale américaine détentrice d’un prix Nobel. Mme Addams, qui en 1889 a ouvert une maison d’accueil à Chicago afin d’offrir divers services aux immigrants, affirmait que la culture et les valeurs des nouveaux arrivants étaient une richesse pour l’ensemble de la société. Ses idées avant-gardistes étaient partagées par Horace Kallen, philosophe de Harvard qui, en 1924, inventa le terme « pluralisme culturel » pour introduire l’idée radicale selon laquelle la diversité, plutôt que la conformité, était un développement positif.
En cette ère où le concept de race était primordial, les universitaires, hommes d’Église, physiciens, réformateurs, philanthropes et politiciens canadiens étaient d’avis que ces étrangers appauvris, incultes et immoraux étaient des indésirables, et présentaient un danger pour la santé et l’avenir de la société canadienne. Comme l’a si bien dit un enseignant d’une école publique de Toronto quelques années avant la Première Guerre mondiale, « les Canadiens sont propres, rangés et sincères, contrairement aux étrangers ».
Né en 1874, William Lyon Mackenzie King, premier ministre pendant la majeure partie de la période s’écoulant entre 1921 et 1948, entretenait des idées typiques de son époque sur l’immigration. Dans son journal, Mackenzie King qualifiait souvent les Noirs de « darkies », élucubrait longuement sur les Juifs, qu’il jugeait essentiellement « indésirables » - il prit même les grands moyens pour s’assurer qu’aucun Juif n’achèterait une propriété près de sa demeure de Kingsmere, à Gatineau, au Québec – et craignait l’afflux des immigrants orientaux. Le 6 août 1945, après avoir appris que les États-Unis avaient largué une bombe atomique sur Hiroshima, il écrivit dans son journal : « Heureusement que la bombe a été lâchée sur des Japonais plutôt que sur les races blanches d’Europe ». Et il n’était certainement pas le seul Canadien à entretenir de telles idées.
En mai 1947, lors d’un discours important sur la politique d’immigration d’après-guerre du gouvernement fédéral libéral, Mackenzie King établit clairement que le Canada continuerait d’être sélectif quant aux immigrants qu’il autoriserait à entrer au pays, et que les restrictions imposées aux immigrants provenant d’Asie, instaurées depuis le milieu des années 1880, ne seraient pas levées afin « de ne pas modifier la composition fondamentale de la population canadienne ». Mackenzie King affirmait, du même souffle, ne faire preuve d’aucune discrimination. « Je tiens à être clair, déclara-t-il, le Canada a tout à fait le droit de sélectionner les personnes qu’il considère comme de futurs citoyens désirables. Entrer au Canada n’est pas un "droit humain fondamental", mais un privilège. »
La référence de Mackenzie King aux droits humains fondamentaux concernait les pourparlers entourant la proposition de Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). En 1946, les Nations Unies avaient nommé Eleanor Roosevelt à la tête d’un comité international chargé de se pencher sur les droits de l’homme et de les enchâsser dans une charte des quatre libertés, formulée par son défunt mari, l’ancien président des É.-U., Franklin D. Roosevelt. Dans sa charte, ce dernier voulait libérer les hommes de la crainte et de la misère, et leur accorder la liberté de parole et de croyance. Un chercheur en droit canadien, John Humphrey de Montréal, fut nommé directeur des droits de la personne au Secrétariat des Nations Unies et participa à la rédaction de la Charte.
Pendant près de deux ans, la Déclaration fut jugée problématique par Mackenzie King et d’autres politiciens canadiens, comme Lester Pearson, nommé secrétaire d’État aux Affaires extérieures en 1948. Tous s’inquiétaient de la façon dont cette protection universelle des droits de l’homme serait interprétée. Même si la Déclaration n’était pas un document contraignant, le gouvernement fédéral sentait qu’il serait tenu, moralement, d’y adhérer, malgré la formulation assez vague de ses dispositions.
En 1947 et 1948, alors que l’on débattait de la Déclaration, des fonctionnaires canadiens réfléchissaient à l’incidence que la Charte aurait pu avoir sur la décision du gouvernement fédéral d’interner plus de 20 000 Japonais en 1942 (dont la plupart étaient naturalisés ou nés au Canada), ou sur le traitement qu’il réservait aux Autochtones, privés de leurs droits culturels et politiques, et obligés d’envoyer leurs enfants dans des pensionnats. Dans le contexte des tensions mondiales qui déclenchèrent la Guerre froide, le gouvernement se demandait s’il ne devrait pas également limiter les droits des groupes communistes. En outre, on craignait qu’un soutien du gouvernement fédéral à la Déclaration ne contrevienne aux compétences provinciales, en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
Au début de décembre 1948, l’anxiété était si grande à Ottawa au sujet que, sur les instructions du premier ministre Louis St-Laurent (le successeur de King) et de Pearson, la délégation canadienne aux NU à Paris s’abstint de voter sur la version préliminaire de la Déclaration. Ainsi, plutôt que de s’allier aux États‑Unis et à la Grande-Bretagne, dont les chefs appuyaient la Déclaration sans réserve, le Canada se retrouva du côté des pays du bloc de l’Est.
Compte tenu du fait que la Déclaration avait été rédigée, en partie, par un Canadien, John Humphrey, le refus du Canada ne passa pas inaperçu dans les enceintes des NU. Humphrey, plus particulièrement, était en état de choc : « Même si je savais que la promotion internationale des droits de l’homme n’était pas une priorité de la politique étrangère du Canada, je n’aurais jamais pensé que le gouvernement pouvait être indifférent au point de se retirer d’un vote aussi important. Sans doute, je n’aurais pas été en mesure d’arrêter le scandale, même si la délégation m’avait fait part de ses intentions, mais j’aurais au moins pu les alerter au sujet de la compagnie avec laquelle le Canada allait se retrouver. »
Quelques semaines plus tard, lors d’un débat à l’Assemblée générale des NU sur la version finale de la Déclaration, Pearson tenta d’expliquer, plutôt faiblement, la décision du Canada de faire valoir ses réserves sur la Charte et réitéra l’engagement du pays envers les droits de l’homme. Au moment du vote, le 10 décembre 1948, le Canada, comme l’avait prévu le gouvernement dès le départ, appuya l’adoption de la Déclaration par les NU dans l’espoir, comme l’affirma Pearson, « qu’elle marque un jalon important dans la marche vers l’avant de l’humanité .»
Difficile de mesurer l’effet immédiat de l’Holocauste et de la Déclaration sur les attitudes des Canadiens, mais les préjugés ont la vie dure. De la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse, par exemple, les restrictions concernant la présence des Juifs dans les centres de villégiature, les golfs et les clubs sociaux restèrent en place. En étudiant l’article « No Jews Need Apply », publié dans le Maclean’s du 1er novembre 1948, Pierre Berton découvrit que l’entreprise satellite du magazine, Maclean Hunter, n’engageait pas de Juifs non plus. « C’est la politique de l’entreprise », lui a-t-on répondu.
La même année, on informa une famille juive que leur jeune fils ne pourrait pas se joindre au club de ski Puffin de Winnipeg parce que les Juifs ne sont pas admis comme membres. Le responsable des abonnements leur expliqua que les « Juifs sont agressifs et pourraient prendre le contrôle du club ». Dans les années 1960, la faculté de médecine de l’Université McGill « limitait le nombre d’étudiants juifs à un strict dix pour cent », selon l’historien Gerald Tulchinsky. Et en 1962, deux firmes d’avocats de Winnipeg offrirent un poste de stagiaire à Jack London, alors étudiant en droit à l’Université du Manitoba, mais revinrent sur leur parole lorsqu’elles apprirent qu’il était Juif. London deviendra plus tard un des meilleurs avocats du Canada et le doyen de la faculté de droit de l’Université du Manitoba.
Les Noirs canadiens étaient également victimes de discrimination. Dans le sud-ouest de l’Ontario et en Nouvelle-Écosse, régions où il y avait de grandes communautés noires, les écoles furent ségréguées jusque dans les années 1960. Dans les années 1950, des commerçants de la ville de Dresden, dans le sud-ouest de l’Ontario, livrèrent une lutte acharnée pour le droit d’installer des affiches « blancs seulement » sur les portes de leurs magasins, restaurants et salons de coiffure. Dans la plupart des communautés, cette règle était tacite. À Vancouver, Toronto, Halifax, Windsor et dans d’autres communautés, les Noirs ne pouvaient pas séjourner dans les hôtels et ne pouvaient pas fréquenter les restaurants.
En novembre 1946, Viola Desmond, une femme noire de 32 ans de Halifax qui tentait de voir un film dans un cinéma de New Glasgow, fut arrêtée et incarcérée pendant toute une nuit après avoir refusé, à la demande du propriétaire du cinéma, de s’asseoir au balcon, dans la section réservée aux Noirs. Plus de dix ans plus tard, en février 1959, un article du Toronto Star sur les neuf mille « nègres » du Toronto métropolitain, concluait que même si les « préjugés flagrants de la période de l’après-guerre sont dissipés, ces derniers sont maintenant remplacés par une discrimination plus subtile et plus ciblée ». Toute personne qui n’était pas un protestant de race blanche et d’origine anglo-saxonne était visée. Lorsque des immigrants italiens montaient à bord des tramways de la ville, il n’était pas rare d’entendre des commentaires désobligeants du genre « sale rital » ou « retourne en Italie ».
De nombreux leaders de la politique canadienne partageaient ces préjugés ou niaient le problème. Vers la fin de 1947, Charles Daley, ministre du Travail de l’Ontario, expliqua au rabbin Abraham Feinberg du comité mixte des relations publiques du Congrès juif canadien et de B’nai B’rith « que de nos jours, la discrimination fondée sur la race est essentiellement une vue de l’esprit ». Quelques mois plus tard, son collègue, le procureur général Leslie E. Blackwell déclara à l’Assemblée législative de l’Ontario « que nulle autre contrée au monde n’est plus tolérante que l’Ontario ».
D’autres politiciens fédéraux et provinciaux adoptèrent une approche plus réaliste et éclairée, reconnaissant que les injustices persistaient au pays et acceptant leur obligation morale, en vertu de la DUDH, d’apporter des changements positifs, contre vents et marées. En mai 1947, avant même l’adoption de la Déclaration, le gouvernement fédéral abrogea la Loi d’exclusion des Chinois de 1923, qui fermait les portes du Canada aux immigrants chinois. La même année, la Colombie-Britannique accorda aux Sino-Canadiens le droit de voter. Le gouvernement fédéral fit de même en 1948, après avoir abrogé l’Acte des élections fédérales, qui permettait de refuser aux Sino-Canadiens le droit de voter pour des motifs raciaux. D’un autre côté, jusqu’à ce que des changements soient apportés à la loi en 1960, les Premières Nations du Canada ne pouvaient voter aux élections fédérales que s’ils renonçaient à leurs droits issus de traités et à leur statut en vertu de la Loi sur les Indiens.
Leslie Frost, premier ministre de l’Ontario de 1949 à 1961, comprenait mieux que ses contemporains l’importance de la DUDH. Lors du 12e anniversaire de la Charte en décembre 1960, il rappela aux citoyens de l’Ontario « leur devoir de défendre les droits des autres ». Et pourtant, même lui croyait, en 1949, qu’il n’était pas nécessaire d’instaurer de nouvelles lois, puisque les Canadiens étaient un « peuple démocratique ». Cependant, il reconnaissait l’importance de défendre les droits de la personne, plus particulièrement dans le contexte de la lutte contre le communisme qui sévissait pendant la Guerre froide. Comme lui a si bien dit le rabbin Feinberg : « Il ne sert à rien de tenter de défendre la démocratie occidentale contre le communisme si un homme ou une femme ne peut pas obtenir d’emploi en raison de sa race, de sa religion ou de sa couleur. »
À partir de 1950, le gouvernement Frost adopta plusieurs lois importantes en matière de droits de la personne, notamment la loi de 1951 sur les pratiques d’emploi équitables, la loi de 1954 sur les accommodements équitables, et la loi de 1958 sur la commission antidiscrimination de l’Ontario. Ces lois, et d’autres interdisant la discrimination en milieu de travail et dans les lieux publics, ainsi que la discrimination fondée sur la race ou la religion lors de la vente de biens immobiliers, furent consolidées en 1962 par le successeur de Frost, John Robarts, dans le Code des droits de la personne de l’Ontario.
Des recherches menées par les historiennes Carmela Patrias et Ruth A. Frager laissent entendre qu’au début des années 1950, les pressions exercées par des organismes représentant les Juifs, les Japonais, les Africains et d’autres groupes ethniques réussirent à convaincre Frost, signe que le Canada évoluait. Le premier ministre avait également senti que le vent tournait dans l’opinion publique et décida d’en profiter. Il maintint sa position, même devant la critique.
Lors des débats entourant l’adoption de la loi interdisant la discrimination dans la vente de biens immobiliers en 1950, le juge de l’Ontario, J.A. McGibbon, se plaignit en privé à Frost, son compagnon de pêche : « Je n’arrive pas à croire que c’est maintenant le gouvernement qui va me dicter à qui je dois vendre ma propriété et qui seront mes prochains voisins. Je ne veux pas de Noirs ou de Juifs à côté de chez moi, et je suis convaincu que tu penses comme moi. » Frost lui répondit poliment que son intolérance était d’une autre époque.
Cinq autres provinces suivirent l’exemple de l’Ontario, mais pas le Québec, où le premier ministre Maurice Duplessis rejeta la loi antidiscrimination en invoquant qu’il suffisait aux Québécois de lire la Bible. Duplessis dirigea la province entre 1936 et 1939, et ensuite entre 1944 et 1959, et était reconnu pour ses violations aux droits de la personne. Son gouvernement adopta l’infâme Loi du cadenas en 1937, accordant à la police le droit de fermer tout établissement faisant la promotion du « communisme », un terme dont la définition très élastique englobait les syndicats et d’autres groupes.
Pendant ce temps, à Ottawa, John Diefenbaker et les Progressistes-Conservateurs, qui avaient remporté les élections en 1957 et 1958, adoptèrent la Déclaration des droits en 1960. Diefenbaker, « défenseur de la première heure des libertés civiles », comme l’a décrit son biographe Denis Smith, rêvait d’une Déclaration des droits enchâssée dans la Constitution, même si cela se révélait impossible. Il se contenta donc d’une loi sur les droits de la personne, ne régissant que les libertés relevant des compétences fédérales. Même si Diefenbaker considérait la Déclaration des droits comme sa plus importante réalisation, il faudra attendre la Charte des droits et libertés de 1982 pour garantir ces droits aux Canadiens, comme il l’avait imaginé.
Au cours des années 1950, on voit poindre plusieurs changements positifs. Partout au pays, les gens d’autres couleurs, d’autres origines ou d’autres religions, surtout des hommes, ont accès à de nouvelles possibilités d’emploi. Par exemple, en 1950, Harry Batshaw est nommé à la Cour supérieure du Québec, devenant le premier juge juif dans un tribunal supérieur canadien.
Les électeurs votent pour des politiciens de diverses origines. En 1949, l’année où les Premières Nations de la Colombie-Britannique obtiennent le droit de voter aux élections provinciales, Frank Calder, un chef Nisga’a, devient le premier Indien inscrit au Canada à être élu à l’Assemblée législative de la province. Les maires d’Edmonton et de Winnipeg, élus en 1951 et 1956, respectivement, étaient d’origine ukrainienne. Et son appartenance au Parti communiste pendant la Guerre froide n’empêcha pas Jacob Penner, un mennonite né en Russie, de conserver son siège au conseil de ville de Winnipeg dans les années 1950.
C’est également pendant cette décennie que quatre villes, Toronto, Halifax, Saskatoon et North York, en Ontario, éliront des maires juifs. Ces victoires politiques témoignent de la plus grande tolérance de la population et sont un signe que « la race ou l’origine n’est plus un obstacle à l’occupation d’une charge publique », comme l’a souligné un journaliste du Toronto Star en 1955 lors de la seconde victoire du maire juif, Nathan Phillips. Oui, les progrès sont bien réels, mais les préjugés ont toujours la vie dure, même dans les années qui suivront.
Faisons un bond de cinq décennies. Lorsque Kathleen Wynne est devenue la première ministre de l’Ontario, en 2013 (après la démission de Dalton McGuinty), pour ensuite former un gouvernement majoritaire à l’issue de l’élection provinciale de 2014, le fait qu’elle était une femme, ouvertement homosexuelle de surcroît, est pratiquement passé inaperçu. En 2010, Naheed Nenshi, d’origine sud-asiatique, est devenu le premier maire musulman d’une grande ville d’Amérique du Nord lorsqu’il a été porté à la tête de l’hôtel de ville par les citoyens de Calgary. Brian Bowman, un Métis, sera élu maire lors de l’élection municipale à Winnipeg, le 22 octobre 2014. Ce sont là des réalisations remarquables et une indication claire que la tolérance est réellement une caractéristique canadienne.
Le pays a également reconnu qu’il avait été coupable de discrimination par le passé. En 1988, Brian Mulroney s’est excusé auprès des Japonais-Canadiens pour le traitement qui leur a été réservé pendant la Seconde Guerre mondiale; Stephen Harper, en 2008, s’est excusé auprès des Premières Nations pour la tragédie des pensionnats autochtones.
Le Canada a opéré un virage à 180 degrés depuis la première moitié du 20e siècle. L’antisémitisme n’est plus un problème pour les Juifs canadiens, et le racisme, sous toutes ses formes, n’est plus acceptable. En 1971, le gouvernement Libéral de Pierre Trudeau fait officiellement du multiculturalisme une politique canadienne. Et en 2005, le mariage de même sexe devient légal au Canada, un geste qui aurait été impensable même en 1970.
Cependant, rien de tout cela ne prouve que la discrimination et les préjugés ont disparu au Canada. On a rapporté, par exemple, de nombreuses altercations entre la police de Toronto et des membres de la communauté noire depuis la fin des années 1970. À Winnipeg, les relations entre la police de la ville et les Autochtones sont tendues depuis des années. Un sondage de Probe Research mené en septembre 2014 révélait que la majorité des résidents de Winnipeg croient en l’existence « d’un profond fossé racial entre les Autochtones et non-Autochtones ». Encore plus évocateur, un récent sondage auprès de 2 600 Métis, Inuits et membres des Premières Nations mené par Environics , conjointement avec l’Université des Premières Nations du Canada à Regina, montre qu’un pourcentage élevé d’Autochtones des villes des Prairies jugent que les non-Autochtones entretiennent des opinions négatives à leur sujet. La diversité est une valeur canadienne, et pourtant, un sondage Angus Reid de 2009 indique que 62 % des répondants sont d’accord avec l’énoncé suivant : « Les lois et normes ne devraient pas être modifiées pour accommoder les minorités ».
Il est difficile de contester la conclusion de l’auteure torontoise, Margaret Cannon, dans son ouvrage de 1995, The Invisible Empire: Racism in Canada: « Peut-être que nous n’insultons pas les gens sur la rue, mais nous affirmons clairement que les valeurs que nous voulons institutionnaliser sont celles des peuples fondateurs – les Blancs, catholiques ou protestants, de culture européenne et de philosophie occidentale ». Les débats antagonistes sur le port du niqab lors des cérémonies de citoyenneté pendant la campagne électorale fédérale de 2015 en sont un bon exemple. Et même si le nouveau gouvernement libéral maintient son engagement à accueillir des réfugiés syriens au Canada, les sondages menés vers la fin de 2015 indiquent que seulement un peu plus de la moitié des Canadiens appuient cette politique.
L’histoire de la tolérance au Canada est mitigée. Du point de vue juridique et des libertés civiles, il ne fait aucun doute que le pays a réalisé de grandes percées pour débarrasser la société du fléau de la discrimination. L’idée qu’à une certaine époque, un Chinois pouvait être accusé de « retenir les services d’une femme blanche à des fins immorales », comme ce fut le cas pour Horace Wing de Toronto, en 1913, lorsqu’il tenta d’engager Minnie Wyatt pour travailler dans son commerce, est tout simplement impensable aujourd’hui. Les préjugés risquent bien de ne jamais disparaître, tout comme le racisme; ils font partie de la nature humaine. Mais au moins aujourd’hui, contrairement à il y a 50 ans, nous reconnaissons cette tare de notre caractère national et tentons de l’effacer. Cet effort collectif est prometteur pour l’avenir.
La Saint-Jean-Baptiste : une fête connue, mais méconnue
Lorsque l’on m’a proposé d’écrire cet article, mon intérêt pour cette fête s’est tourné non seulement sur les célébrations entourant le 24 juin, mais aussi sur ce que cet événement, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, représentait pour les gens autour de moi. J’ai alors troqué temporairement ma casquette d’historien pour celle de journaliste, et j’ai demandé à plusieurs de mes proches – qui habitent tous la région de Québec – quelle était pour eux la signification de cette date, de cette fête. À ma grande surprise, j’ai obtenu une réponse uniforme de la part de la dizaine de personnes que j’ai sondé : « Il s’agit de la fête des Québécois / du Québec. » Leur étonnement a été visible lorsque je leur ai appris que la Saint-Jean-Baptiste était une fête plus vieille que le Québec lui-même, et à la signification largement plus étendue que son interprétation québécoise moderne.
Pour mieux saisir l’origine de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, il faut s’attarder sur son emplacement sur le calendrier, c’est-à-dire dans les jours entourant le solstice d’été. Cette période de l’année lors de laquelle les jours sont les plus longs a été remarquée depuis longtemps par les premières civilisations, et a été célébrée comme un retour de l’abondance dans l’hémisphère nord. Plusieurs peuples antiques, tels les Babyloniens et les Celtes, invoquaient alors une divinité liée à la moisson pour lui demander de bonnes récoltes à la fin de l’été.
Dans la tradition judéo-chrétienne, le solstice d’été est directement relié à Jean le Baptiste, prédicateur juif qui aurait, selon l’Évangile de Luc, baptisé Jésus de Nazareth, son cousin. Jean serait né près du solstice d’été, ce qui vient contrebalancer la Nativité de Jésus, Noël, près du solstice d’hiver. Le soulignement de la naissance de saint Jean le Baptiste est attesté très tôt dans l’histoire occidentale, soit autour du 6e siècle. Les célébrations étaient alors essentiellement religieuses, mais incluaient également des feux de joie et des repas festifs après une journée de jeûne.
La fête de saint Jean le Baptiste a connu un développement marqué jusqu’à aujourd’hui. Ayant été élevé au rang de Solennité par le Vatican en 1969, le 24 juin représente maintenant une des fêtes les plus importantes de l’année liturgique, et l’événement est célébré en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, au Danemark, au Portugal et, bien sûr, au Canada.
La tradition de la Saint-Jean-Baptiste a été amenée au Nouveau Monde par les colons français qui y ont immigré dès le 17e siècle. La trace la plus ancienne nous provient de 1606, alors que la ville de Québec n’avait pas encore été fondée. Des colons qui voyageaient en destination de l’Acadie se sont arrêtés sur les côtes terre-neuviennes le 23 juin, et ont célébré la nativité de saint Jean le Baptiste. Un autre témoignage est contenu dans la Relation des Jésuites, et mentionne les festivités organisées par le gouverneur de l’époque, Charles Huot de Montmagny.
Après la Conquête britannique, et surtout au 19e siècle, la Saint-Jean-Baptiste conserve son caractère religieux, mais prend également une tournure politique. Les Canadiens francophones catholiques profitent alors du 24 juin pour affirmer leur identité, en opposition aux Canadiens anglophones protestants et anglicans. En 1837-1838, alors que la tension sociale atteint son paroxysme, la fête n’est pas célébrée en raison des répressions militaires contre les Patriotes. Cette situation dure jusqu’en 1842, alors que la Saint-Jean-Baptiste reprend en y intégrant tant les feux traditionnels qu’une nouveauté, une procession religieuse précurseur du défilé québécois actuel. En 1880, la chanson Ô Canada, aujourd’hui l’hymne national du Canada, est chantée à Québec et devient instantanément populaire.
La Révolution tranquille apporte son lot de changements au Canada, et la fête de la Saint-Jean-Baptiste n’est pas épargnée. L’aspect religieux est évacué par la jeune génération au profit de revendications politiques, alors que le mouvement souverainiste québécois prend de l’ampleur. Cette tendance est confirmée par René Lévesque, premier ministre du Québec, en 1977. Celui-ci établit le 24 juin comme Fête nationale du Québec, mais le nom de Saint-Jean-Baptiste demeure pour nommer les célébrations. Par extension, au Québec, les termes Canadiens français et Québécois deviennent équivalents, tel que l’avait initié Maurice Duplessis, premier ministre du Québec, dans les années 1950.
Il s’est donc produit une évacuation des Canadiens français hors Québec de la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Pourtant, la fête de la nativité de saint Jean le Baptiste est célébrée dans les communautés francophones partout au Canada. Le Festival franco-ontarien en est une des manifestations les plus éclatantes, et les Acadiens tiennent également des célébrations, bien que leur Fête nationale, le 11 août, soit généralement plus étendue.
Il est évident que la Fête nationale du Québec en tant que province est importante, mais laisser de côté les autres Canadiens francophones dans nos célébrations équivaudrait à nier nos racines françaises communes ainsi que notre culture forgée à travers des siècles d’adversité et de combats à la fois armés et rhétoriques. Au sein du multiculturalisme canadien, les francophones d’ascendance française se doivent d’être solidaires, afin que les communautés francophones minoritaires puissent continuer d’exister.
Inventions canadiennes
Le Bloody Caesar
Lorsque l’on engagea le barman Walter Chell pour créer un nouveau cocktail soulignant l’ouverture, en 1969, du restaurant italien Marco’s, au Calgary Inn, il concocta une boisson digne de l’Empire romain : le Bloody Caesar. Après quelques mois d’expérimentation, il décida d’imiter les saveurs du spaghetti alle vongole (spaghetti avec des palourdes) et ajouta le bouillon de ces savoureux fruits de mer dans du jus de tomate. De la vodka, un trait de sauce Worcestershire, du sel, du poivre, de l’origan, et le tour est joué!
— Julijana Capone
Le masque à gaz
Pendant la bataille d’Ypres de la Première Guerre mondiale, les soldats étaient exposés à du gaz chloré et devaient couvrir leur nez et leur bouche d’un torchon imbibé d’urine pour se protéger des vapeurs nocives. Cluny Macpherson, médecin de St. John’s, à Terre-Neuve, fut le premier à trouver une meilleure solution. Officier médecin au sein du 1er Newfoundland Regiment, Macpherson agissait à titre de conseiller sur les gaz nocifs en Turquie lorsqu’il créa une capuche de toile munie d’écrans vitrés pour protéger les yeux et d’un tube pour respirer. Le masque était également traité avec des produits chimiques qui offraient une protection contre les émanations de chlore.
— Amanda Hope
Le tournevis Robertson
Le vendeur itinérant Peter Lymburner Robertson créa le premier tournevis à tête carrée et la vis à cavité à la suite d’une blessure à la main subie après avoir utilisé un tournevis à lame plate en 1906. La production débuta dès 1908. Robertson exerça une grande influence sur l’économie de Milton, en Ontario, où il ouvrit son usine. Le tournevis connut un véritable succès. On pouvait l’utiliser d’une seule main, il tenait bien en place sur la vis, sans la briser. Il était également très précis, devenant l’outil idéal pour l’industrie automobile.
— Richard Wood
Le toboggan
Aujourd’hui utilisé à des fins récréatives et sportives (pensez à la luge et au bobsleigh), les toboggans étaient employés au quotidien par les Autochtones qui l’ont inventé. On s’en servait notamment pour tirer de lourdes charges de bois sur la neige. De minces planches de bois étaient reliées côte à côte et recourbées vers l’avant, et les languettes transversales assuraient une plus grande solidité à l’ensemble.
— Richard Wood
Le hockey sur table
Quelle que soit votre équipe de hockey favorite, vous pouvez remercier Donald H. Munro de Toronto pour avoir conçu le premier jeu de hockey mécanique. Il créa ce jouet à partir de débris de bois et de métal et l’offrit à ses enfants pour Noël pendant la Grande Dépression. Rapidement, la compagnie T. Eaton lui en passa la commande. Le Munro Standard Model, vendu 4,95 $ dans le catalogue d’Eaton de 1939–1940, ressemblait à un jeu de flipper à deux côtés avec des chevilles de bois pivotantes et des boucles de fil métallique pour lancer la rondelle, qui était en fait une boule de métal.
— Kristen Fry
Convergence harmonique
Qu’est-ce qui a six cordes et raconte l’histoire d’une nation? Si vous avez répondu le projet Six String Nation, vous avez raison!
Il s’agit en fait de créer une guitare composée de plus de soixante éléments, chacun évoquant un aspect de l’histoire ou de la culture du Canada. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le diffuseur Jowi Taylor et le maître luthier, George Rizsanyi.
M. Rizsanyi a bâti l’instrument dans son atelier de la Nouvelle-Écosse. Sa création exceptionnelle comprend des pièces d’objets et de structures, comme une entrée de porte du premier quartier chinois du Canada; le phare qui a reçu le premier signal de détresse du Titanic; de l’argent brut extrait de la mine Beaver, à Cobalt, en Ontario; du cuivre provenant du toit de la bibliothèque du Parlement; un morceau de la moustiquaire de la fenêtre du studio du peintre Lawren Harris et des pièces d’ivoire de mammouth et de mastodonte.
— Phil Koch
L’Épinette dorée
La guitare comprend une pièce de bois tirée de l’arbre légendaire connu sous le nom de Kiidk’yaas, ou l’Épinette dorée, une merveille naturelle sacrée pour le peuple Haïda près de Port Clements, en C.-B.. Il fut malencontreusement abattu en 1997 par un manifestant. Cette pièce de bois est la seule qui ait été tirée de cet arbre exceptionnel. Avec la permission de la communauté Haïda de Old Masset.
La cabane de John Ware
Le premier cowboy noir de l’Alberta, John Ware, est né esclave en Caroline du Sud, mais devint une légende à son décès, en 1905, quelques jours seulement après l’accession de l’Alberta au statut de province. Le bois est extrait de sa cabane, qui se trouve aujourd’hui dans le parc provincial Dinosaur. Avec la permission du Royal Tyrrell Museum.
Bluenose II
La guitare comprend un morceau du pont du Bluenose II, qui a été en partie construit à partir de matériaux conservés pour réparer le Bluenose original qui a sombré en 1946. Gracieuseté de Lex McKay, du sénateur Wilfred Moore et du Bluenose Preservation Trust.
Aviron de Pierre Trudeau
Le morceau de bois extrait d’un des avirons ayant appartenu au premier ministre canadien, et amateur de plein air, Pierre Elliott Trudeau, a été gracieusement offert par Justin Trudeau.
La bague de la Coupe Stanley de Maurice Richard
Maurice « Rocket » Richard a commandé une série de bagues pour lui-même et ses coéquipiers des Canadiens de Montréal après avoir remporté la Coupe Stanley en 1956. L’extrait d’or tiré de la bague de Maurice Richard a été obtenu avec l’autorisation de David Treherne.
Le couteau de Joe Labobe
Champion ouvreur d’huîtres et héros micmac, Joe Labobe est originaire de la réserve de Lennox Island à l’Île-du-Prince-Édouard. Le manche de ce couteau à huître a été gracieusement offert par la famille Labobe.
Au-delà des distances
21 juillet, 1836
Le premier chemin de fer public à voir le jour au Canada fut construit dans le Bas-Canada (sur le territoire québécois). Le Chemin de fer Champlain et Saint-Laurent reliait La Prairie près du fleuve Saint-Laurent à Saint-Jean-sur-Richelieu. La première locomotive à se déplacer sur la ligne se nommait Dorchester (illustrée ci-dessus). Elle utilisait le bois comme carburant et avait une vitesse de pointe d’environ quarante-huit kilomètres-heure.
10 août 1876
Alexander Graham Bell, illustré ci-dessus, fut celui qui reçut le premier appel à longue distance au monde. Bell a reçu l'appel en provenance de Brantford en Ontario alors qu’il utilisait un téléphone installé au comptoir de télégraphe d’un magasin de chaussures appartenant à Robert White à Paris, en Ontario. La distance entre les deux interlocuteurs était d'environ treize kilomètres.
7 novembre 1885
Donald A. Smith, président du chemin de fer Canadien Pacifique, installa le dernier crampon du premier chemin de fer transcontinental du pays. Il fallut toutefois attendre encore six mois avant qu’un premier train puisse parcourir le pays parce que certaines sections du tracé se devaient d’être achevées. Cela fut chose faite le 4 juillet 1886, lorsqu'un train de passagers du chemin de fer Canadien Pacifique arriva à Port Moody en Colombie-Britannique près de six jours après avoir quitté Montréal.
23 février 1909
Cinq ans après que deux frères originaires des États-Unis réalisèrent le premier vol propulsé au monde, un petit groupe se réunit à Baddeck, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, pour vivre un moment historique. Une équipe, menée par l'inventeur Alexander Graham Bell, fut témoin d’un exploit réalisé par le pilote J.A.D. McCurdy. Celui-ci parcourut, à bord de son aéroplane le Silver Dart, une distance d'environ huit cents mètres. Il compléta ainsi le premier vol motorisé au Canada.
14 octobre 1912
Thomas Wilby et Jack Haney arrivèrent à Vancouver après un voyage de quarante-neuf jours, complétant ainsi le premier voyage en automobile à travers le Canada. Le duo qui avait quitté Halifax dans une automobile REO 1912, transportait une bouteille avec l’eau de l'océan Atlantique qu’ils versèrent dans le Pacifique afin de souligner l'exploit de ce premier voyage routier transcanadien.
5 octobre 1984
Marc Garneau participa à un voyage que l’on peut considérer hors de notre monde, et devint ainsi le premier Canadien à atteindre l'espace extra-atmosphérique. Garneau était alors spécialiste de charge utile à bord de la navette spatiale Challenger. Au cours de sa carrière d'astronaute, il enregistra un total de 677 heures dans l'espace lors de trois missions de la navette.
Wilfrid Laurier vu par André Pratte
Dans l’édition octobre/novembre du magazine Canada’s History, une grande place est donnée à Sir Wilfrid Laurier, premier francophone à occuper le poste de premier ministre du Canada entre 1896 et 1911.
L’année 2016 marque le 175e anniversaire de naissance de Laurier. Pour en apprendre un peu plus au sujet de la vie de l’homme politique et de ses legs, nous vous proposons de visionner un épisode de l’émission Les publications universitaires diffusée à l'antenne du Canal Savoir. L’animateur Guillaume Lamy rencontre André Pratte, auteur d'une biographie portant sur Laurier parue en 2011 aux Editions du Boréal.
Wilfrid Laurier: Quand la politique devient passion
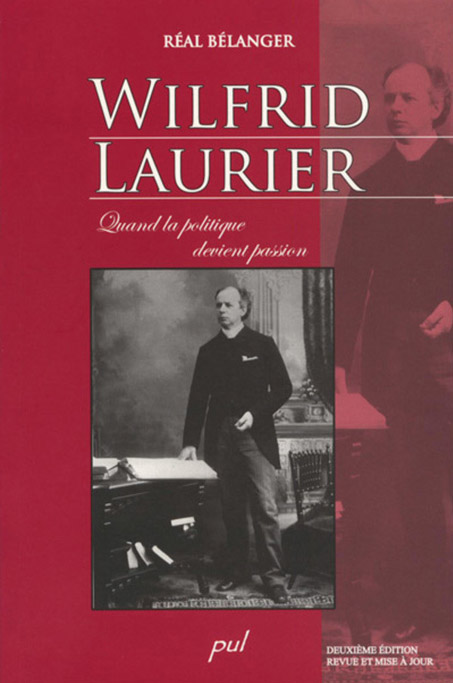
Réal Bélanger. Wilfrid Laurier: Quand la politique devient passion. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2014. 468 pages.
Résumé :
Quand la politique devient passion. Formule qui résume admirablement la vie privée et publique de celui qui demeure sans doute l'homme politique canadien le plus illustre: Wilfrid Laurier. Illustre et mal connu tout à la fois. Voilà pourquoi Réal Bélanger, professeur au Département d'histoire de l'Université Laval et codirecteur du Dictionnaire biographique du Canada/Dictionary of Canadian Biography, a voulu, dans cette biographie historique, tracer, sans parti pris ni indulgence, le portrait du premier ministre et du chef de parti, mais aussi de l'homme. En effet, derrière le personnage, le lecteur découvrira un homme fascinant et attachant. Cette biographie fut le produit de quelque douze années de recherche dans de multiples fonds d'archives, journaux d'époque, mémoires, comptes rendus des débats de la Chambre des communes et autres sources des plus diversifiées. Lancée en 1986, au moment de la parution de la série télévisée Wilfrid Laurier produite par la Société Radio-Canada, elle s'est méritée le prix Maxime-Raymond et fut considérée, en 2002, comme l'une des vingt-cinq biographies marquantes des vingt-cinq dernières années du Salon du livre de Montréal. Aujourd'hui, Réal Bélanger présente aux lecteurs une édition mise à jour de cette biographie qui tient compte de l'historiographie des vingt dernières années.
Acheter l’édition révisée en version électronique chez Renaud Bray
Un homme qui détonne
Nom étrange, homme étrange. Amor De Cosmos de la C.-B. se qualifiait lui-même « d’amoureux de l’univers », mais on peut dire que l’amour n’était pas toujours au rendez-vous avec ses opposants politiques.
Il fut le deuxième premier ministre de la Colombie-Britannique, et aurait très bien pu en être le premier. Sans lui, il n’y aurait peut-être jamais eu de province canadienne sur la côte Pacifique.
Dès qu’il mit le pied dans cette toute jeune colonie de la Couronne sur l’île de Vancouver en 1858, il défendit avec ardeur trois objectifs politiques improbables : la fusion de l’île de Vancouver avec la zone continentale, la fusion de la Colombie-Britannique avec le Canada et un gouvernement autonome responsable pour la province.
Véritable visionnaire politique, il insista pour que les Britanniques nés en Amérique du Nord, comme lui, aient les mêmes droits que les Britanniques nés en Angleterre, même si, comme l’écrivait le politicien britanno-colombien John Sebastian Helmcken dans ses mémoires en 1890, les Canadiens « étaient généralement considérés comme les Chinois de l’Amérique du Nord » par l’establishment britannique de la colonie. Imperturbable devant une telle dérision, il fit la promotion de l’union de toutes les colonies britanniques d’Amérique du Nord dès 1860, et voyait la nation s’étendre de la frontière des États-Unis jusqu’à l’océan Arctique, et…. de l’Atlantique jusqu’au Pacifique.
Au-delà de cette vision, il voyait un Canada membre autonome d’un Commonwealth britannique, encore inexistant à cette époque, soulignons-le, avec à sa tête un gouverneur général choisi « parmi notre peuple ». Un des premiers députés de la Colombie-Britannique à Ottawa (poste qu’il occupa en même temps que celui de premier ministre pendant une certaine période), il perdit son siège pour avoir fait l’ambitieuse suggestion que le Canada devienne un jour une nation indépendante.
Il se nommait Amor De Cosmos. Aujourd’hui, en C.-B. et au Canada, on se souvient encore de lui (parfois), mais pour les mauvaises raisons.
Son nom inhabituel, signifiant « amoureux de l’univers » (né William Alexander Smith) n’aidait pas sa cause. Sa personnalité et son apparence non plus d’ailleurs. Méprisé par les autocrates (le secrétaire de la colonie le décrivait comme un « véritable truand de démocrate »), il a été l’auteur de phrases telles que : « Les représentants du peuple sont au service du peuple. Le peuple est notre maître et le maître veut savoir ce que font ses représentants ». Et pourtant, Amor De Cosmos n’était pas un populiste, il était distant, arrogant, vaniteux et, comme l’a déjà dit Helmcken, « suprêmement égoïste ». Dans la colonie de l’époque, où les chariots enfonçaient dans la boue jusqu’aux essieux pendant l’hiver, il était toujours impeccablement mis, portant pardessus, haut-de-forme et bottes de cuir verni. Sa canne ne lui servait pas d’appui, mais d’arme d’autodéfense (et parfois d’attaque) pour régler des disputes politiques.
Solitaire, tant sur le plan personnel que politique, il réussit à nourrir l’hostilité de ses amis et ennemis, même John Robson (un autre futur premier ministre de la C.-B.), dont les visions politiques étaient très proches des siennes, à tel point que les caricaturistes les représentaient sous la forme d’une tête à deux faces. De Cosmos pouvait être mesquin, il était probablement corrompu et ne mettait pas toujours en pratique ses beaux principes. Mais, étrangement, il commandait le respect, même chez ses opposants. Comme Robson l’a déjà mentionné « l’homme n’a rien pour se faire aimer. Comme politicien, je suis en désaccord avec lui sur de nombreux sujets, et je ne lui fais absolument pas confiance… Et pourtant, on ne peut qu’admirer son zèle, le dévouement avec lequel il défend des mesures qu’il jugeait justes à l’époque et ses talents d’éminent juriste… ses pires ennemis ne peuvent que l’admettre. »
Né en Nouvelle-Écosse en 1825, William Alexander Smith a passé sa jeunesse à nourrir sa fascination pour la théorie politique. Il s’intéressait principalement à la notion de gouvernement responsable, telle que mise de l’avant par Joseph Howe (un système parlementaire composé d’un gouverneur, qui exerce son pouvoir seulement sous les conseils d’un cabinet exécutif, et qui doit obtenir l’appui d’une majorité d’élus, qui à leur tour représentent une majorité d’électeurs de leur circonscription). Destiné à une carrière de commis d’épicerie, Smith décida sur un coup de tête de partir pour les mines d’or de la Californie, en 1851. Il fit rapidement fortune, non pas en creusant le sol, mais en photographiant des concessions minières pour établir les droits de leurs propriétaires pour la somme de 20 $. C’est lors de son passage en Californie que Smith changea officiellement de nom pour Amor De Cosmos.
Son voyage de 1858 dans la région qui se trouve aujourd’hui en C.-B. afin de visiter les mines d’or tout juste découvertes ont sans doute rallumé son intérêt pour le modèle politique britannique, puisqu’il vendit son entreprise de photographie et fonda un journal à Victoria, le British Colonist (l’ancêtre du Victoria Times Colonist qui existe encore aujourd’hui).
Dans sa toute première parution, De Cosmos promet de traiter la question de « l’union des colonies » et de « favoriser l’introduction d’un gouvernement responsable ». Dans le numéro suivant, il vise directement le népotisme du gouvernement de l’île de Vancouver : « la loyauté, l’honnêteté et la compétence, les piliers de la présence britannique, sont minées par le caractère illégitime de ses représentants, et les bureaux de la colonie sont remplis de flagorneurs, d’incompétents et de consanguins, auxquels viennent se greffer de mornes Britanniques et des Yankees renégats ».
Il avait raison de voir rouge. James Douglas, le chef autocratique et austère du quartier général de la Compagnie de la Baie d’Hudson dans le Pacifique, à Fort Victoria, avait également été nommé gouverneur de l’île de Vancouver en 1851. (Cette double loyauté ne troublait en rien les quelques centaines de résidents du fort. Presque tous étaient des employés de la Compagnie et s’attendaient à ce que toutes les dépenses de nature civile soient payées par la compagnie, et non par le truchement d’impôts prélevés sur leur salaire).
En 1856, le bureau de la colonie ordonna à Douglas de former une assemblée législative, mais les sept membres élus dans les règles comprenaient le beau-frère de Douglas, le mari de sa nièce, son futur gendre (le génial et pragmatique M. Helmcken, longtemps président de l’Assemblée et opposant politique habituel, mais à l’occasion l’allié, de De Cosmos), ainsi que quatre anciens membres de la Compagnie de la Baie d’Hudson.
La ruée vers l’or de 1858 dans la région continentale, où la CBH détenait les droits commerciaux exclusifs, mais qui n’était régie par aucune autorité politique, précipita la crise. Du jour au lendemain, la population blanche de la région passa de 450 résidents à plus de 30 000, surtout des mineurs américains indisciplinés et fort tapageurs. Le chaos et la peur d’une annexion aux États-Unis par simple occupation du territoire faisaient craindre le pire. Douglas décida de remédier à l’absence de gouvernement et nomma, sans consulter qui que ce soit, des juges britanniques et d’autres officiels pour maintenir l’ordre. Le bureau de la colonie se hâta d’officialiser ces nominations, fit de cette région continentale une colonie de la Couronne (la Colombie-Britannique) et nomma Douglas « double » gouverneur, à condition qu’il abandonne de son troisième chapeau, soit celui de chef de la Compagnie de la Baie d’Hudson.
Même si les deux colonies étaient officiellement britanniques, leur population était en grande partie constituée d’Américains. Les devises et le service postal étaient américains, on y faisait flotter des drapeaux américains et on célébrait des fêtes américaines. La population générale, et même des politiciens comme Helmcken, considérait alors que l’annexion aux États-Unis était inévitable. Une pétition demandant cette annexion fut même signée par des colons et envoyée à la reine Victoria.
De Cosmos et son journal s’y opposaient fermement, proposant même l’idée d’une contrepétition demandant l’annexion par la Couronne britannique des territoires américains au nord de la rivière Colombia, aujourd’hui dans la région continentale de la C.-B. Pendant les cinq années suivantes, il défendit sans relâche l’union des deux colonies du Pacifique, l’unification de toutes les colonies de l’Amérique du Nord britannique et, comme s’en plaignait Helmcken, l’instauration d’un gouvernement responsable. De Cosmos, qui avait une meilleure compréhension de la procédure politique que la plupart des législateurs néophytes de la colonie, critiquait également la forme du gouvernement de l’époque : « Même les règles parlementaires d’un conseil indien, où le chef parle et les guerriers écoutent, n’ont pas été entendues. Les débats évoquent une soirée bavaroise où les buveurs en sont à leur sixième pinte de bière et n’ont rien à voir avec le décorum et les prérogatives d’une véritable assemblée. »
En 1863, De Cosmos réussit à se faire élire à l’assemblée. Il continua de défendre l’union des deux colonies et le gouvernement responsable. Un de ses rêves fut cependant éclipsé par l’autre : même si une résolution, inspirée par les idées de De Cosmos, sur le gouvernement responsable fut adoptée en 1864, elle ne fut jamais mise en œuvre. Lorsque les colonies fusionnèrent en 1866, les institutions du gouvernement de l’île de Vancouver furent absorbées au sein du nouveau gouvernement, partiellement élu, de la Colombie-Britannique.
La C.-B. étant maintenant une seule et même colonie de la Couronne, De Cosmos jeta son dévolu sur la Confédération. Même s’il défendait cette idée depuis longtemps, il était encore le seul à la prôner au conseil législatif. Comme le nota Helmcken, « personne [au sein du conseil législatif de la C.-B.] ne connaît vraiment le sujet, à l’exception de De Cosmos et Robson ». Néanmoins, De Cosmos parviendra à convaincre le conseil d’exiger l’ajout d’une disposition dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 prévoyant l’entrée éventuelle de la C.-B. dans la Confédération.
Les particularités liées au commerce, au transport et aux populations de la région, sans oublier l’achat de l’Alaska par les É.-U. en 1867, qui tenait la C.-B. en sandwich entre deux territoires américains, rendaient l’annexion aux É.-U. encore plus probable, une réalité dont les Américains étaient d’ailleurs très conscients. Même la Grande-Bretagne donna son aval à ce scénario. Le London Times publia ce qui suit : « Si la population de la C.-B. rejette la Confédération, après avoir mûrement réfléchi, et désire se joindre aux États-Unis, la mère patrie ne s’opposera d’aucune façon à cette annexion ». Pourtant, en 1868, De Cosmos demande l’admission immédiate de la C.-B. au Canada en vertu de modalités qu’il impose lui-même, soit « la création d’institutions représentatives du peuple, ainsi qu’un contrôle responsable du gouvernement », et « une route transcontinentale pour les chariots (pas encore le chemin de fer), modalités qu’il qualifie de « conditions essentielles ».
Plus tard cette même année, convaincu que la population souhaitait cette Confédération, mais que le gouverneur Frederick Seymour s’opposait à la volonté du peuple, De Cosmos décida d’outrepasser les pouvoirs de Seymour et de s’adresser directement à la reine Victoria. Avec Robson, il organisa la Convention de Yale, à laquelle participèrent des citoyens-délégués detoutes les régions de la C.-B., dans « le but d’accélérer l’admission de la colonie dans le Dominion du Canada » et de « protégerles institutions représentatives d’un gouvernement responsable au sein de la colonie ». Les résolutions des délégués furent envoyées à Londres, mais la convention fut en grande partie raillée car un de ses membres, Mifflin Gibbs de Salt Spring Island, était Noir.
Lorsqu’il mourut, le 4 juillet 1897, à peine quelques personnes assistèrent à ses funérailles.
Amoureux de l'univers
On ne naît pas Amor De Cosmos, on le devient. Il commença à exister à l’âge de 28 ans, le 17 février 1854, au moment où son prédécesseur, William Alexander Smith, cessa légalement d’exister. Son nom, qui signifie « Amoureux de l’univers » en latin, français et grec, fut une véritable source d’hilarité, de soupçons, de mépris et de rejet.
Son nom fut évidemment écorché (Amos de Cosmos, Armor Debosmos), et même amplifié (Amor Muggins Cosmos, Amor De Cosmos Caesar), mais resta tout au long de sa vie la source de rumeurs selon lesquelles il cachait un passé d’illégalité et d’immoralité. À ce jour, son nom condamne l’homme à n’évoquer qu’un personnage coloré qui mourut fou.
Pourquoi Bill Smith choisit-il un nom aussi inoubliable? Laissons l’homme s’expliquer : « Je désire adopter le nom d’Amor De Cosmos non pas parce qu’il est à consonance étrangère, mais parce qu’il s’agit d’un nom inhabituel qui désigne ce que j’aime le plus : l’ordre, la beauté, le monde, l’univers. »
Dans le contexte de l’époque, le nom n’est pas dénué de sens. De nombreuses inventions scientifiques et industrielles (la machine à coudre, le télégraphe, les bateaux à vapeur, les chemins de fer) transforment la façon dont les gens vivent depuis des siècles. L’expansion des pays, sur les plans économique et national, l’éducation accessible pour tous, les avancées en médecine, les réformes politiques et la démocratisation graduelle de la politique tendent toutes vers une utopie réalisable. Il n’y a pas de limites à ce que l’homme peut faire, inventer ou découvrir : l’homme, les machines et la nature elle-même sont régis par des principes mécaniques.
Sansnul doute, De Cosmos voyait la passion de sa vie, le gouvernement responsable relevant d’un système parlementaire nord-américain à la britannique, comme un objet de beauté et d’ordre. À ses yeux, ce mécanisme politique presque parfait ne pouvait que mener à une société ordonnée et civilisée.
Le dernier mot sur son nom revient à De Cosmos lui-même : « Si les partis s’opposent à mes opinions politiques, ils sont libres de le faire et de disséquer ma pensée. Mais je m’adresse essentiellement au public. Peu importe ses défauts ou ses lacunes, c’est mon intention honnête et franche. Discutons de mes principes sans avoir de scrupules, mais le nom que je décide de porter ne concerne que moi. S’il me plaît de m’appeler ainsi, qui êtes-vous pour vous y objecter? »
Les arguments ambitieux de De Cosmos furent essentiels pour porter la question de la Confédération au coeur du débat public, mais cefurent des considérations beaucoup plus prosaïques qui agirent en faveur du Canada. Les coffres de la C.-B. étaient à nouveau à sec (comme l’étaient ceux de l’île de Vancouver lorsqu’elle accepta de se joindre à la région continentale, riche en minerais) et l’attitude de la plupart des colons à l’égard du gouvernement était tout sauf passionnée. La Grande-Bretagne était occupée ailleurs et indifférente. Impossible d’agir seul pour cette population de 36 000 personnes, dont plus des deux tiers étaient des Autochtones. Les alléchantes promesses américaines tardaient à se concrétiser. Ottawa promit de payer la dette de la C.-B. de 1 500 000 $ et de bâtir un chemin de fer.
Le dénouement fut rapide. En 1869, le gouverneur Seymour mourut brusquement et fut remplacé par Anthony Musgrave, un pro-Confédération. En 1870, une délégation de trois hommes, excluant volontairement De Cosmos et Robson, mais faisant tout de même une place à Helmcken qui n’était pas très convaincu et s’était jusqu’à présent opposé à la Confédération, fut envoyée à Ottawa. Ils y établirent des modalités convenant aux deux parties. Un gouvernement responsable pour la C.-B., le Saint-Graal de De Cosmos, fut accordé par le gouverneur Musgrave le 19 juillet 1871. Le lendemain, la C.-B. devint une province du Dominion du Canada.
De Cosmos fut écarté comme lieutenant-gouverneur en faveur de Joseph Trutch, chef de la délégation pro-Confédération. Trutch, dans une décision visant à éloigner à tout prix De Cosmos, demanda à un obscur avocat sans charisme du nom de John Foster McCreight de diriger le premier gouvernement de la C.-B. en tant que premier ministre. De Cosmos fut élu à l’Assemblée législative provinciale et à la Chambre des communes fédérales.
En 1872, le gouvernement précaire de McCreight s’effondra et Trutch n’eut pas d’autre choix que de solliciter De Cosmos pour former un gouvernement. Comme premier ministre, De Cosmos fut compétent, mais sans éclat. Lorsque la double représentation fut abolie, il quitta son poste de premier ministre et son siège, en 1874, pour concentrer ses énergies à Ottawa. Il y défendit le prolongement du chemin de fer Canadien Pacifique jusqu’à l’île de Vancouver et demanda que le terminus de la région continentale soit déplacé de Port Moody à English Bay, et que le trajet se poursuivre en « ferry à vapeur » jusqu’à l’île. (Le déplacement du terminus en 1887 donnera naissance à la ville de Vancouver).
De Cosmos fut facilement réélu comme député en 1874 et 1878. Juste avant l’élection de 1882, il affirma qu’il « ne voyait pas pourquoi le Canada ne devrait pas envisager la possibilité de devenir un État souverain et indépendant ». Il fut défait cette même année.
De Cosmos s’effaça de la scène publique pour mener une vie solitaire à 57 ans et commença à présenter les signes d’un long déclin physique et mental qui s’échelonnera sur une période de quinze ans et finira par l’emporter. Il pourrait bien s’agir de la maladie d’Alzheimer, car il perdit la capacité de parler de façon cohérente et son comportement devint erratique et étrange. L’homme déjà considéré par la presse populaire comme « la représentation du bien en Colombie-Britannique » et qui contribua à changer la destinée de cette grande province, errait dans les rues de Victoria, hagard et perdu, mais portant toujours haut de forme et redingote. Son regard fixe, plongeant dans le visage de ses concitoyens, était déstabilisant et, comme le dira George Woodcock dans sa biographique de De Cosmos datant de 1975, « c’était comme s’il cherchait à faire revivre ses souvenirs… ». Il fut éventuellement mis sous tutelle; deux ans avant sa mort, il fut déclaré mentalement inapte.
Norm et Carol Hall sont des auteurs pigistes de la C.-B. qui s’intéressent plus particulièrement au passé, au présent et à l’avenirde la région du nord-ouest du Pacifique. Leur dernier article pour The Beaver s’intitulait « At a Crucial Hour: The Attack onEstevan Point » (avril/mai 2004).
Cet article est paru à l’origine dans le numéro d’octobre-novembre 2006 du Beaver.
Un match parfait
Le grand comédien Johnny Wayne qui assistait à un entraînement des Maple Leafs de Toronto au Maple Leaf Gardens dans la saison 1966‐1967 de la Ligue nationale de hockey, lança moqueur la boutade suivante : « Ce ne sont pas les blessures au genou qui nuiront à cette équipe, plutôt les chirurgies de la prostate. » M. Wayne signifiait à sa manière que l’effectif des Leafs était, selon les standards de la LNH, composé de vieux. Sept joueurs actifs cette saison‐là avaient au moins trente-six ans, chose exceptionnelle dans le monde des sports professionnels.
Cela explique pourquoi la victoire des Leafs à la coupe Stanley en 1967 ressort des quatorze titres remportés par des équipes torontoises, onze sous la bannière Maple Leaf. La finale, qui a opposé les Leafs à leurs grands rivaux les Canadiens de Montréal, fut un match parfait : deux des « six équipes originales » du Canada croisaient le fer durant l’année du centenaire du pays.
Le sixième et décisif affrontement, qui s’est soldé par une victoire de 3 à 1 contre les Canadiens au terme d’une partie magnifiquement jouée, reste gravé à jamais dans la mémoire des 15 977 partisans présents dans le Maple Leaf Gardens ce soir‐là, et des millions de personnes rivées à leur poste radio ou à leur télé. Cette fantastique soirée de mai ne se répétera pas dans la seconde moitié du centenaire de la LNH, période durant laquelle les Leafs ont formé des équipes, la plupart du temps médiocres – récoltant de grosses recettes au guichet, mais de minuscules résultats sur la patinoire.
Les Leafs ont participé à beaucoup de parties remarquables dans les cinquante premières années de la ligue. Mais, pour le seul aspect dramatique, l’exploit de 1967 sort du lot – la sixième partie, une prestation de soixante minutes à couper le souffle et d’un suspense insoutenable.
Les Leafs des années 1960 sont devenus, sous la gouverne du directeur entraîneur George (Punch) Imlach, une puissante machine. Dès la saison 1966‐1967, M. Imlach sembla s’inspirer de Casey Stengel, un gérant de génie de la Ligue majeure de baseball au langage particulier, qui déclara un jour « Don’t forget the folks what brung ya » (« N’oubliez pas les gens qui vous ont amené jusque là. »)
Renonçant à rajeunir son effectif, M. Imlach préféra s’en tenir à ses anciens joueurs, faisant ainsi des Leafs un « foyer de vieux » avec comme gardiens de but, Johnny Bower, 42 ans et Terry Sawchuk, 37 ans, les défenseurs Allan Stanley, 41 ans, Tim Horton, 37 ans et Marcel Pronovost, 37 ans, ainsi que les avants George Armstrong, le capitaine, 36 ans et Red Kelly, 39 ans. Les Leafs comptaient aussi sur l’excellent joueur de centre ambidextre Dave Keon en plus des anciens avants aguerris Bob Pul¬ford et Frank Mahovlich, des dééfenseurs Bob Baun et Larry Hillman. Les avants Ron Ellis, Pete Stemkowski, Jim Pappin, Brian Conacher et Mike Walton formaient l’élément jeunesse et rapidité.
Les Blackhawks de Chicago, champions de la ligue, avec Bobby Hull et Stan Mikita dans leurs rangs, étaient pressentis pour balayer la série demi-finale contre les Leafs. Mais grâce à l’extraordinaire prestation des vieux Bower et Sawchuck devant le but, les Leafs ont remporté la série en six parties.
Les Leafs n’étaient pas les favoris contre les jeunes « Habitants », et lorsque les Canadiens remportèrent la première partie 6 à 2, à Montréal, le ciel des Leafs s’assombrit. Pourtant, appuyés par une superbe prestation du gardien Bower, les Leafs gagnèrent les deux parties suivantes. Dans le quatrième match, Bower se blessa durant l’échauffement, son remplaçant Sawchuk trouva la soirée longue en accordant 6 buts dans la défaite de 2 à 6. Mais dans la partie suivante, Sawchuk excella dans la victoire de 4 à 1 à Montréal.
Au cours la sixième partie, dans un Maple Leaf Gardens bondé, ce fut plus souvent des murmures anxieux que des acclamations qu’on entendit alors que Sawchuk stoppa les dix-sept tirs dirigés vers lui en première période. Il y eut une explosion retentissante lorsqu’Ellis mis fin à l’impasse à 6 min 25 s de la deuxième période, et une autre plus forte quand Pappin doubla l’avance dans la dernière minute. Mais voilà que Dick Duff, ancien joueur populaire des Leafs, marqua un but pour les Canadiens à 5 min 28 s en troisième période. Le score était 2‐1.
On est dans la dernière minute. Une mise au jeu a lieu dans la zone des Leafs, les Canadiens retirent leur gardien de but. Un silence anxieux règne dans le Gardens au moment où Imlach désigne les cinq patineurs qui lui ont été fidèles ces dix dernières années &ndash Kelly, Armstrong, Pulford, Horton et Stanley. Le défenseur Stanley gagne la mise au jeu contre le puissant Jean Béliveau, il passe la rondelle à Kelly qui la relaie à Pulford. Lorsque des joueurs des Canadiens foncent vers lui, Pulford aperçoit Armstrong qui, de son coup de patin laborieux, approche de la ligne bleue. La passe précise de Pulford permet au vétéran capitaine de lancer la rondelle dans le but déserté d’une distance de 90 pieds. C’est peut-être le but le plus célèbre de l’histoire du bleu et blanc.
En lire davantage:
Le plus grand match : D’anciens chroniques de hockey racontent les parties les plus mémorables auxquelles ils ont assisté
Les Jets de Winnipeg prennent leur envol : La soirée où des Jets inconnus ont triomphé des Canadiens, très connus.
Du vrai cran : une bourde prive les oilers de la coupe stanley, mais ne brise pas l'homme qui l'a faite.
Le gros bill : Une soirée mémorable à un match des Canadiens de Montréal en compagnie du bien-aimé Jean Béliveau
Le triomphe de McDonald : Fin de carrière dramatique de légendaire member du temple le la renommée des Flames
Pour qui résonne le métal : les malheureux Canucks voient leurs rêves de coupe anéantis.
Virage : Le match qui donné une nouvelle identité aux Sénateurs d’Ottawa et à leur capitaine de longue date
Score de guerre froide : Pour les Canadiens, le but de Paul Henderson dans les dernières secondes de la sécondes de la série Canada-URSS a été le plus grand entre tous.
Frank Orr est un ancien chroniqueur de hockey du Toronto Star qui a écrit une trentaine de livres sur les sports.
Le gros Bill

Jean Béliveau
Je suis devenu un admirateur de Jean Béliveau les neuf dernières années de sa carrière : j’avais quatorze ans lorsque le légendaire capitaine des Canadiens de Montréal prit sa retraite après avoir gagné dix coupes Stanley.
Mais l’ascendant et l’influence de M. Béliveau sur son équipe, sur son pays et sur la partie de hockey en général se sont fait sentir chaque jour jusqu’à son décès en décembre 2014. Son esprit est toujours bien vivant au sein de l’organisation des Canadiens et l’homme demeure dans une très large mesure la con¬science de l’équipe.
L’admirateur que je suis est devenu journaliste à la fin des années 1970; j’allais côtoyer à maintes reprises ce grand gentleman à l’époque où je gravitais autour des Canadiens. En 1999, alors que son équipe traversait une mauvaise passe, je me suis dit que le fier Jean Béliveau devait souffrir aussi. Vingt‐huit années après avoir marqué le dernier de ses 586 buts, une demi‐douzaine d’années après avoir quitté la vice‐présidence de l’équipe, le Gros Bill, surnom qu’il a hérité dans les années 1950, demeurait le visage que beaucoup de gens associaient à l’équipe la plus prolifique des Canadiens.
Que devait‐il ressentir, alors âgé de soixante‐huit ans, en voyant, soir après soir, de sa place habituelle au centre Molson (renommé depuis Centre Bell), trois rangées derrière le banc des Canadiens, les joueurs courber l’échine après une énième défaite consécutive? Á cette question, il m’a simplement répondu &loquo; Accompagnez-moi &raguo;. Je l’ai donc accompagné le 11 novembre 1999 et j’ai vécu la soirée la plus mémorable de ma vie professionnelle.
Assis à côté de cette icône du hockey et ce héros de ma jeunesse, j’ai pu constater que M. Béliveau, dans sa veste finement taillée, était aussi élégant et de présence imposante qu’il l’avait été vêtu du chandail bleu, blanc et rouge. À l’endroit sur le chandail où le C de capitaine a été visible de 1961 à 1971, il portait le coquelicot du jour du Souvenir et son épinglette de l’Ordre du Canada.
Élise, son épouse depuis quarante&dahs;six années, et Magalie Roy, alors âgée de treize ans, une de ses deux petites‐filles, étaient avec lui. On peut voir depuis les sièges de l’amphithéâtre le chandail arborant le numéro 4 de M. Béliveau pendre du plafond parmi les bannières des vingt‐quatre coupes Stanley remportées par les Canadiens.
Béliveau a véhiculé le souvenir à la fois réjouissant et douloureux des jours où pour les Montréalais, le Graal d’argent de Lord Stanley était plus qu’un mirage.
Vingt‐quatre heures auparavant à Pittsburgh, les Canadiens avaient plié bagage plus rapidement que des scouts en laissant filer, dans les dix dernières minutes de la partie, une avance de trois buts, concédant ainsi aux Penguins la victoire de 5 à 4. Ils affrontaient maintenant les Mighty Ducks d’Anaheim, invaincus à leurs neuf dernières parties.
« Ils souffrent probablement plus sur le plan émotif que physique », dit M. Béliveau. « Regardez Alain. Il est gris. » Ce n’était pas des cheveux de l’entraîneur Alain Vigneault dont il parlait, plutôt de son teint.
L’atmosphère derrière le banc était lourde et glaciale. M. Béliveau échappa un petit rire en entendant l’entraîneur Vigneault enguirlander, avec force d’invectives populaires dans les deux langues officielles du Canada, un juge de ligne francophone qui avait omis de signaler un déblaiement. « On a une meilleure vue de la patinoire quelques rangées plus haut », ajouta M. Béliveau. « Imaginez lorsque j’invite un père, qui autrement n’en aurait pas les moyens, et son fils et que le garçon puisse voir et entendre de si près les joueurs. Il se croît dans un rêve. »
M. Béliveau regardait l’affrontement à la fois comme partisan et spécialiste, étudiant la façon dont un jeu s’amorçait à un bout de la patinoire et prédisant avec une exactitude troublante son dénouement à l’autre bout quinze secondes plus tard. Si un chasseur d’autographes se présentait – et il y en avait beaucoup – il lui demandait poliment de revenir à la fin de la période, pour ne pas bloquer la vue au spectateur derrière.
Nous avons tous vu l’entraîneur Vigneault faire les cent pas, montrer des signes d’impatience et – enfin – applaudir au score final de 2 à 1 en faveur des Canadiens.
Au son de la sirène finale, M. Béliveau s’est levé et a applaudi pour célébrer la fin de la longue glissade de l’équipe. Vigneault, dont les joues avaient retrouvé leur couleur, soupirait de soulagement.
« Il y a de grands amateurs de hockey dans cette ville », dit M. Béliveau alors que nous retraitions vers le salon des anciens de l’équipe.
« Mais ne croyez-vous pas », poursuivit‐il, sourire en coin, « que nous les avons gâtés avec toutes ces coupes Stanley? »
En lire davantage:
Le plus grand match : D’anciens chroniques de hockey racontent les parties les plus mémorables auxquelles ils ont assisté
Un match parfait : La finale de la Coupe Stanley qui opposé dans l’année du centenaire du Canada les équipes de Toronto et de Montréal a mis un terme à des séries éliminatoires d’une ampleur mythique.
Les Jets de Winnipeg prennent leur envol : La soirée où des Jets inconnus ont triomphé des Canadiens, très connus.
Du vrai cran : une bourde prive les oilers de la coupe stanley, mais ne brise pas l'homme qui l'a faite.
Le triomphe de McDonald : Fin de carrière dramatique de légendaire member du temple le la renommée des Flames
Pour qui résonne le métal : les malheureux Canucks voient leurs rêves de coupe anéantis.
Virage : Le match qui donné une nouvelle identité aux Sénateurs d’Ottawa et à leur capitaine de longue date
Score de guerre froide : Pour les Canadiens, le but de Paul Henderson dans les dernières secondes de la sécondes de la série Canada-URSS a été le plus grand entre tous.
Dave Stubbs est billettiste et historien pour la Ligue nationale de hockey, et il écrit des textes pour le site NHL.com.
Le triomphe de McDonald

Lanny McDonald
Le jour où les Flames de Calgary ont gagné la première, et jusqu’à présent, la seule Coupe Stanley de leur histoire, l’entraîneur Terry Crisp a dû prendre une décision cruciale pour une carrière, du type qui ne se présente qu’occasionnellement dans les sports professionnels.
Agirait-il par sentiment en insérant dans son alignement le joueur le plus représentatif de la franchise, nommément Lanny McDonald, même si ce dernier n’avait fait que de brèves présences durant le parcours des Flames vers la finale de la Coupe Stanley de 1989 qui les opposait aux Canadiens de Montréal? Ou adopterait-il une démarche plus rationnelle et pragmatique en optant pour un joueur plus jeune et plus robuste?
M. Crisp n’avait pas beaucoup dormi la veille, absorbé par le dilemme, et ce n’est qu’au terme d’une longue promenade le long de la rue Sainte‐Catherine, après l’exercice de patinage du matin, qu’il trancha. McDonald jouerait – ce qui se passa ensuite fait dorénavant partie de l’histoire de la franchise.
Environ six heures après que M. Crisp ait pris sa décision, McDonald a reçu une passe de son joueur de centre, Joe Nieuwendyk, s’est avancé vers le gardien des Canadiens, Patrick Roy, et a marqué ce qui allait être le dernier but de sa remarquable carrière. McDonald avait compté son tout premier but dans la LNH contre Montréal alors qu’il était une recrue des Maple Leafs de Toronto. Ce but-là a été mémorable ; le dernier a écrit l’histoire. Il brisait l’égalité à un but en deuxième période et donnait aux Flames une avance qu’ils ne devaient plus perdre.
Doug Gilmour a porté le score à 3 à 1; mais les Canadiens ont réduit l’écart à un but. Puis dans les dernières secondes, Gilmour a mis le match hors de portée en marquant dans un filet désert. Score final de la partie et aussi de la série, 4 à 2; McDonald mettait alors un terme d’une façon digne d’un roman à une carrière remarquable en remportant la Coupe Stanley à sa dernière sortie dans un uniforme de la LNH.
Les Canadiens se sont installés dans le Forum de Montréal en 1926 et ont joué à cet endroit durant soixante‐dix années avant de déménager dans l’amphithéâtre qui porte désormais le nom de Centre Bell. Durant cette période, la seule équipe à remporter une coupe au Forum a été les Flames de Calgary.
C’était le retour du balancier, car trois années auparavant, les Canadiens avaient remporté leur vingt‐troisième Coupe Stanley au Olympic Saddledome de Calgary; une des rivalités les plus plaisantes de l’époque s’inscrivait alors dans un charmant cycle karmique.
Vainqueur, l’entraîneur Crisp a mérité son propre instant de notoriété. Il devenait un des huit hommes seulement à remporter la Coupe Stanley comme entraîneur et aussi comme joueur. L’équipe de cette année-là, assemblée par le directeur général Cliff Fletcher dans le but de rivaliser avec les Oilers d’Edmonton, la dynastie des années 1980, comptait six attaquants, auteurs de cinquante buts dans une saison à au moins une reprise dans leur carrière — McDonald, Nieuwendyk, Joey Mullen, Hakan Loob, Gary Roberts et Theo Fleury — et il ne faut pas oublier Gilmour, membre du Temple de la renommée et un des premiers joueurs polyvalents sur la place.
La défense était organisée autour du flamboyant Al MacInnis, gagnant du trophée Conn Smythe, remis au joueur le plus utile, dont le puissant lancer frappé était redouté par Roy, un des plus grands gardiens de tous les temps. Ça n’a pas été le chant du cygne uniquement pour McDonald. Loob, qui auparavant était devenu le premier joueur natif de Suède à compter cinquante buts dans une saison de la LNH, a pris sa retraite pour des motifs personnels — il désirait élever sa famille en Suède.
Nieuwendyk et Roberts étaient de jeunes blancs–becs — des amis d’enfance de Whitby, en Ontario, encore jeunes garçons la première fois qu’ils ont vu McDonald. Ils s’étaient faufilés dans l’aréna de Markham afin d’assister au tournage d’une capsule de Showdown, un concours de lancers de punition, qui était projetée entre les périodes durant l’émission Hockey Night in Canada. McDonald, un des participants, cassa son bâton et nos lascars réussirent à rapporter ce souvenir, étonnés par son poids.
C'était une époque de dynasties dans la LNH. Et beaucoup de membres de l’équipe des Flames, championne de la Coupe, s’imaginaient que leur formation, qui avait accumulé 117 points au classement, répéterait l’exploit encore et encore, comme les Oilers, les Islanders et les Canadiens avant elle.
Mais ce ne sera pas le cas — et, peut‐être à cause de cela ou à cause de la nature particulière des événements, ce moment demeure figé dans le temps et dans la mémoire collective des partisans de Calgary, même presque trois décennies plus tard.
En lire davantage:
Le plus grand match : D’anciens chroniques de hockey racontent les parties les plus mémorables auxquelles ils ont assisté
Un match parfait : La finale de la Coupe Stanley qui opposé dans l’année du centenaire du Canada les équipes de Toronto et de Montréal a mis un terme à des séries éliminatoires d’une ampleur mythique.
Les Jets de Winnipeg prennent leur envol : La soirée où des Jets inconnus ont triomphé des Canadiens, très connus.
Du vrai cran : une bourde prive les oilers de la coupe stanley, mais ne brise pas l'homme qui l'a faite.
Le gros bill : Une soirée mémorable à un match des Canadiens de Montréal en compagnie du bien-aimé Jean Béliveau
Pour qui résonne le métal : les malheureux Canucks voient leurs rêves de coupe anéantis.
Virage : Le match qui donné une nouvelle identité aux Sénateurs d’Ottawa et à leur capitaine de longue date
Score de guerre froide : Pour les Canadiens, le but de Paul Henderson dans les dernières secondes de la sécondes de la série Canada-URSS a été le plus grand entre tous.
Eric Duhatschek est chroniqueur sportif pour le Globe and Mail. Il a couvert les Flames de Calgary durant vingt années.
Virage

Dany Heatley et Daniel Alfredsson
Il arrive à l’occasion qu’un seul match change l’image d’une franchise et celle de son valeureux capitaine. Pour les Sénateurs d’Ottawa, ce fut la cinquième partie de la finale de la Conférence de l’Est contre les Sabres de Buffalo en 2007.
Ce qui s’est produit ce 19 mai 2007 a chassé la guigne qui s’abattait sur les Sénateurs en séries éliminatoires et contribué à élever leur capitaine, Daniel Alfredsson, alors âgé de trente‐quatre ans, au rang d’icône. Alfredsson, sur qui avaient plané des rumeurs d’échange l’automne précédent, n’aurait pu écrire une plus belle histoire de rédemption. Une année auparavant, le joueur natif de Suède avait mené l’équipe des Sénateurs vers le record pour une franchise de 113 points en saison régulière. Mais les Sénateurs devaient perdre en cinq parties en première ronde des séries contre les Sabres. Le jeu maudit : Jason Pominville des Sabres contourne Alfredsson et marque le but gagnant durant un surnombre réglementaire des Sénateurs.
Pour beaucoup de gens, l’édition 2005‐2006 des Sénateurs était la meilleure équipe d’Ottawa depuis l’octroi de la nouvelle franchise en 1992. Mais en 2006, la blessure subie par le légendaire gardien Dominik Hasek au cours des Olympiques d’hiver à Turin en Italie fragilisa l'équipe — et Buffalo sut pleinement en profiter contre le gardien substitut, Ray Emery.
La surprenante défaite fit douter certaines personnes de l’organisation des Sénateurs du leadership d’Alfredsson. Les Sénateurs avaient concédé trois séries éliminatoires à Buffalo, dont une par balayage en 1999, et aligné quatre séries perdantes — de 2000 à 2004 — contre leur ennemi, les Maple Leafs de Toronto. Aussitôt né, l’espoir était déçu.
Dans la courte histoire des Sénateurs en éliminatoires, rien n’a été plus pénible pour leurs partisans que les défaites contre les voisins ontariens. Les Leafs, avec leur étiquette historique « d’équipe originale » et l’immense couverture médiatique dont ils faisaient l’objet, triomphaient d’Ottawa de façons toujours plus exaspérantes. En 2002, les Sénateurs menaient trois victoires à deux, et 2 à 0 dans le sixième affrontement lorsque leur défenseur Ricard Persson plaqua contre les bandes le dur à cuire des Leafs, Tie Domi, lui infligeant une plaie ouverte au front. Au cours de la pénalité subséquente, les Leafs égalèrent le score, puis gagnèrent la partie et, enfin, la série.
Alfredsson, seul joueur des Sénateurs ayant participé à toutes les parties d’après‐saison de la franchise jusqu’alors, était le visage des Sénateurs qui tentaient pour la première fois de devenir une équipe compétitive. Ce visage était dès lors long et triste.
Malgré sa déception, le directeur général, John Muckler, a fait confiance à son capitaine; une décision profitable. Alfredsson, Jason Spezza au centre et Dany Heatley à gauche ont composé le trio le plus prolifique de la LNH en 2006‐2007. Affichant puissance et harmonie, le trio a dominé la ligue, chaque membre récoltant vingt‐deux points durant les séries éliminatoires. Alfredsson a été le meilleur marqueur avec quatorze buts.
Mais aucun but n’a été plus spectaculaire que celui qu’Alfredsson a marqué, son dixième des séries, dans la cinquième partie contre les Sabres, l’équipe favorite. Durant soixante minutes, les rivaux de division se sont livré un combat égal, mais quelque peu empreint de prudence. Le jeu qui survint durant la période supplémentaire pourrait être décrit intégralement par chacun des partisans des Sénateurs de ce temps : dans un affrontement un contre un, inoffensif en apparence, Alfredsson effectua sournoisement un tir bas du côté du gant du gardien Ryan Miller des Sabres qui déjoua celui‐ci.
Le banc des Sénateurs se vida, les joueurs empressés d’occuper leur place dans l’histoire du club. Quatre‐vingts années s’étaient écoulées depuis le temps où un club de hockey d’Ottawa avait atteint la finale de la coupe Stanley – en 1927, les Sénateurs d’Ottawa avaient triomphé des Bruins de Boston. Dans les années 1920, les premiers Sénateurs, avec Cy Denneny et Frank Nighbor dans leur rang, formaient une puissante équipe qui remporta quatre coupes entre 1920 et 1927. Au total, les équipes d’Ottawa ont remporté onze championnats, dont quatre consécutifs, de 1903 à 1906, grâce à Frank McGee et aux Silver Seven d’Ottawa.
La franchise avait maintenant soif d’un peu de gloire moderne.
Lorsque, cette nuit‐là, les Sénateurs sont descendus de l’avion, des milliers de partisans s’étaient massés dans le terminal des vols nolisés d’Ottawa afin d’acclamer leurs héros. Les automobiles des joueurs se sont frayé un chemin dans la foule rouge et blanche des partisans qui chantaient et prenaient des photos. Au volant de son automobile, Alfredsson tout souriant, le premier joueur européen ayant mené un club de la LNH à la finale de la coupe, saluait les partisans en leur donnant par la vitre baissée des claques sonores sur leurs mains brandies.
Bien qu’Ottawa allait perdre la finale de la coupe Stanley contre les Ducks d’Anaheim, à cet instant seul importait le fait que l’histoire avait été écrite.
En lire davantage:
Le plus grand match : D’anciens chroniques de hockey racontent les parties les plus mémorables auxquelles ils ont assisté
Un match parfait : La finale de la Coupe Stanley qui opposé dans l’année du centenaire du Canada les équipes de Toronto et de Montréal a mis un terme à des séries éliminatoires d’une ampleur mythique.
Les Jets de Winnipeg prennent leur envol : La soirée où des Jets inconnus ont triomphé des Canadiens, très connus.
Du vrai cran : une bourde prive les oilers de la coupe stanley, mais ne brise pas l'homme qui l'a faite.
Le gros bill : Une soirée mémorable à un match des Canadiens de Montréal en compagnie du bien-aimé Jean Béliveau
Le triomphe de McDonald : Fin de carrière dramatique de légendaire member du temple le la renommée des Flames
Pour qui résonne le métal : les malheureux Canucks voient leurs rêves de coupe anéantis.
Score de guerre froide : Pour les Canadiens, le but de Paul Henderson dans les dernières secondes de la sécondes de la série Canada-URSS a été le plus grand entre tous.
Wayne Scanlan couvre depuis 1987 les sports professionnels pour le quotidien Ottawa Citizen.
Le plus grand match

En 2017, la Ligue nationale de hockey célébrera son centième anniversaire d’existence. Lancée en novembre il y a cent ans, la LNH est née des cendres de la défunte Association nationale de hockey. Les équipes d’alors sont les Arenas de Toronto, les Sénateurs d’Ottawa, les Wanderers de Montréal, et une franchise québécoise, devenue l’équipe la plus racontée de l’histoire du hockey — les Canadiens de Montréal. La première partie de la LNH a eu lieu le 19 décembre. Les Bulldogs de Québec se joignent aussi à la ligue en 1917, mais ne lanceront pas d’équipe dans la mêlée avant 1919.
La route est longue de l’étang au circuit professionnel. Au cours du dernier centenaire, des dizaines de milliers de joueurs ont caressé le rêve de jouer notre sport national sur la plus grande scène du monde — la LNH.
La glace n’a pas toujours été lisse cependant. La ligue a été crée au beau milieu de la Première Guerre mondiale et en peu de temps certaines équipes ont été entravées par des difficultés financières. Au cours de la deuxième saison, la grippe espagnole a forcé l’annulation de la finale de la Coupe Stanley.
Dans les décennies subséquentes, des équipes se sont jointes à la ligue et d’autres l’ont quittée, des dynasties se sont succédé, des records ont été établis puis battus. De nouvelles ligues cherchant à supplanter la LNH sont apparues puis ont disparu à leur tour, la plus connue étant l’Association mondiale de Hockey qui a existé de 1972 à 1979. Il y a peu de temps, soit en 2008, la Ligue continentale de hockey a été fondée en Asie et en Europe. Avec ses vingt‐huit équipes, la KHL est la deuxième ligue de hockey en importance du monde.
Mais la LNH demeure l’endroit où tous les joueurs veulent jouer. Ses célèbres patineurs sont connus de tous — Wayne Gretzky, « La Merveille », Gordie Howe, « Monsieur Hockey », Maurice Richard, « La Comète », etc.
Dans les premiers temps, les partisans acclamaient leur équipe à l’aréna ou en lisaient les exploits dans les quotidiens du lendemain. L’avènement des descriptions en direct à la radio en 1923, puis de la télévision en noir et blanc en 1952, attira de nouveaux auditoires et le jeu atteignit de nouveaux sommets de popularité. L’émission Hockey Night in Canada, diffusée à partir des années 1950, devint une nouvelle religion pour beaucoup de gens, et d’un océan à l’autre, les salons se remplirent de partisans.
Mais pour quelques privilégiés, assister à des matchs le hockey était plus qu'une passion — c’était une profession. Un petit groupe de reporters sportifs relatent les exploits de nos héros sur patins depuis des décennies.
Afin de souligner le centenaire de la ligue, la Société Histoire Canada a recruté quelques‐uns des meilleurs chroniqueurs de hockey du pays et leur a posé la question toute simple suivante : « Quelle a été la partie la plus remarquable que vous avez couverte? »
Leurs réponses ont été réunies dans le cahier spécial qui suit. Certains chroniqueurs ont choisi des moments victorieux de finales de Coupe Stanley. D’autres ont relaté des souvenirs personnels de moments passés en compagnie de leur idole de jeunesse. Pour d’autres enfin, c’est d’avoir été témoins de moments de noblesse dans la défaite, alors que l’on voit émerger le véritable caractère des joueurs.
Nous espérons que ces récits sur les sept équipes professionnelles de hockey du Canada vous plairont. En prime, le plus ancien chroniqueur sportif du pays vous raconte ses souvenirs sur la plus grande équipe canadienne dans la plus formidable série entre toutes — et relate le moment où il a assisté au but le plus dramatique de l’histoire du hockey.
Les articles:
Un match parfait : La finale de la Coupe Stanley qui opposé dans l’année du centenaire du Canada les équipes de Toronto et de Montréal a mis un terme à des séries éliminatoires d’une ampleur mythique.
Les Jets de Winnipeg prennent leur envol : La soirée où des Jets inconnus ont triomphé des Canadiens, très connus.
Du vrai cran : une bourde prive les oilers de la coupe stanley, mais ne brise pas l'homme qui l'a faite.
Le gros bill : Une soirée mémorable à un match des Canadiens de Montréal en compagnie du bien-aimé Jean Béliveau.
Le triomphe de McDonald : Fin de carrière dramatique de légendaire member du temple le la renommée des Flames.
Virage : Le match qui donné une nouvelle identité aux Sénateurs d’Ottawa et à leur capitaine de longue date.
Score de guerre froide : Pour les Canadiens, le but de Paul Henderson dans les dernières secondes de la sécondes de la série Canada-URSS a été le plus grand entre tous.
Mark Reid est le rédacteur en chef du magazine Histoire Canada.
Les Jets de Winnipeg prennent leur envol
Si Tom McVie, entraîneur‐chef des Jets de Winnipeg, ne l’a pas dit une fois, il ne l’a pas répété une douzaine de fois : « Nous allons battre les Canadiens de Montréal ». C’est le serment que l’homme a fait durant les deux premiers mois et demi de l’existence de son club dans la Ligue nationale de hockey. « Le hic c’est que je ne sais pas quand. »
Ceux d’entre nous qui ont suivi les tribulations quotidiennes des Jets, à la maison ou sur la route, au cours de leur croisade de 1979‐1980, ravalaient leur envie de ricaner au mantra de McVie car cet amoureux inconditionnel du hockey et joyeux drille qui nous régalait avec ses anecdotes hilarantes de son temps était vraiment apprécié de tous. Pourtant, aussi louable que fût sa croyance envers sa troupe au talent dilué, la pensée que les Jets pourraient renverser les « Habs », champions en titre de la Coupe Stanley, faisait rire.
Soyons sérieux, l’alignement des « Glorieux » était composé du gratin des joueurs de hockey, celui des Jets, d’inconnus. Quiconque savait distinguer une rondelle d’un fromage pourrait affirmer que, même dans leur pire moment, les Guy Lafleur, Steve Shutt, Bob Gain¬ey, Larry Robinson, Serge Savard, Guy Lapointe, et al., lessiveraient en bleu, blanc et rouge les vaillants Jets tels que les Lorne Stamler, Barry Melrose, Jimmy Mann, Mike Amodeo ou Ross Cory.
Aucun doute n’est permis, les Canadiens avaient renforcé leur supériorité en novembre en infligeant une correction de 7 à 0 aux Jets en visite au Forum de Montréal. Toutefois, l’entraîneur McVie inébranlable malgré l’humiliation, répéta son incantation : « Nous allons battre les Canadiens de Montréal », comme si quelconque magie opérerait un jour. « Le hic c’est que je ne sais pas quand. »
Sautons au 15 décembre 1979, un samedi soir où les caméras de l’émission Hockey Night in Canada entraient pour la première fois dans l’aréna de Winnipeg. Beaucoup de balivernes étaient débitées à propos de l’hystérie entourant les « Habs ». Les gourous du marketing imaginèrent que ce serait un coup sensationnel de transformer l’occasion en à soirée du smoking ». On encouragea donc les spectateurs à revêtir des habits de pingouins. Le personnel du Mallabar, un magasin de la ville spécialisé dans la vente et la location de tenues de soirée, a vu 1 500 smoks disparaître en moins de temps qu’il faut pour dire « Giorgio Armani. »
Membres de l’état‐major, entraîneurs, personnel de soutien, chauffeur de Zamboni et bon nombre des 15 723 spectateurs, tout ce beau monde était tiré à quatre épingles.
Les Jets, par contre, étaient un groupe très hétéroclite. À cause des mesures restrictives prévues dans l’entente ratifiant l’admission dans la LNH des Jets et de trois autres équipes de la défunte Association mondiale de Hockey, le groupe qui a affronté les Habs ce 15 décembre, avait très peu de points communs avec celui qui avait remporté le dernier titre de l’AMH le printemps précédent. Il lui manquait des éléments clés tels que Terry Ruskowski, Rich Preston, Barry Long, le dur à cuire Kim Clackson et le très talentueux Kent Nilsson.
Brillait aussi par son absence, le franc‐tireur Bobby Hull, qui, s’étant trompé sur l’heure de la partie, sirotait une tasse de thé chez lui alors qu’il aurait dû être sur la patinoire à s’échauffer avant la partie. M. Hull, alerté par un coup de téléphone, se présenta à l’aréna, mais vu son retard, l’entraîneur McVie raya son nom de l’alignement. Lorsque le directeur général John Ferguson fut mis au courant de l’imbroglio, il défonça d’un coup de pied rageur la porte du bureau de l’entraîneur. McVie refusa de changer sa décision. La règle c’est la règle. Hull, le légendaire ailier gauche, quitta les lieux et ne fut plus jamais revu dans l’uniforme des Jets.
Quoiqu’il en soit, Winnipeg s’en tira fort bien sans lui ce soir-là.
Les Jets déculottèrent les « Flying Frenchmen ». Willy Lindstrom marqua trois buts et Peter Sullivan, un but et trois aides.
Ron Wilson et Morris Lukowich enfilèrent chacun un but. Les Jets triomphèrent des Canadiens par la marque de 6 à 2 en effectuant 48 tirs contre 19 (le tableau indiquait 22 tirs contre 4 dans la deuxième période).
À la fin de la partie, je me suis précipitée au sous‐sol du vieux bâtiment agricole du chemin Maroons de Winnipeg afin de recueillir les perles de McVie. « Je vous l’avais dit que nous battrions les Canadiens de Montréal », dit‐il tout souriant. « Oui en effet Tom », ai‐je répondu. « En passant, t’es formidable dans un smok. »
« Pas mal chic, hein? », répondit‐il moqueur. « J’ai promis de retourner le smok avant minuit sinon on me chargera un extra. Je ne peux pas me le permettre et Fergy est trop radin pour payer la pénalité. »
La morale de cette histoire? La victoire contre les Canadiens a été inestimable, mais apparemment pas à n’importe quel coût.
En lire davantage:
Le plus grand match : D’anciens chroniques de hockey racontent les parties les plus mémorables auxquelles ils ont assisté
Un Match Parfait : La finale de la Coupe Stanley qui a oppose dans l’année du centenaire du Canada les équipes de Toronto et de Montréal a mis un terme à des séries éliminations d’une ampleur mythique
Du vrai cran : une bourde prive les oilers de la coupe stanley, mais ne brise pas l'homme qui l'a faite.
Le gros bill : Une soirée mémorable à un match des Canadiens de Montréal en compagnie du bien-aimé Jean Béliveau
Le triomphe de McDonald : Fin de carrière dramatique de légendaire member du temple le la renommée des Flames
Pour qui résonne le métal : les malheureux Canucks voient leurs rêves de coupe anéantis.
Virage : Le match qui donné une nouvelle identité aux Sénateurs d’Ottawa et à leur capitaine de longue date
Score de guerre froide : Pour les Canadiens, le but de Paul Henderson dans les dernières secondes de la sécondes de la série Canada-URSS a été le plus grand entre tous.
Patti Dawn Swansson a couvert les activités des Jets pour le Winnipeg Sun et le Winnipeg Tribune qui n’est plus publié.
Score de guerre froide pour les Canadiens

Témoins de la scène, plusieurs joueurs d’Équipe Canada accourent afin de sortir Eagleson de sa position fâcheuse. Ils lui font enjamber les bandes puis l’escortent vers le banc canadien de l’autre côté de la patinoire.
Une série de huit parties opposant des joueurs professionnels de la Ligue nationale de hockey aux joueurs « amateurs »» de l’Union soviétique s’est mise en branle le 2 septembre 1972 à Montréal. Vingt‐sept jours plus tard, les équipes présentes dans le vétuste Palais des sports de Loujniki — avec un dossier identique de trois victoires, trois défaites et un match nul — s’apprêtent à croiser le fer dans une ultime confrontation de guerre froide sur glace.
Équipe Canada doit remporter deux parties de suite à Moscou pour jouer le 28 septembre la huitième partie décisive. Trois mille Canadiens se sont envolés vers Moscou afin d’assister aux quatre dernières parties de la série. Des millions d’autres verront à la télévision Paul Henderson compter un but dans la dernière minute de jeu et mettre un terme à une remontée victorieuse de 6 à 5.
J’ignore ce que vous avez fait une fois la série terminée — ou comment vous vous sentiez —, mais il fallait être sur place pour vraiment saisir le moment. L’émotion ne pouvait être plus à son comble.
On a vu les joueurs d’Équipe Canada quitter la patinoire, index pointés au ciel, et les partisans canadiens — un très grand nombre en larmes — entonner avec émotion l’« Ô Canada » On a vu Ken Dryden, le gardien de but, traverser à fond de train la patinoire et se jeter sur la masse de coéquipiers qui enserrait Henderson dans une touchante manifestation d’amour.
L’expression la plus souvent répétée après cette remontée classique a été « off the floor ». « We came off the floor » (Nous avons plané), a dit l’entraÎneur‐adjoint John Ferguson. L’expression résonne toujours aujourd’hui.
Les Soviétiques bénéficient d’une avance de deux buts au début de la troisième période, mais semblent abasourdis lorsque Phil Esposito porte la marque à 5 à 4 en marquant son deuxième but.
Puis il y a une mêlée devant le but des Soviétiques. À la treizième minute, Yvan Cournoyer marque un des plus gros buts de sa carrière — mais la lumière rouge ne s’allume pas. L’arbitre a levé le bras pour signaler le but, mais le geste n’est pas vu par tous. Alan Eagleson, le directeur général de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, est furieux car il craint que le but soit refusé.
M. Eagleson se précipite vers la patinoire depuis son siège dans les estrades, mais se heurte à un mur de policiers russes. Repoussé par un agent, il le bouscule à son tour. En un instant une demi‐douzaine de policiers l’empoignent et l’entraînent, qui en poussant, qui en tirant, vers la sortie la plus proche.
Témoins de la scène, plusieurs joueurs d’Équipe Canada accourent afin de sortir Eagleson de sa position fâcheuse. Ils lui font enjamber les bandes puis l’escortent vers le banc canadien de l’autre côté de la patinoire. C’est à ce moment que les portes à chaque extrémité de l’aréna s’ouvrent pour laisser entrer des dizaines de policiers, fusils en bandoulière. En quelques minutes, les policiers forment autour de tout le groupe un cordon serré, menaçant.
Rien n’a permis de savoir si l’incident a eu un effet sur les joueurs, mais, à mon avis, ce fut le cas. Après avoir pioché durant deux périodes pour demeurer en vie, après avoir entamé la troisième période en recul de deux buts, Équipe Canada a trouvé l’inspiration nécessaire pour jouer comme jamais auparavant.
Henderson a compté le but gagnant dans la sixième et la septième parties. Dans la dernière minute, il se retrouve devant le gardien soviétique, Vladislav Tretiak. Il lance la rondelle ... qui lui revient dans un rebond. Il la reprend et lance de nouveau. La lumière ne s’est pas encore allumée que déjà les joueurs lèvent leurs bâtons dans les airs. Dryden traverse la patinoire et les joueurs sautent par‐dessus les bandes. Dans les estrades, les Canadiens se lèvent et se regardent incrédules. Les gens qui ne se connaissent pas se jettent dans les bras les uns des autres dans une mer de drapeaux rouges canadiens. L’ultime partie de la série du siècle n’a pas été la plus belle partie entre toutes. Les émotions étaient fortes et les coudes portés haut durant tout le match. À un certain moment, des joueurs canadiens ont lancé des chaises sur la patinoire en guise de protestation contre une pénalité, et les spectateurs canadiens se sont levés et mis à scander : « Let’s go home! Let’s go home! » (Rentrons à la maison).
Alors, pourquoi cette victoire est‐elle si particulière?
À cette époque, presque vingt ans s’étaient écoulés depuis mes débuts comme chroniqueur des grandes compétitions sportives. J’ai toujours évité de manifester mes préférences — encore aujourd’hui d’ailleurs. Une équipe gagne, une équipe perd; le hockey n’est qu’un jeu. Mais je dois avouer que j’ai bondi sur mes pieds comme le reste des Canadiens à la suite du but de Henderson. Mes cris perçants se sont mêlés aux leurs. Les Canadiens qui étaient sur place, et les autres, se souviennent encore de ce but comme le plus formidable entre tous.
En lire davantage:
Le plus grand match : D’anciens chroniques de hockey racontent les parties les plus mémorables auxquelles ils ont assisté
Un match parfait : La finale de la Coupe Stanley qui opposé dans l’année du centenaire du Canada les équipes de Toronto et de Montréal a mis un terme à des séries éliminatoires d’une ampleur mythique.
Les Jets de Winnipeg prennent leur envol : La soirée où des Jets inconnus ont triomphé des Canadiens, très connus.
Du vrai cran : une bourde prive les oilers de la coupe stanley, mais ne brise pas l'homme qui l'a faite.
Le gros bill : Une soirée mémorable à un match des Canadiens de Montréal en compagnie du bien-aimé Jean Béliveau
Pour qui résonne le métal : les malheureux Canucks voient leurs rêves de coupe anéantis.
Le triomphe de McDonald : Fin de carrière dramatique de légendaire member du temple le la renommée des Flames
Virage : Le match qui donné une nouvelle identité aux Sénateurs d’Ottawa et à leur capitaine de longue date
Le chroniqueur sportif à la retraite du quotidien Montreal Gazette Red Fisher a commencé à couvrir le hockey en 1954.
Du vrai cran

Le défenseur recrue des Oilers, Steve Smith, le soir du 30 avril 1986, quand — oh non! — il a marqué dans son propre but. Le jour de son anniversaire, en plus!
Peu de dynasties dans la LNH n’ont été plus craintes et admirées que celle de l’équipe bourrée de vedettes des Oilers d’Edmonton au milieu des années 1980. Tout y était : du talent immense grâce en premier lieu à l’incomparable Wayne Gretzky (dans les statistiques, le plus prolifique attaquant dans l’histoire du hockey), de superbes joueurs secondaires et un brillant motivateur, Glen (Slats) Sather, derrière le banc. Ce groupe a remporté quatre titres de champions de la Coupe Stanley au cours de cinq saisons à couper le souffle.
Rien d’étonnant alors que la partie la plus excitante et mémorable que les Oilers joueraient devait assurément être une de leurs victoires décisives pour la coupe ou le théâtre d’une des prestations, parmi tant d’autres, de Gretzky, fracassant un record.
C’était peut‐être vrai pour les gens, mais pas pour moi, bien que j’ai assisté à quelques‐uns des moments les plus formidables de l’histoire des Oilers. Pour moi, la partie la plus mémorable de ce groupe n’est pas de celles où une coupe a été gagnée, des records ont été battus ou des prestations ont été exceptionnelles. Tout le contraire. C’est la partie où s’est produite la plus grosse bourde de l’histoire des sports dont le responsable a su par la suite effacer la marque et se relever.
On ne compte plus les bévues, les gaffes et les bons vieux jeux stupides qui surviennent dans les sports année après année. Le côté sombre des sports est que malgré l’énorme talent des athlètes professionnels, l’un d’eux, un jour ou l’autre, va merder, et pas à peu près — souvent à un moment crucial. C’est exactement ce qu’a fait le défenseur recrue des Oilers, Steve Smith, le soir du 30 avril 1986, quand — oh non! — il a marqué dans son propre but. Le jour de son anniversaire, en plus!
La bourde de Smith a été amplifiée par le fait qu’elle est survenue contre les grands rivaux des Oilers, les Flames de Calgary. Et dans la septième partie des éliminatoires de la division Smythe, au Northlands Coliseum d’Edmonton, devant une foule bruyante de supporters des Oilers. Y a pas de meilleur moment ni endroit ! Le film de l’erreur colossale reste bien précis dans la mémoire. Je suis assis directement derrière le filet des Oilers, dans les hauteurs du Northlands. Voilà Smith qui arrête la rondelle derrière le filet. Il cherche un attaquant devant à qui faire une passe. Il s’exécute ... malheur! ..la rondelle heurte l’arrière de la jambe gauche du gardien Grant Fuhr et bondit dans le filet. Cette brève perte de concentration coûtera très cher au Oilers. Le but survient au début de la troisième période d’une partie chaudement disputée alors que le score est égal. Ce sera le but gagnant pour la partie, et pour la série. Les Oilers sont incapables de revenir dans le match malgré leur offensive fulgurante. Là s’arrête le parcours des Oilers vers une troisième coupe. Ils rebondiront pourtant par la suite et remporteront les deux championnats de la coupe suivants.
Après avoir réalisé ce qu’il vient de faire, Smith s’écroule comme si on lui avait tiré dessus. Ébranlé, il s’enfouit le visage dans les gants; la foule murmurante partage sa douleur et son humiliation. À la fin de la partie, Smith affiche un visage rongé par la tristesse durant les poignées de mains avec les adversaires. Il retraite rapidement vers le vestiaire où, comme la meute des journalistes s’y attend, il disparaît afin de ne pas affronter plumes et microphones.
Mais ce qui survient par la suite est remarquable. Alors que beaucoup de ses coéquipiers se sont retirés dans les douches ou leurs quartiers privés dans le vestiaire, Smith s'assoit devant son casier, prêt à faire face à la musique. Les yeux pleins de larmes, il répond à chacune de nos questions.
Il faut du courage pour faire ça. Il a assumé l’erreur bien qu’une partie du blâme revenait à Fuhr, le gardien. Bon nombre d’erreurs de ce type peuvent détruire un athlète. Celle de Smith a été si énorme qu’elle lui a collé à la peau comme un anatife le reste de sa carrière. La vidéo du but est toujours accessible après toutes ces années sur YouTube.
Le fait que la carrière de Smith n’a pas complètement été ruinée témoigne de la force de caractère de l’homme. Il a connu une superbe carrière dans la LNH.
Smith n’a pas oublié cette gaffe aujourd’hui. « Si j’imaginais un instant que les gens cesseraient de se souvenir », dit‐il à un journaliste du Edmonton Sun, il y a quelques années, « Ce serait bien fou de ma part ».
Ce fut une partie exceptionnelle, marquée par une erreur unique faite par un homme qui l’a assumée, mais qui a refusé de la laisser le détruire.
Les articles:
Le plus grand match : D’anciens chroniques de hockey racontent les parties les plus mémorables auxquelles ils ont assisté
Un match parfait : La finale de la Coupe Stanley qui opposé dans l’année du centenaire du Canada les équipes de Toronto et de Montréal a mis un terme à des séries éliminatoires d’une ampleur mythique.
Les Jets de Winnipeg prennent leur envol : La soirée où des Jets inconnus ont triomphé des Canadiens, très connus.
Le gros bill : Une soirée mémorable à un match des Canadiens de Montréal en compagnie du bien-aimé Jean Béliveau.
Le triomphe de McDonald : Fin de carrière dramatique de légendaire member du temple le la renommée des Flames.
Pour qui résonne le métal : les malheureux Canucks voient leurs rêves de coupe anéantis.
Virage : Le match qui donné une nouvelle identité aux Sénateurs d’Ottawa et à leur capitaine de longue date.
Score de guerre froide : Pour les Canadiens, le but de Paul Henderson dans les dernières secondes de la sécondes de la série Canada-URSS a été le plus grand entre tous.
Dave Komosky a couvert les Oilers d’Edmonton dans les 1980 à titre de billettiste pour le Saskatoon Star‐Phoenix.
Pour qui résonne le métal

Si le tir de LaFayette avait pénétré dans le but et si son équipe avait soulevé la Coupe Stanley ce soir-là, ce but aurait été le plus gros but de l’histoire de la franchise.
Si vous googlez Nathan LaFayette sur Internet, vous obtiendrez, entre autres suggestions, une référence au tir du joueur qui s’écrase sur un poteau de but. Le 14 juin 1994, le mot « poteau » et le nom Lafayette deviennent indissociables.
Il est difficile de trouver un moment qui synthétiserait la quête infructueuse, longue de quarante-six années et plus, des Canucks de Vancouver pour la Coupe Stanley, mais le tir à bout portant de LaFayette qui a fait résonner le métal dans la septième partie de la finale contre les Rangers de New York est un bon choix. Pour une franchise, encore de nos jours reconnue pour ses échecs malgré plusieurs périodes d’excellence au cours des vingt-six dernières ann^ées, les Canucks ont réussi à accumuler quelques belles victoires.
La sixième partie contre les Rangers en 1994 — remportée 4 à 1 par les Canucks trois jours avant la défaite de 2 à 3 à Manhattan dans la série finale — est considérée par beaucoup de partisans des Canucks comme la plus grande partie qui a été jouée à Vancouver — du moins depuis 1915, année où les Millionaires de Vancouver remportèrent la Coupe.
Dans le parcours des Canucks vers la finale de 2011, alors que l’équipe est à ce moment la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey jusqu’à ce qu’elle échoue à deux reprises de gagner une partie contre les Bruins de Boston pour la Coupe Stanley, Vancouver a survécu à la première ronde en vainquant les Blackhawks de Chicago grâce au but spectaculaire d’Alex Burrows durant la période supplémentaire de la septième partie.
Il y a aussi le sensationnel but gagnant de Pavel Bure au cours de la supplémentaire de la septième partie en première ronde de 1994 qui a couronné une salutaire remontée contre les Flames de Calgary et contribué à donner une nouvelle image à une franchise qui jusqu’alors et pour l’essentiel se résumait à une ligne d'attaque.
Pourtant, pour un club qui affiche un dossier de 0-3 dans les finales, la plus grande partie dans l’histoire de la franchise devrait être à juste titre une défaite. Et puisque l’improbable parcours dans les séries éliminatoires de 1982 d’une équipe des Canucks moyenne n’a été en réalitEé qu’un heureux coup du hasard, et que l’effondrement de 2011 n’a rien eu de noble, tout ce qui nous reste est cette mémorable finale de 1994 contre les Rangers.
Personne à Vancouver ne peut penser à cela sans se rappeler, non sans quelque effroi après toutes ces années, le fatal tir sur réception de LaFayette alors qu’il ne reste que six minutes dans la partie, la septième, et que les Canucks sont menés par un but. Trevor Linden, le plus grand joueur des Canucks, qui offrira une de ses plus belles prestations ce soir-là, se souvient de l’escouade de policiers qui ont escorté l’équipe jusqu’au Madison Square Garden. Quant à nous, nous nous souvenons de la chaleur et de l’humidité suffocantes de cette journée-là et de l’incroyable tension qui règne à l’intérieur de l’aréna parce que les New-yorkais craignent que les Canucks privent les Rangers de leur première Coupe Stanley depuis cinquante-quatre ans.
Non seulement ce match met-il un terme à une finale enlevée de la Coupe Stanley, il marque aussi la fin d’une époque pour la LNH alors que durant la décennie qui suivra, le hockey n’offrira qu’un style de jeu qui privilégie le marquage en zone neutre et la défensive. Dans la finale de 1994, le jeu a été excitant et axé sur l’attaque.
Dans la septième partie, les Rangers prennent à deux reprises deux buts d’avance, mais chaque fois Linden compte et réduit l’écart à un but. Les gens oublient que Murray Craven a failli égaler le score en faisant dévier un tir, tard dans la partie, et que Marty Gelinas aurait pu porter le score à 3-3 si son tir ne s’était pas arrêté sur l’extérieur du but après avoir déjoué le gardien Mike Richter des Rangers. Les gens oublient parce que, quelques minutes plus tard, LaFayette a projeté la rondelle sur le poteau à la gauche de Richter après une magnifique passe de Geoff Courtnall.
Ce manqué de peu a marqué non seulement les Canucks de Vancouver, mais aussi le malheureux LaFayette, qui jeune recrue de vingt-un ans, était passé des Blues de St. Louis aux Canucks de Vancouver ce printemps-là par la voie d’un échange. Joueur rapide et dur à la tâche, mais au talent limité, LaFayette n’a joué que 187 parties dans la LNH. Il met fin à sa carrière en 2000 et décroche un poste dans la direction d’une compagnie d’assurance.
« Lorsque quelqu’un me montre du doigt, ça me laisse froid parce que j’ai aussi réussi de bons coups dans ces séries éliminatoires », LaFayette a déclaré plusieurs années plus tard à un journaliste du Globe and Mail qui lui avait demandé quel était son moment marquant. « C’est le sport professionnel. C’est ton rendement qui te définit aux yeux du public.»
Si le tir de LaFayette avait pénétré dans le but et si son équipe avait soulevé la Coupe Stanley ce soir-là, ce but aurait été le plus gros but de l’histoire de la franchise.
Au lieu de cela : bing! Le glas a sonné, comme toujours, pour les Canucks de Vancouver.
En lire davantage:
Le plus grand match : D’anciens chroniques de hockey racontent les parties les plus mémorables auxquelles ils ont assisté
Un match parfait : La finale de la Coupe Stanley qui opposé dans l’année du centenaire du Canada les équipes de Toronto et de Montréal a mis un terme à des séries éliminatoires d’une ampleur mythique.
Les Jets de Winnipeg prennent leur envol : La soirée où des Jets inconnus ont triomphé des Canadiens, très connus.
Du vrai cran : une bourde prive les oilers de la coupe stanley, mais ne brise pas l'homme qui l'a faite.
Le gros bill : Une soirée mémorable à un match des Canadiens de Montréal en compagnie du bien-aimé Jean Béliveau
Le triomphe de McDonald : Fin de carrière dramatique de légendaire member du temple le la renommée des Flames
Virage : Le match qui donné une nouvelle identité aux Sénateurs d’Ottawa et à leur capitaine de longue date
Score de guerre froide : Pour les Canadiens, le but de Paul Henderson dans les dernières secondes de la sécondes de la série Canada-URSS a été le plus grand entre tous.
Iain MacIntyre est billettiste pour le Vancouver Sun. Il couvre les activités des Canucks depuis 1991.
La sorcellerie en Nouvelle-France

Charles Vinh / Sleeman Unibroue
Dans les années 1660, la Nouvelle-France était un lieu terrifiant. Sa population réduite de 3 200 colons français vivait dans la terreur constante des raids menés par les impitoyables Iroquois. Les missionnaires jésuites étaient capturés, torturés et finalement tués. Des épidémies foudroyantes sévissaient. Et l’avenir semblait promettre, partout, une suite sans fin de calamités.
« Le séisme de l’hiver dernier, à Montréal, fit trembler les colons, qui anticipaient les malheurs qu’annonçait ce funeste présage », peut-on lire dans l’édition de 1660-1661 des Relations des jésuites. Les lamentations que l’on entendait dans les rues de Trois-Rivières étaient peut-être bien l’écho des pauvres captifs emportés par les Iroquois et les canots en flammes qui semblaient voler dans les airs, autour de Québec, n’étaient qu’un faible présage de l’arrivée des canots ennemis ».
Vers la même époque, la sœur ursuline Marie de l’Incarnation décrit également des voix étranges semblant flotter dans les airs et des canots en feu volant dans le ciel, ainsi que d’autres phénomènes inexpliqués. « En outre, écrit-elle dans une lettre à son fils, on a découvert qu’il y avait des sorciers et des magiciens dans ce pays. »
Marie de l’Incarnation constata que ces événements étranges commencèrent à se manifester après l’arrivée en 1660 d’un navire transportant des colons. Parmi les passagers se trouvaient Barbe Hallé (aussi connue sous le nom de Halé, Hallay ou Haly), âgée de 16 ans, et un homme nommé Daniel Vuil, un français né protestant qui s’était apparemment converti au catholicisme lors du voyage.
Selon Marie de l’Incarnation, pendant le voyage, Vuil tenta de séduire Hall^é, qui repoussa ses avances. Vuil, après s’être installé à Beauport, près de Québec, reprit sa profession de meunier et Hallé se fit servante dans un manoir.
En décembre de cette même année, les habitants du manoir furent témoins d’étranges phénomènes. Selon le missionnaire jésuite, Paul Ragueneau, « la maison de la fille était si infestée que des pierres y volaient en tout sens, lancées par des mains invisibles, ne touchant personne, même si une vingtaine de personnes s’y trouvaient, avec un bruit et une force tels qu’on les aurait dit lancées par un bras tout puissant ». La jeune servante eût bientôt des visions démoniaques : « Seule la fille possédée voyait des démons qui lui apparaissaient sous les formes d’hommes, de femmes, d’enfants, de bêtes et de spectres infernaux, et qui parlaient par sa bouche … sans cependant user de sa voix », écrit Ragueneau.
Les habitants crurent dans un premier temps que la maison était hantée. Hallé changea d’employeur, mais rien n’y fit. L’affaire fut portée à l’attention de François de Laval, l’évêque de la Nouvelle-France, qui ordonna un exorcisme. Le prêtre local ne parvint pas à expulser les démons et Laval tenta alors lui-même de les exorciser. Ce fut également un échec. Les pierres continuaient de voler dans la maison.
On envoya finalement Hallé à l’hôpital de la colonie, l’Hôtel-Dieu de Québec, relevant d’un couvent où œuvrait Catherine de Saint-Augustin. Mère Catherine en savait long sur les démons. Reconnue comme la femme la plus pieuse de la Nouvelle-France, elle était soi-disant « obsédée par le diable » depuis les années 1650. L’obsession, par opposition à la possession, signifiait qu’elle était victime d’attaques des démons, mais parvenait à conserver le contrôle de sa personne.
Selon Ragueneau, « divers personnages lui apparaissaient, soit pour la tromper, soit pour lui faire peur; parfois ils secouaient son lit pendant la nuit et d’autres fois, ils détournaient à leur usage sa langue ou d’autres parties de son corps pour l’empêcher de prier à voix haute, de se confesser, de recevoir la communion, de prendre l’eau bénite ou de faire le signe de la croix ».
En tentant de guérir Hallé, Catherine de Saint-Augustin provoqua la colère des esprits mauvais qui hantaient la jeune fille. « Ces démons en furie, incapables de l’intimider avec leurs menaces, tentèrent de surprendre [de Saint-Augustin] en se transformant en anges de lumière, pour mieux la tromper », poursuit Ragueneau.
Pendant ce temps, les autorités de la colonie en vinrent à la conclusion que les démons de Hallé lui venaient de son compagnon de voyage, Daniel Vuil, qui avait tenté de la séduire. En effet, la fille affirma qu’elle avait des apparitions de ce dernier. Même si personne ne pouvait voir son spectre, sauf Hallé, Vuil fut tout de même arrêté.
Selon Marie de l’Incarnation, l’homme était un magicien. Comme la jeune fille s’était refusée à lui, Vuil décida « de parvenir à ses fins en usant de son art diabolique », écrit-elle. La sorcellerie n’était pas le seul motif justifiant l’arrestation de Vuil. L’évêque Laval qui était du voyage, à bord du même navire que Vuil et Hallé, était convaincu d’avoir converti Vuil au catholicisme pendant la traversée. Et pourtant, une fois arrivé au Canada, on découvrit que Vuil était resté huguenot. Aux yeux de l’Église catholique, cela faisait de lui un « relaps », une infraction grave justifiant la mort en cette époque d’intolérance religieuse.
En outre, on accusait Vuil de vendre de l’alcool aux Indiens. Cela contrevenait à un édit récemment adopté par le gouverneur et appliqué avec poigne par l’évêque Laval, qui excommuniait tous ceux qui s’adonnaient à ce trafic.
Protestant, accusé d’être un relaps, trafiquant d’alcool et sorcier … les perspectives de Daniel Vuil s’annonçaient plutôt sombres.
Vuil fut « arquebusé » (fusillé) le 7 octobre 1661 à Québec. En l’absence de documents relatifs à son procès, le motif exact de son exécution demeure trouble et un sujet de débat pour les historiens. La punition habituelle pour sorcellerie en Nouvelle-France était le bannissement, et non la mort. Selon l’historien André Vachon, il aurait été exécuté pour avoir vendu de l’alcool aux Autochtones. À l’époque, la colonie s’adonnait au commerce avec les Algonquins, les Montagnais, les Hurons et d’autres groupes. D’autres prétendent que le trafic d’alcool n’était pas à l’époque une infraction justifiant la mort, mais les crimes religieux, comme le blasphème et la profanation, l’étaient. Selon l’historien Vincent Grégoire, il fut sans doute fusillé pour être retourné à sa foi protestante apr^ès sa soi-disant conversion au catholicisme par l’évêque Laval. Quoi qu’il en soit, il ne fut pas enterré dans un cimetière catholique et son lieu de sépulture exact reste inconnu.
Après la mort de Vuil, Hallé continua d’être hantée par des démons pendant un certain temps. Enfin, en 1662, Catherine de Saint-Augustin trouva une nouvelle façon de protéger la jeune fille des attaques des démons : elle la fit coudre dans un sac. Cette technique, aux fondements qui restent obscurs encore à ce jour, combinée à l’intercession prétendument miraculeuse de l’esprit du martyre jésuite, Jean de Brébeuf, semble avoir fonctionné. Hallé finit par recouvrer la santé.
Elle quitta le couvent et mena une vie normale, épousant Jean Carrier en 1670. Elle mourut en 1696, à l’âge respectable de 52 ans.
L’incident impliquant Vuil et Hallé est relativement rare en Nouvelle-France. Trois décennies plus tôt, en Nouvelle-Angleterre, l’hystérie provoquée par la sorcellerie atteint son point culminant lors des procès de Salem, en 1692. En tout, deux cents personnes, pour la plupart des femmes, subirent un procès à Salem, au Massachusetts, et vingt furent exécutées.
La chasse aux sorcières n’atteint jamais cette ampleur en Nouvelle-France. Les cas impliquant des citoyens acoquinés avec le diable sont rares et espacés. On rapporte cependant l’affaire de l’aubergiste de Montréal, Anne Lamarque, qui fut officiellement accusée de sorcellerie en 1682. Des témoins affirmèrent qu’elle possédait un livre de magie et de sortilèges. Pour sa défense, Lamarque expliqua qu’il s’agissait d’un traité d’herboristerie. Protégée par des amis haut placés, elle fut acquittée, évitant de peu le bannissement.
En Nouvelle-France, où les hommes étaient beaucoup plus nombreux que les femmes, on compte plus d’un cas où un homme fut accusé de jeter un sort à une femme qui refusa sa demande en mariage.
En 1657, René Besnard dit Bourjoly fut accusé de jeter un sort de stérilité à la femme qui refusa sa demande et à son mari. Le couple ne pouvait pas avoir d’enfants et leur mariage fut annulé pour des motifs « d’impuissance perpétuelle causée la magie ». Bourjoly fut finalement banni de la colonie.
En ce qui concerne Catherine de Saint-Augustin, sa santé périclita et elle aurait été assiégée par des démons jusqu’à sa mort, en 1668. Après sa mort, Ragueneau publia sa biographie, rendant publique la lutte de cette sainte femme contre les démons. Cependant, la réaction de l’Église demeura tiède. Ce genre de mysticisme n’était plus au goût du jour, grâce en partie à la pensée rationnelle, influencée par le philosophe René Descartes et d’autres, qui commençait à bouleverser l’Europe.
En 1682, une ordonnance royale française établit les bases de la décriminalisation de la sorcellerie; on y faisait mention à de « prétendus sorciers », que l’on qualifiait plutôt de blasphémateurs et de charlatans, sans jamais évoquer leurs pouvoirs surnaturels. La dernière sorcière fut exécutée en France en 1718.
Dans le monde occidental, la folie de la chasse aux sorcières, qui avait fait des milliers de victimes depuis le début des années 1500, tirait à sa fin. Même l’affaire de Salem, en 1692, est survenue assez tard dans l’histoire. La Nouvelle-France fut relativement épargnée, mais pas entièrement, comme le montre l’affaire de Barbe Hallé et de Daniel Vuil.
Des canots volants
Dès les débuts de la colonie en Nouvelle-France, les histoires de canots enchantés traversant les airs faisaient partie du folklore. Elles prennent leur origine dans une légende autochtone sur un canot volant et un conte populaire français dans lequel un chasseur est condamné à être poursuivi pour l’éternité dans le ciel nocturne pour avoir chassé un dimanche, pendant la grande messe.
Au fil du temps, les coureurs des bois et les voyageurs, souffrant du mal du pays, adaptèrent le conte à leur situation. On connaît bien la version de la « Chasse-galerie », écrite par Honoré Beaugrand en 1892. Dans cette histoire, des bûcherons font un pacte avec le diable pour revenir en toute hâte à la maison fêter le Nouvel An avec leur douce. Par contre, s’ils prononcent le nom de Dieu ou touchent un clocher d’église, le diable s’emparera de leur âme.
Les hommes arrivent à la maison et font la fête, dansant toute la nuit. Le lendemain matin, alors qu’ils retournent au chantier à bord de leur canot magique, le navigateur ivre évite de peu un clocher d’église et lance un sacre. Craignant de perdre leur âme, les bûcherons ligotent le navigateur, mais le canot s’écrase dans un arbre et ses occupants sont assommés d’un coup. Ils finissent par se réveiller dans leur lit, indemnes.
Aujourd’hui, l’histoire est évoquée sur l’étiquette d’une bière forte du Québec. La Maudite de la compagnie Unibroue a été lancée en 1992. La brasserie a utilisé l’image de la « Chasse-galerie » pour traduire l’idée d’un pacte avec le diable, puisqu’il s’agissait de la première bière forte (huit pour cent d’alcool) à être vendue dans les supermarchés du Québec.
Voyage au Canada dans les années 1806, 1807 et 1808
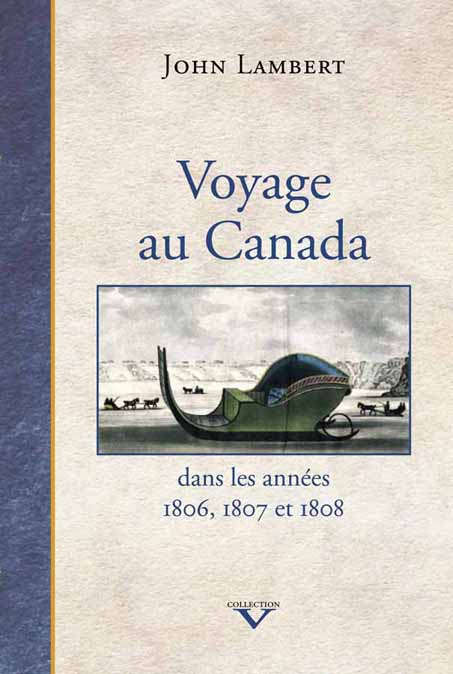
John Lambert. Voyage au Canada dans les années 1806, 1807 et 1808. Québec, Les Éditions du Septentrion, 2006. 360 pages.
Depuis belle lurette, les Travels de John Lambert sont devenus des ouvrages de collection. Les gravures se transigent à prix d'or, surtout celle de la carriole; son texte est constamment cité par les historiens anglophones et francophones et pourtant il n'existait pas, jusqu'à aujourd'hui, de traduction française.
Militaire de formation et artiste dans l'âme, Lambert s'était bien préparé à son voyage en Amérique. Le fier Britannique voulait voir comment les uns assumaient leur indépendance et comment les autres vivaient leur conquête. « Les Canadiens français constituent un peuple tranquille et inoffensif, constate-t-il. Ils se contentent de peu. […] Ils apprécient les valeurs et les avantages du gouvernement sous lequel ils vivent. Auparavant pauvres et opprimés, ils ont accédé, depuis la conquête, à une vie aisée et indépendante. » John Lambert sait bien qu'il y a deux côtés à une médaille. Ce n'est jamais tout à fait blanc ou noir.
Tout l'intéresse. Il a bien son petit bagage de préjugés, particulièrement sur la religion, et il ne manque pas de surprendre. Il dit ce qu'il pense et ce qu'il voit. Bien sûr, Lambert aborde les Canadiens de haut, ce qui ne l'empêche pas de les trouver sympathiques. Ils sont polis, se querellent rarement, « excepté quand ils sont ivres ». « Ils sont d'un naturel joyeux, paisible et amical ». Il décrit le pays et ses ressources; comme tous visiteurs européens, il s'arrête longuement à présenter les Indiens. Ceux-ci traversent une période sombre. Lambert le dit sans ménagement.
« Show, don't tell » est sa règle. C'est un visuel. Ses exceptionnelles gravures en témoignent bien sûr, mais aussi son récit. Il en met plein la vue. Le tout méritait un soin particulier. Avec cette édition, Voyage au Canada de John Lambert amorce une nouvelle carrière.
Acheter chez Renaud Bray
En janvier 2017, abonnez-vous au bulletin d’information Histoire à suivre et courez la chance de gagner ce livre!
Abonnez-vous à Histoire à suivre!
Seigneur, faites que je voie : La révolution tranquille d’un homme
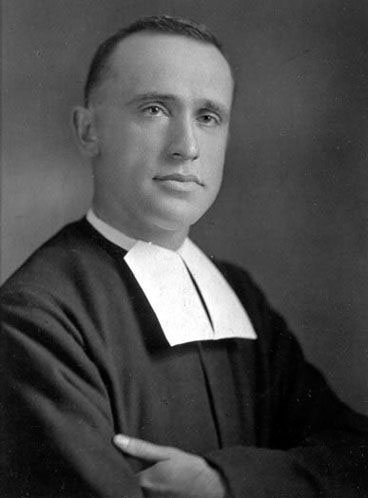
Frère Marie Victorin
Par Robery K. Henderson
En tant qu’auteur spécialisé en histoire naturelle fraîchement arrivé au Québec, ma première idée fut de me procurer un ouvrage sur la botanique locale. « Marie Victorin », m’indique le commis de la librairie. Le nom ne me disait rien, mais la taille et le prix du volume qu’il me mit entre les mains me laissa pantois. Cependant, c’est en ouvrant le livre, bien installé à la table de la cuisine, que vint la vraie surprise. En plus des dessins à la main et des descriptions techniques, cet ouvrage complet sur la botanique proposait également des données sur l’ethnobotanique et les propriétés chimiques des plantes, des anecdotes historiques et des références littéraires. Et pour souligner l’humanisme de l’auteur, ce dernier se permettait quelques touches d’humour, ici et là, une véritable hérésie dans l’univers scientifique.
Je tournais les pages, émerveillé par l’ampleur de la science de cet auteur. « Qui est cet homme? » murmurai-je.
Joseph Louis Conrad Kirouac, le seul fils d’un commerçant prospère, est né dans les Cantons de l’Est du Québec en 1885. Garçon maladif et entouré de soins, élevé au cœur d’une petite bourgeoisie tranquille, Conrad ne laissait rien présager de la marque qu’il allait laisser dans l’histoire intellectuelle de son peuple. Même à l’adolescence, période pourtant tumultueuse, le jeune Conrad suivra sans rechigner les traces de son père en s’inscrivant à l’Académie commerciale de Québec.
Son passage à l’Académie nous donne une idée de l’homme qu’il allait devenir, car c’est là que se dessinent les deux thèmes qui domineront la vie adulte de Conrad. Le premier, une curiosité insatiable, tout de même tempérée par la discipline de l’établissement. L’autre, au grand désespoir de son père, l’appel de la vocation. Il n’y aurait pas d’héritiers pour reprendre l’affaire familiale, pas de petit-fils pour porter le fier nom de Kirouac, légué par un chevalier Breton. Le jeune homme choisit plutôt les ordres et une vie dépourvue de richesses et d’héritiers, une vie qui mettrait fin à la lignée.
Les historiens contemporains donnent une interprétation pratique de cette décision. Le jeune intellectuel voulait enseigner, une profession monopolisée par l’Église du Québec, et c’est donc pour cette raison qu’il entre aux Frères des Écoles chrétiennes, le même ordre qui dirige l’Académie. Mais dans les faits, son appel était sincère et profond. Pour Marie Victorin, le nom qu’il prit lorsqu’il fut ordonné, chercher la vérité, ouvrir les esprits et remettre en question les idées reçues sont les principales responsabilités d’un chrétien. Son « cri de guerre », si souvent repris que ses élèves aiment bien s’en moquer, est tiré de l’Évangile selon Luc : Seigneur, faites que je voie!
Ce jeune homme prometteur de dix huit ans obtient rapidement un poste d’enseignant à Saint-Jérôme, au nord de Montréal, mais subit un dur revers quelques mois plus tard lorsqu’il apprend qu’il est atteint de tuberculose. Les Écoles chrétiennes le confinent immédiatement au bucolique monastère de Saint Jérôme pour prendre du repos. Mais ce qui, au départ, semblait un malheur se révèle un tournant dans la vie de Marie Victorin, car c’est là, au cœur de la forêt, qu’il se tourne vers la science. Armé de la Flore canadienne, qui était l’ouvrage de botanique de référence au Québec à cette époque, il entreprend de passer les heures en identifiant toutes les plantes de la forêt entourant le monastère.
L’énormité de la tâche le renverse. Il y a tant d’espèces, chacune conçue pour prendre sa place dans un environnement spécifique! Marie Victorin combattit rapidement la tuberculose, mais la fièvre de la botanique continua de bouillir dans ses veines jusqu’à la fin de sa vie. Lorsqu’il obtint son congé, on l’envoya enseigner à Longueuil, où il fera équipe avec frère Rolland Germain, un botaniste d’expérience, et passera tous ses temps libres à explorer la vallée du Haut Saint Laurent.
Les ambitions scientifiques de Marie Victorin sont rapidement freinées par ses connaissances insuffisantes, acquises de façon autodidacte. Il entreprend donc, en 1909, des études par correspondance avec le botaniste de Harvard, Merritt Lyndon Fernald. Ses articles commencent à paraître dans des revues professionnelles partout dans le monde et, en 1914, il entame la tâche dantesque de rédiger un ouvrage exhaustif sur la botanique du Québec. Mais son dévouement à l’égard de l’enseignement ne s’effrite pas pour autant, et ses articles qui paraissent régulièrement dans les journaux sur la science, l’éducation et la politique deviennent des lectures fort populaires auprès des travailleurs de la province. En 1920, Marie-Victorin, alors devenu un scientifique de plein droit, fonde l’Institut botanique de l’Université de Montréal, et trois ans plus tard, il contribue à la création de la Société canadienne d'histoire naturelle.
La même année, en 1923, le botaniste de McGill, Francis Lloyd, nomme Marie-Victorin à la section biologie de la Société royale du Canada. Le conseil, formé uniquement d’anglophones, refuse, mais finit par abdiquer l’année suivante, cédant aux nombreuses pétitions, en le confinant cependant à la section histoire et littérature, jugée plus appropriée pour un Québécois. Ce n’est qu’en 1927 que la Société royale finit par accepter l’inévitable et accorde la nomination scientifique que Marie-Victorin mérite pleinement.
Mais les activités de Marie-Victorin ne sont pas toujours vues d’un bon œil par ses employeurs. Les moines doivent faire vœu d’obéissance et d’altruisme, et même si les Écoles chrétiennes jouissent d’une assez bonne réputation à l’échelle mondiale, la direction est de plus en plus mal à l’aise avec la célébrité croissante de Marie-Victorin. Il fait maintenant partie de la culture populaire, son nom est synonyme d’intelligence et d’érudition parmi les Canadiens-Français. Lorsque l’on veut parler d’une personne lente d’esprit, on dit que « ce n’est pas un Marie-Victorin ». En outre, cet homme de foi ambitieux défend publiquement des thèses qui vont à l’encontre de l’establishment, comme l’égalité des sexes, la réforme scolaire et le nationalisme québécois.
La correspondance personnelle de Marie-Victorin laisse peu de doute sur la force de ses convictions : « S’il y avait des femmes cardinaux, écrit-il à sa sœur, religieuse et directrice d’école, nous assisterions à de véritables changements au sein de l’Église catholique ». À une nièce, entreprenant un voyage en Europe, il écrit : « Ne soit pas choquée par la nudité que tu verras partout… notre éducation dans ces affaires est rudimentaire. » Son conseil à un neveu à la veille de son ordination est étonnamment à propos : « L’époque où le prêtre canadien-français était le roi de sa paroisse rurale, ignorant tout du grand monde, est bien révolue. Les prêtres de ta génération vivront de leur savoir. »
Aujourd’hui, ces déclarations résonnent comme des prophéties, et annoncent la Révolution tranquille qui commencera près de trente ans plus tard. Sa vision demeure actuelle même de nos jours. Il dénonce le pillage du Québec par des entreprises américaines, affirmant qu’elles empoisonnent l’environnement et menacent la culture québécoise. Il prédit le déclin de l’Église catholique au Québec, à une époque où elle dictait chaque pensée et chaque action. Il pointe du doigt les écoles, dirigées par des professeurs paresseux et politiquement émasculés, jugeant qu’elles constituent une menace pour les libertés civiles et l’indépendance économique. Et il encourage les femmes à poursuivre une carrière scientifique; Marcelle Gauvreau, une des grandes pionnières de l’éducation scientifique au Québec, est une protégée et une collègue de Marie-Victorin.
Et tout cela se passe au plus profond de la Grande Noirceur, soit la première moitié du vingtième siècle, où l’obéissance aveugle aux autorités, religieuses et laïques, était jugée essentielle à la survie culturelle du Québec. L’autonomie intellectuelle menaçait cette ligne de pensée et était dénoncée avec vigueur. Dans son ouvrage de 1992, French Canadians, Michel Gratton reprend un programme de mathématiques précédant la Révolution tranquille où l’on demande à l’élève de calculer combien de médailles religieuses on peut acheter avec une somme d’argent donnée. Le chapitre sur les écoles de l’époque s’intitule « The Enemy Within » (le péril intérieur). Vers la fin des années 1960, les journaux du Québec s’enflamment pour les critiques acerbes du Frère Untel (on découvrira plus tard qu’il s’agit du pseudonyme de l’auteur et journaliste Jean-Paul Desbiens), qui dénonce le système scolaire bancal du Québec, la répression de toute forme d’intellectualisme et le gaspillage de talents.
C’est dans ce monde que vivait Marie-Victorin, et son attitude de défiance n’amusait pas ses supérieurs. Le scientifique de renom était souvent soumis à des périodes de réflexion forcées, où il lui était interdit de publier des textes ou de communiquer avec les médias. Il fait également de longues retraites qui, apparemment, ne lui sont pas imposées. Le paradoxe illustre bien les contradictions de ce Québec catholique : ses pairs religieux, comme sa sœur et ses collègues enseignants, louangent son travail, mais ceux qui occupent les rangs supérieurs le jugent menaçant. Et il ne fait pas bon pour un pauvre moine, aussi célèbre soit-il, de remettre cette autorité en question.
Les autorités laïques n’étaient pas beaucoup mieux disposées à son égard. Par exemple, la campagne de Marie-Victorin en vue de créer un jardin botanique de réputation mondiale à Montréal fut étouffée par des luttes intestines et autres combines politiques. Cependant, fort de sa réputation, Marie-Victorin réussit après une bataille de dix ans à imposer son Jardin botanique aux bureaucrates sans vision et aux comptables trop économes. Malgré le sentiment antiallemand qui sévissait vers la fin des années 1930, Marie-Victorin défendit avec ardeur l’architecte d’origine allemande du Jardin, Henry Teuscher, contre de fausses accusations d’espionnage. Même après l’ouverture officielle du Jardin en 1938, son existence demeurait incertaine. Avec la guerre à l’horizon, le nouveau premier ministre provincial ouvertement contre Marie-Victorin loua l’ensemble de la propriété aux forces aériennes pour la somme d’un dollar. L’affront était typique, mais la réponse de Marie-Victorin et de ses partisans fut à la hauteur, puisqu’ils réussirent à faire annuler la transaction. Enfin, ils firent transférer la propriété du Jardin à la ville, sauvant cet attrait montréalais des démolisseurs qui voulaient en faire un terrain de parade.
Les apparitions publiques de Marie-Victorin sont si colorées qu’il serait tentant de reléguer au second plan ses triomphes professionnels. Et pourtant, même s’il était resté inconnu du public, ses réalisations lui auraient mérité, à elles seules, une place au panthéon du Canada. Parmi ses réalisations, notons la Flore laurentienne, son ouvrage de botanique complet sur les plantes du Québec subarctique, sans doute le plus célèbre. Le laboratoire de Marie-Victorin travailla à ce chef-d’œuvre, un des plus remarquables exemples du genre au monde, pendant vingt ans. Le résultat final, publié pour la première fois en 1935, est stupéfiant tant sur le plan des détails que de la portée.
[TRADUCTION] « Dans la campagne canadienne, peut-on lire sous la description de l’arisaema atrorubens (arisème petit-prêcheur), les [rhizomes] sont employés contre certains troubles de l’estomac et un sang appauvri. Les Iroquois lui donnent le nom de Kah-a-hoo-sa, qui signifie « berceau indien »; on observe en effet une ressemblance entre la spathe qui enveloppe les spadices et le nâgane que les femmes indiennes emploient pour transporter les bébés.
L’acorus calamus (acore odorant) a été introduit en Europe occidentale et centrale vers 1574, lorsqu’il fut envoyé à Matthiole de Prague en provenance de Constantinople. ... Au Moyen-Âge, on parsemait les planchers des cathédrales avec les rhizomes odorants de cette plante. On s’en sert encore aujourd’hui pour parfumer la bière, le vin et le tabac… En Inde, le sucre d’acore odorant est un remède universel contre les coliques des nouveau-nés… les Chinois placent l’acorus (Pai-chang) à la tête du lit pour éloigner les poux. »
Plus qu’un guide de terrain, la Flore laurentienne est un monument, tant pour l’homme que pour cette science qu’il a tant aimée. Même le lecteur distrait ne peut que constater à quel point l’auteur se passionne pour son sujet, qu’il maîtrise à la perfection.
Le Jardin botanique et la Flore laurentienne auraient été à eux seuls un rappel impressionnant de la vie et de l’œuvre de Marie-Victorin, mais il ne s’agit que de ses réalisations les plus connues. Malgré une santé vacillante, il continua à enseigner, à participer à des conférences internationales, à diriger la faculté des sciences de l’université de Montréal et le Jardin botanique et à faire campagne pour une réforme de l’éducation. Ses articles continuèrent à paraître sans interruption et il devint plus tard modérateur dans le cadre d’une émission scientifique populaire de la CBC. Malgré cet horaire chargé, il participa également à plusieurs expéditions épiques en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Antilles. Cuba, dont la douceur du climat était bénéfique à sa condition d’ancien tuberculeux, devint sa seconde demeure. Faisant fi des ordres de ses supérieurs, qui lui conseillaient le repos, le chercheur partit à la découverte botanique de l’île. Peu avant sa mort, il reçut l’Ordre du mérite national de Cuba pour son travail sur la botanique cubaine. Pour illustrer le respect qu’on lui vouait, mentionnons que le moine canadien partagea cet honneur avec l’archevêque de la Havane.
La fin de Marie-Victorin n’est malheureusement pas à la hauteur de l’homme. Le 15 juillet 1944, il partit avec quelques amis pour le lac Noir, à environ soixante kilomètres au sud de Québec, à la recherche de fougères rares. Sur le chemin du retour, leur voiture fut frappée de plein fouet par un autre véhicule. Les ceintures de sécurité n’existaient pas encore et Marie-Victorin, assis à côté du conducteur, fut éjecté contre le pare-brise avec suffisamment de force pour briser la vitre. Les blessures à la tête et le pied cassé étaient douloureux, mais ne menaçaient pas sa vie. Cependant, étendu sur le bord de la route, le moine demande un prêtre. « Je ne crois que pas que mon cœur va survivre à cet accident », dit-il du bout de ses lèvres enflées.
La prédiction du grand scientifique s’avéra. À cinquante-neuf ans, après avoir reçu les derniers sacrements d’un prêtre local, Marie-Victorin s’éteignit à l’arrière d’un taxi, en route vers l’hôpital.
Aujourd’hui, le souvenir de ce grand chercheur s’est quelque peu effacé de la mémoire populaire au Québec, où la plupart de ses habitants trouveraient difficile d’expliquer l’origine des rues, parcs et écoles Marie-Victorin qui parsèment la province. Les Canadiens de l’extérieur du Québec n’ont pas eu la chance de le connaître. Cependant, pour les scientifiques et les historiens, il reste un des grands Canadiens, savant modeste, qui a contribué au prestige international de cette jeune nation et a profondément changé le paysage intellectuel de sa société. Les facultés de science de renommée mondiale du Québec valent leur existence à Marie-Victorin, tout comme les nombreux scientifiques vulgarisateurs du Canada. Produit d’une époque révolue et d’une société bien différente, sa carrière remarquable a néanmoins établi les fondements des valeurs qui nous tiennent tant à cœur aujourd’hui.
Robert K. Henderson est un auteur et photographe pigiste qui habite à Chatham, au Québec. Il a écrit The Neighborhood Forager: A Guide for the Wild Food Gourmet, publié en 2000 par Chelsea Green, et travaille actuellement à un ouvrage sur l’agriculture des Premières Nations.
De l'ours au renard

Dans l’édition février/mars 2017du magazine Canada’s History, les historiens Mike Commito et Ben Bradley proposent un article intitulé Beyond Winnie. Ils se sont intéressés à la présence des ours comme animaux domestiques, mascottes ou attractions populaire dans la vie des Canadiens à une certaine époque.
Le journaliste Jean-François Nadeau, lors d’une entrevue accordée à l’émission Le 15-18, diffusée sur ICI Radio-Canada Première, s’est lui aussi intéressé au phénomène de l’ours comme ami de l’homme et plus spécifiquement comme ami des Montréalais. Nous vous invitons à écouter l’entrevue réalisée dans le cadre de cette émission.
Pour écouter l'entrevue de Jean-François Nadeau:
De l'ours au renard, l'histoire des animaux à Montréal
Le 15-18, ICI Radio-Canada Première, 8 juin 2016.
Montreurs d'ours
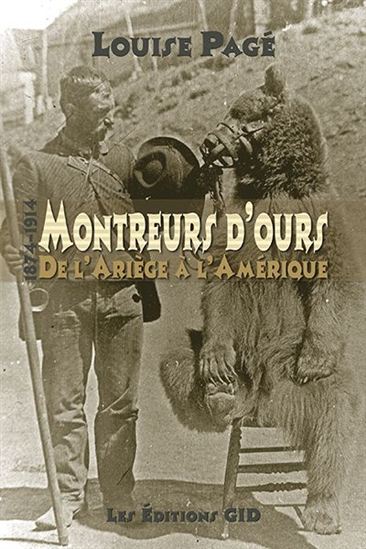
Louise Pagé. Montreurs d'ours : de l'Ariège à l'Amérique, 1874-1914. Québec, Éditions GID, 250 pages.
Québécoise originaire de Montréal, Louise PAGÉ a pour ancêtre Jean BROUÉ Cabillot qui quitta son hameau pyrénéen d’Arrous pour le Canada en 1885. Elle nous fait part des résultats d’une enquête qu’elle a effectuée pour retrouver les traces des Ariégeois du canton d’Oust qui ont émigré au Canada avant la Première Guerre mondiale, certains, comme Jean BROUÉ, de façon définitive.
En prenant appui sur l’ancêtre BROUÉ, nous ferons donc connaissance avec plus de quatre-vingt-dix expatriés exerçant le métier de montreur d’ours qui sont passés par le Québec d’antan. Ils sont présentés à partir des documents attestant de leur entrée au pays, et leurs pérégrinations sont racontées sous la forme de brèves biographies pimentées de notes et d’anecdotes qui s’appuient sur l’importante documentation personnelle de l’auteure les concernant — manifestes de navire, carnets de saltimbanques, articles de journaux, recensements, actes notariés, registres paroissiaux et militaires — amassée au fil des sept années de recherche que ce travail colossal a exigées. Certains extraits de ces pièces accompagnent d’ailleurs les descriptions lorsque l’intérêt de la chose le commande.
Ce qui surprend dans l’histoire des montreurs d’ours, c’est qu’elle est relativement courte et circonscrite. Les premiers spectacles de cette industrie apparaissent vers 1874 et prennent fin avec la Première Guerre mondiale, en 1914. Plus surprenant encore, ces saltimbanques provenaient de trois villages des Pyrénées françaises.
Acheter le livre aux Éditions GID
Écouter une entrevue que Louise Pagé a accordée à Joanne Despins dans le cadre de l'émission Dessine-moi un dimanche diffusée sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première.
Profession : Montreur d'ours
Dessine-moi un dimanche, ICI Radio-Canada Première, 20 juillet 2014, 8 minutes et 55 secondes.
Lunettes de neige

Photo par Andrew Workman
Les lunettes de neige ont été conçues pour atténuer les rayons de soleil qui se reflètent sur la neige et éviter l’aveuglement. L’ophtalmie des neiges est en fait un coup de soleil de l’œil et peut affecter la vision pendant quelques jours si aucune précaution n’est prise. De nombreux groupes inuits se sont confectionnés des lunettes de neige en os, en ivoire ou, comme on peut le voir ici, en bois. Imaginez-vous traverser la tundra enneigée par une journée ensoleillée sans verres fumés et vous comprendrez pourquoi cette invention a vu le jour. Les petites fentes limitent le champ de vision et la quantité de rayons ultraviolets qui atteignent l’œil. On en sait très peu sur ces lunettes du début du vingtième siècle, mais selon les dossiers, elles proviendraient des Inuits du Caribou, au Nunavut.
Conservateur de la collection de la HBC au Musée du Manitoba
Coussin de selle brodé
Les coussins de selle servaient pour le transport à cheval et étaient des articles très prisés dans les plaines du Nord, surtout à la grande époque de la chasse au bison. Ces coussins étaient confectionnés par des femmes et on disait des Métisses qu’elles étaient particulièrement douées pour fabriquer de superbes coussins de selle, qu’elles vendaient ou échangeaient avec d’autres groupes autochtones et les commerçants de fourrure.
Les coussins de selle étaient faits de peau d’orignal tannée que l’on remplissait d’herbes ou de poils de cheval et qu’on décorait ensuite de perles ou de broderies. Ils prenaient des formes et des tailles diverses. Cet exemple du début du vingtième siècle représente une version plus moderne. Le dessus est en toile, mais la base est en peau tannée et on peut y voir un travail de perlage élaboré et des pampilles de laine.
Le coussin a été donné à la collection de la HBC du Musée par le propriétaire d’une boutique de taxidermie de Winnipeg en affaires de 1880 à 1910.
Terre de géants

Dans l’édition février-mars du magazine Canada’s History, Garrett Wilson propose un article intitulé Reffugee Crisis qui raconte la venue au Canada de milliers de Sioux fuyant les États-Unis à la fin du XIXe siècle. Pour en savoir plus au sujet de cette histoire, nous vous proposons de visionner une émission de la série documentaire Histoires oubliées et, parcourir le dossier documentaire créer pour l’accompagner.
Synopsis de l’épisode
Terre de géants
Lors de la conquête de l’Ouest, l’homme blanc, déterminé à chasser les Autochtones des terres qu’il désirait s’approprier, ne s’est pas gêné pour répandre le sang sur les plaines. Vers la fin du XIXe siècle, alors que les Sioux et les Américains s’affrontent dans une lutte sans merci, le Canada devient une terre d’asile, un refuge pour Sitting Bull et les membres de sa tribu. Ils seront surpris par la générosité de certains habitants francophones. Aujourd’hui, peu de Canadiens français peuplent les plaines de la Saskatchewan, mais ceux qui restent gardent le souvenir de ces temps difficiles.
En savoir plus au sujet de l'épisode Terre de géants de la série documentaire Histoire oubliées
Little Big Horn
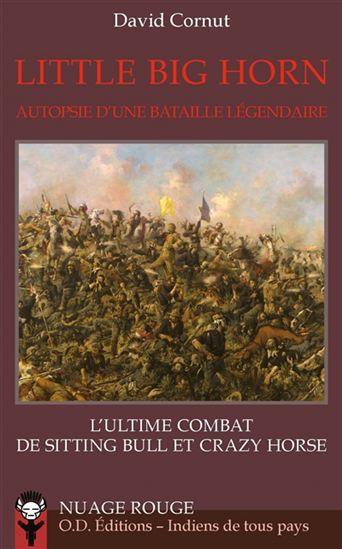
David Cornut. Little Big Horn : autopsie d'une bataille légendaire : l'ultime combat de Sitting Bull et Crazy Horse. OD - Éditions — Indiens de tous pays, 2016. 360 pages.
Résumé:
S’il est un affrontement des guerres indiennes d’Amérique du Nord dont le nom vient immédiatement à l’esprit, c’est bien celui de la bataille de la Little Big Horn : le 25 juin 1876, dans le Montana, une coalition de Sioux, de Cheyennes et d’Arapahoes, commandée par les chefs Sitting Bull et Crazy Horse, anéantit le 7e régiment de cavalerie du général Custer. Cette défaite d’un régiment perçu comme invincible a été vécue par tout le pays comme un traumatisme national. Pour les Indiens, Little Big Horn reste la victoire la plus emblématique de leur histoire. Sitting Bull, Custer et Crazy Horse ont atteint le statut d’icônes. Pourtant, derrière la légende, les questions demeurent pour les historiens : la défaite était-elle due aux erreurs et aux ambitions de George Armstrong Custer ? Comment les Indiens ont-ils vécu la bataille ? Comment expliquer ces témoins que l’on a voulu faire taire, ces incohérences ou ces cartes truquées ? L’auteur, orfèvre dans cette « autopsie », nous propose une véritable immersion dans une période brutale, brossant au passage le profil détaillé des protagonistes. Outre Custer, Crazy Horse et Sitting Bull, il a su convoquer d’autres acteurs moins connus de la bataille, Indiens comme soldats américains, ainsi que les éclaireurs crows et arikaras servant l’armée. Ainsi, la bataille elle-même reprend vie à hauteur d’homme, à travers la voix de dizaines de témoins oculaires et d’experts. Sept ans de recherches, d’entretiens avec des spécialistes et de voyages sur le terrain ont été nécessaires pour réaliser cette enquête, considérée dès sa première édition comme la référence sur le sujet.
Acheter le livre chez Renaud Bray
La Rébellion du Nord-Ouest
Pour l’édition février/mars du magazine Canada’s History, l’auteur et historien de l’art Jon Dellandrea signe un article intitulé Unsettling Scenes. Dellandrea pose un regard sur des archives et illustrations du peintre Francis Fitz Roy Dixon récemment découvertes. Les représentations iconographiques de l’artiste apportent un éclairage nouveau afin de mieux interpréter le massacre de Frog Lake et la rébellion du Nord-Ouest.
Pour en savoir plus au sujet de ces événements et pour remettre en contexte le travail de Dellandrea, nous vous proposons de parcourir des ressources préparées par Parcs Canada, Bibliothèque et Archives Canada et La Passerelle pour l'histoire militaire canadienne.

La Passerelle pour l'histoire militaire canadienne
www.cmhg-phmc.gc.ca
La toile de fond de la rébellion du Nord-Ouest
La Passerelle a pour but de « fournir au public un accès gratuit aux ressources collectives sur l'histoire militaire provenant des musées, bibliothèques, archives et autres organismes de mise en valeur du patrimoine canadien, et ce, sur une même passerelle dynamique et à interface intuitive ». En rassemblant toutes les sources d'information sur le patrimoine militaire canadien, la Passerelle offre la possibilité à tous les Canadiens d'apprendre sur cette histoire qui a façonné leur pays.

Bibliothèque et Archives Canada
www.bac-lac.gc.ca
Guide thématique - Louis Riel, la rébellion de la rivière Rouge et la campagne du Nord-Ouest
Le présent guide se compose de références archivistiques précises et d'autres sources d'information se rapportant à Louis Riel et aux rébellions des Métis de 1869–1870 et 1885.
.aspx)
Parcs Canada
www.pc.gc.ca
Lieu historique national du Canada de Batoche
La rébellion du Nord-Ouest et la résistance des Métis
Remontez au XIXe siècle et laissez un Métis vous raconter à quoi ressemblait la vie au bord de la rivière Saskatchewan-Sud à cette époque. Imaginez les bouleversements survenus au moment du combat. Observez les trous laissés par les balles de fusil sur le champ de la dernière bataille, théâtre de la rébellion du Nord-Ouest en 1885. Apprenez-en plus sur la façon dont le peuple métis a vu son mode de vie traditionnel changer à tout jamais, à l’aube de la fondation d’un nouveau pays.
Moments clés : Le Musée canadien des civilisations

Musée canadien des civilisations à nuit.
Déroulez vers le bas pour consulter l’échelle chronologique. Cliquez sur les flèches pour passer d’une diapositive à l’autre. Cliquez sur l’image pour l’agrandir. Toutes les images sont protégées par les droits d’auteur et appartiennent au Musée canadien des civilisations. Voir Moments clés : Le Musée canadien de la guerre.
Le Musée canadien de l'histoire (le Musée canadien des civilisations), qui existe depuis plus de 150 ans, est plus ancien que la Confédération. À l’image de notre nation, le musée a connu de bonnes années et de moins bonnes.
Il a changé de nom à maintes reprises, reflétant ainsi l’évolution de son mandat. Sa collection, qui compte plus de 3 millions d’artéfacts, est une des plus importantes et raconte l’histoire de notre société.
Depuis son ouverture, le musée ne cesse d’élargir ses champs d’intérêt. À l’origine, on y mettait l’accent sur les sociétés autochtones, pour ensuite s’intéresser à la vie, aux communautés et aux cultures des peuples du Canada.
Au cours des dernières années, le Musée est devenu un lieu de découverte des civilisations du monde et raconte leurs cultures, leurs histoires et leurs liens avec le Canada.
— Texte par Victor Rabinovitch a été président et directeur général du Musée canadien des civilisations et du Musée de la guerre pendant 11 ans. Il enseigne actuellement à l’Université Queens, dans le domaine des politiques publiques.
Moments clés : Le Musée canadien de la guerre

Le Musée canadien de la guerre / Photo: User: Balcer.
Déroulez vers le bas pour consulter l’échelle chronologique. Cliquez sur l’image pour l’agrandir. À moins d’avis contraire, toutes les images sont protégées par les droits d’auteur et appartiennent au Musée canadien des civilisations. Voir Moments clés : Le Musée canadien de l'histoire.
L’histoire du Musée canadien de la guerre est à l’image de la relation intermittente qu’entretient le pays avec l’action militaire. Le musée, qui était ignoré et a même fermé ses portes à une certaine époque, a fait l’objet de deux agrandissements majeurs plus récemment. Ces deux projets ont été entrepris lors du règne des gouvernements libéraux, contredisant ainsi l’image antimilitariste de ce parti.
Même si une exposition d’objets militaires a été inaugurée dans les années 1880, les premières expositions de qualité muséale n’ont vu le jour qu’en 1967, dans le cadre du centenaire du Canada.
Il demeure une tension constante quant au mandat du musée, qui prête parfois le flanc à la controverse. Vise-t-il à rendre honneur aux anciens combattants qui ont servi le Canada (un rôle de commémoration) ou plutôt à présenter des expositions sur des thèmes militaires de l’histoire du Canada (un rôle d’éducation)?
Depuis l’ouverture du nouveau bâtiment du Musée canadien de la guerre en 2005, le musée s’acquitte de ce double mandat. Il présente des projets historiques solidement étayés et des programmes éducatifs soutenus par un style dynamique. Il est fort populaire auprès des visiteurs, mais demeure de nature sobre.
— Texte par Victor Rabinovitch, a été président et directeur général du Musée canadien des civilisations et du Musée de la guerre pendant 11 ans. Il enseigne actuellement à l’Université Queens, dans le domaine des politiques publiques


 Une exposition d’objets et de trophées militaires est inaugurée dans l’édifice central du manège militaire à Ottawa.
Une exposition d’objets et de trophées militaires est inaugurée dans l’édifice central du manège militaire à Ottawa.
 L’exposition prend fin et le manège militaire est employé à des fins purement militaires.
L’exposition prend fin et le manège militaire est employé à des fins purement militaires.
 Les dossiers et objets militaires sont conservés aux archives fédérales, sans accès au public. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le travail de collecte est intermittent.
Les dossiers et objets militaires sont conservés aux archives fédérales, sans accès au public. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le travail de collecte est intermittent.

 Premiers balbutiements d’un programme d’art militaire canadien. Des artistes sont invités à créer un récit visuel de l’action militaire du Canada en Europe. Le programme reprend au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Premiers balbutiements d’un programme d’art militaire canadien. Des artistes sont invités à créer un récit visuel de l’action militaire du Canada en Europe. Le programme reprend au cours de la Seconde Guerre mondiale.
 La première exposition thématique d’objets militaires est inaugurée dans un local d’entreposage temporaire à Ottawa, près des Archives nationales. On l’appellera plus tard le Musée canadien de la guerre.
La première exposition thématique d’objets militaires est inaugurée dans un local d’entreposage temporaire à Ottawa, près des Archives nationales. On l’appellera plus tard le Musée canadien de la guerre.

 Le premier musée consacré à l’histoire militaire ouvre ses portes dans le cadre du Centenaire du Canada, dans l’ancien édifice des Archives nationales. Le MCG devient une filiale du Musée national de l’homme (l’ancien nom du Musée des civilisations).
Le premier musée consacré à l’histoire militaire ouvre ses portes dans le cadre du Centenaire du Canada, dans l’ancien édifice des Archives nationales. Le MCG devient une filiale du Musée national de l’homme (l’ancien nom du Musée des civilisations).
 Un groupe de travail sur les collections des musées d’histoire militaire au Canada exhorte le gouvernement à créer un musée à vocation militaire et doté d’un financement, d’effectifs et de locaux adéquats.
Un groupe de travail sur les collections des musées d’histoire militaire au Canada exhorte le gouvernement à créer un musée à vocation militaire et doté d’un financement, d’effectifs et de locaux adéquats.

 Après plusieurs années de planification et de débats publics, le gouvernement fédéral annonce qu’il construira un nouveau musée de la guerre sur un emplacement bien en vue, au centre d’Ottawa.
Après plusieurs années de planification et de débats publics, le gouvernement fédéral annonce qu’il construira un nouveau musée de la guerre sur un emplacement bien en vue, au centre d’Ottawa.

 Le nouveau Musée canadien de la guerre ouvre ses portes, à proximité du Parlement. Il combine une architecture étonnante à un emplacement de choix et propose des expositions exhaustives sur des sujets de l’histoire militaire nationale et internationale. Tout comme le Musée des civilisations, qui a ouvert en 1989, le Musée canadien de la guerre est très populaire après du public, et attire près de 500 000 visiteurs par année.
Le nouveau Musée canadien de la guerre ouvre ses portes, à proximité du Parlement. Il combine une architecture étonnante à un emplacement de choix et propose des expositions exhaustives sur des sujets de l’histoire militaire nationale et internationale. Tout comme le Musée des civilisations, qui a ouvert en 1989, le Musée canadien de la guerre est très populaire après du public, et attire près de 500 000 visiteurs par année.
Banff la magnifique

Gracieuseté des Archives du chemin de fer du Canadien Pacifique A20693.
Banff est l’un des plus anciens parcs nationaux dans le monde et son histoire est riche. Dans les années 1990, écologistes et développeurs s’affrontaient sur des enjeux qui menaçaient l’avenir du parc. En effet, si des mesures n’étaient pas été prises afin d’assurer la préservation du site, Banff risquait de perdre son statut de parc national.
Retour sur l’histoire de Banff avec Nathalie Delbecq, guide-interprète au parc national Banff. Cliquez sur l’icône ci-dessous pour écouter l’intégralité de l’entrevue que madame Delbecq a accordée à Histoire Canada (7 minutes, 7 secondes).
Cet article fut d’abord rédigé en anglais par Ken McGoogan et fut publié dans le numéro d’octobre/novembre 2010 du magazine Canada’s History.
Banff est le joyau de la couronne du réseau des parcs canadiens. Trop beau pour qu’il ne fasse pas l’objet de toutes les convoitises, il a été au coeur de nombreux conflits tout au long de ses 125 années d’existence.
Vers le milieu des années 1970, bien avant que la révolution numérique n’efface les frontières, j’ai enseigné le français pendant quelques mois à Dar es-Salaam, en Tanzanie. Deux fois par semaine, avec ma femme Sheena, je parcourais plusieurs kilomètres, dans une chaleur étouffante, pour me rendre au consulat canadien afin d’y lire les nouvelles du pays. Les murs du consulat étaient décorés d’affiches, et notamment de trois belles images représentant les Rocheuses : le mont Rundle, le lac Louise et le lac Emerald.
C’est sans doute ridicule, je l’avoue, mais ces images du parc national Banff m’ont tiré quelques larmes. C’est ici, sous le soleil de plomb africain, loin des sommets enneigés des Rocheuses, que j’ai compris que rien ne symbolise le Canada comme Banff.

Le parc national Lake Louise à Banff,1923. / Musée McCord.
Le parc, qui célèbre cette année son 125e anniversaire, est presque aussi vieux que notre pays. Il a vu le jour l’année même où l’on a enfoncé le dernier crampon du chemin de fer Canadien Pacifique. En fait, le chemin de fer s’est révélé un moteur important du développement de ce parc. Banff est devenu un parc national, le premier au Canada et le troisième au monde, sous la gouverne du premier ministre qui nous a donné la Confédération. Il s’agissait d’ailleurs d’une réponse du gouvernement fédéral à une tentative d’appropriation du territoire. Une belle histoire à la canadienne, quoi!
L’histoire du parc a commencé en novembre 1883. Trois ouvriers du CP découvrent alors une caverne au pied du mont Sulphur où coule une source thermale naturelle. Les frères Tom et William McCardell et leur partenaire Frank McCabe ne furent pas les premiers non-autochtones à apprécier la beauté de cette merveille de la nature, puisque l’arpenteur James Hector en a fait mention en 1859. Et ils ne furent pas les premiers à en soupçonner le potentiel. Les Premières nations connaissaient l’existence de ces sources et les considéraient comme un lieu sacré, aux vertus thérapeutiques.
Cependant, les ouvriers du CP furent les premiers à en réclamer la propriété. Alléchés par le potentiel financier du site, ils dressèrent une clôture autour de la caverne et bâtirent une petite cabane à proximité pour établir leur droit de propriété. Mais ils n’étaient pas seuls à lorgner cet endroit. Un député et avocat de la Nouvelle Écosse, D. B. Woodworth, réussit à leur faire céder leurs droits par diverses manigances. Il acheta ensuite un hôtel, dans l’intention de l’installer sur le site et d’y bâtir un véritable attrape touriste du plus mauvais goût.

Une automobile sur une route de gravier le long de la rive du Lac Minnewanka à Banff, vers 1930. / Musée McCord.
La bataille juridique qui s’ensuivit attira l’attention du premier ministre John A. Macdonald, qui lui même n’était pas étranger à la manigance. En 1885, il mit fin à ce conflit en créant une réserve de seize kilomètres carrés autour des sources. La Banff Hot Springs Reserve, créée par décret le 25 novembre 1885, fut ainsi baptisée en l’honneur de Banffshire, le lieu de naissance, en Écosse, de deux directeurs du CP. En 1887, le parc s’agrandit pour atteindre 416 kilomètres carrés et fut renommé Rocky Mountains Park. Les visiteurs affluèrent de partout dans le monde. Il devint le parc national Banff en vertu de la Loi sur les parcs nationaux de 1930 et en 1984, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, avec les parcs nationaux de Jasper, Yoho et Kootenay.
Aujourd’hui, Banff fait plus de 40 000 kilomètres carrés. Il appartient à un réseau de 42 parcs nationaux exceptionnels : chaque province et chaque territoire en compte au moins un.
Pendant deux décennies, avant de m’installer dans une métropole de l’Ontario qui, sur le plan psychologique, est aussi différente des Rocheuses que peut l’être Dar es-Salaam, j’ai habité à quatre vingt dix minutes à l’est du parc national Banff. En tant que journaliste, j’étais bien placé pour savoir que ce parc populaire du Canada risquait d’être victime de sa trop grande popularité.

Une brochure du chemin de fer Canadien Pacifique vante en 1897 la beauté des paysages et le nouvel hôtel Banff Springs . / Archives du chemin de fer Canadien Pacifique A20297.
Dès le début, Banff connut un grand succès auprès des riches visiteurs européens, qui y venaient en train et séjournaient à l’hôtel Banff Springs, ouvert par le CP en 1888. Le parc demeure une destination de choix pour les touristes du monde entier, ainsi que pour les Canadiens, attirant quatre à cinq millions de visiteurs chaque année.
Cet accroissement du nombre de visiteurs s’accompagne nécessairement d’un développement effréné, qui exerce de plus en plus de pressions sur la faune. Par exemple, l’intensification du trafic routier a donné lieu à une hausse alarmante du nombre de collisions avec des animaux. Parcs Canada a installé des ponts et des passages souterrains pour animaux afin de permettre aux grizzlis, aux loups, aux orignaux, aux wapitis et à d’autres animaux de traverser les autoroutes. Ces mesures ont sans doute contribué à diminuer le nombre de morts d’animaux. Pourtant, en moyenne, 70 gros animaux continuent d’être frappés par des véhicules chaque année.
Le rythme du développement à Banff, avec sa myriade de centres commerciaux, de restaurants, d’hôtels et de condominiums, a fait retentir la sonnette d’alarme dans les années 1990. Et comme en 1885, le gouvernement fédéral est intervenu. Ottawa annula les plans de la ville de Banff visant d’ambitieux nouveaux développements.
« Les pressions du développement humain ne peuvent pas porter préjudice aux lieux sauvages que nous nous sommes engagés à protéger, affirmait la ministre du Patrimoine de l’époque, Sheila Copps, lorsqu’elle annonça en 1997 le nouveau plan de développement de Banff. Banff est un des plus beaux cadeaux qu’il nous a été donné de recevoir. Il ne faut pas le gâcher. »
Dans ce plan, le nombre de résidents permanents à Banff est limité à 10 000. Il y a actuellement 8 000 personnes qui résident en ville, et ils doivent tous justifier leur nécessité de résider à cet endroit. Par exemple, vous ne pouvez prendre votre retraite à Banff que si vous avez travaillé pour le parc pendant cinq ans. Les frontières de la ville sont fixées à cinq kilomètres carrés en vertu de la loi fédérale, et la ville a adopté une stratégie de gestion de la croissance très dynamique.

Une femme skiant sur la Rivière Piperstone, Banff, 1930. / Musée McCord.
Banff est donc sous contrôle. Mais qu’en est il de Canmore, qui se situe de l’autre côté de l’entrée du parc? À l’époque, Canmore était une petite ville minière, mais sa population a triplé au cours des deux dernières décennies. Avec ses 12 000 résidents permanents et 5 600 propriétaires de résidences secondaires, la ville continue de croître. Oui, elle s’est dotée d’une stratégie de développement économique responsable. Mais cela ne veut pas dire que l’on peut maintenant oublier la situation à Canmore et ignorer les effets de son développement sur le grizzly, par exemple, qui est une espèce menacée en Alberta. Il ne faut pas plus négliger le grizzly que le loup, qui est en situation précaire dans le parc national de la Mauricie, ou que le saumon rouge du parc national Kluane, en voie de disparition.
On s’est toujours interrogé sur la raison d’être des parcs. Visent ils à préserver la nature, sont ils destinés à nos loisirs, ou les deux? Est ce que le tourisme dans les parcs nationaux, comme Banff, est une industrie égoïste au service de riches étrangers et qui exerce des pressions sur la faune et les collectivités? Ou s’agit il d’une stratégie de développement qui rapporte de précieuses retombées pour la région?
Je ne suis pas un scientifique, ni un urbaniste. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Mais comme j’ai élevé deux enfants à proximité du parc national Banff, je sais de première source ce que nous devons protéger pour les générations à venir.
Un des avantages de Banff, qui est un microcosme du réseau des parcs nationaux, c’est que l’on peut y faire des randonnées d’une journée, même avec de jeunes enfants. On peut escalader Tunnel Mountain, visiter Johnston Canyon ou partir de Château Lake Louise et s’émerveiller devant les paysages le long de la route vers le Lake Agnes Tea House.

Une brochure de 1929 fait la promotion des excursions à cheval. Les chevaux étaient préférés des riches, malgré la popularité croissante des voitures. / Archives du chemin de fer Canadien Pacifique BR88.
En hiver, on peut y skier. Depuis que les premières pistes de ski alpin furent défrichées sur le mont Norquay, en 1926 (les centres de Sunshine et de lac Louise suivirent peu après), les skieurs s’y donnent rendez vous et pour certains, ce sont les meilleures pistes de ski en Amérique du Nord.
Chaque année, nous prenions un abonnement de saison. Rien ne vaut une course avec votre fils ou votre fille sur les pistes enneigées, au soleil, pour ensuite faire une petite halte dans une cabane de bois rustique afin d’y déguster un bol de soupe.
Et pourtant, mon moment le plus marquant dans les Rocheuses a eu lieu bien avant d’avoir mes enfants. De mai à septembre, en 1970, Sheena et moi demeurions sur une montagne dans le parc national Banff. J’avais décroché un emploi comme observateur de tour, un poste que je convoitais si ardemment que le gardien en chef n’a pas eu le coeur de me le refuser.
Sarbach Lookout était à mi chemin entre Banff et Jasper, près de Saskatchewan River Crossing. Pour atteindre la tour, il fallait quitter l’autoroute, traverser le Mistaya Canyon et marcher cinq kilomètres dans les bois pour grimper jusqu’à Sarbach, où l’on émergeait au dessus de la cime des arbres, à une hauteur de 2 225 mètres.
Le travail d’un observateur de tour consiste à rester assis dans sa tour et à surveiller l’apparition de fumée. En tant qu’écrivain en herbe, j’en profitais pour taper héroïquement mes textes sur ma Smith Corona. Les orages constituaient un moment fort de la saison, car je devais rester dans la tour, en principe bien ancrée, alors que les vents la faisaient tanguer de droite à gauche, et marquer les endroits où la foudre était tombée pour ensuite vérifier sur place qu’il n’y ait pas trace d’incendie.

La piscine de l'hôtel Banff Springs vers 1935. La piscine était alimentée en eau à partir de sources d'eau chaude du mont Sulphur. / Musée McCord.
Nous allions chercher notre eau dans un petit ruisseau de montagne, à quelques centaines de mètres de la tour. On pouvait y voir des aigles, des mouflons, quelques cerfs timides, avec leur queue blanche, et même des chèvres de montagne. Une fois, à la moitié de mon parcours, je suis tombé nez à nez avec un ours noir. Évidemment, j’ai tout abandonné sur place et pris les jambes à mon cou.
Nous tenions tout cela pour acquis. Le soir, lorsque le ciel était dégagé, nous nous couchions sur le dos pour regarder les étoiles en pensant que tout cela était immortel et que ce lieu ne serait jamais assiégé par l’homme. Mais nous ne savions pas non plus que dix ans plus tard, nous nous retrouverions de l’autre côté du monde, où trois affiches évoqueraient ces souvenirs d’un été passé au parc national Banff. Cet événement nous a rappelé que cette belle nature sauvage, que nous chérissons tous en tant que Canadiens, mérite d’être préservée.
D'autres ressources en ligne:
- Archives de la CBC: Banff National Park is rooted in its hot springs. — 6 juin 1985.
- Parcourez l'article qui suit sélectionné dans nos archives du magazine The Beaver: "Friendship blossoms between a Mountie and a bear from Banff in "Buddy, the Polar Bear," The Beaver, Mars 1934.
Tourisme et villégiature: Lorsque nos voisins du Sud découvrirent la Belle Province
Dans l’édition de décembre-janvier du magazine Canada’s History, Philip Goldring propose un article portant sur l’industrie du tourisme lors de la grande crise économique des années 1930. À cette époque, des efforts furent déployés par le gouvernement canadien afin d'attirer des visiteurs en provenance de États-Unis.
En complément à cet article, nous vous proposons une baladodiffusion réalisée avec monsieur Marcel Paquet, auteur et passionné d’histoire qui publia en deux tomes, aux Éditions GID, Villégiature et tourisme au Québec. En entrevue, il nous a raconte que nos voisins du Sud n’étaient pas indifférents aux charmes de la Belle Province.
Écoutez l’intégralité de l’entrevue accordée par Marcel Paquet à Histoire Canada (durée 11 minutes, 15 secondes).
Pour en savoir plus :
Éditions GID : www.leseditionsgid.com

Marcel Paquette, Villégiature et tourisme au Québec – 1800-1910, Tome 1, Québec, Éditions GID, 2005.

Marcel Paquette, Villégiature et tourisme au Québec – 1911-1960, Tome 2, Québec, Éditions GID, 2006.

Robert Prévost, Trois siècles de tourisme au Québec, Sillery, Éditions Septentrion, 2000, 365 pages.
Découvrez aussi quel regard les cinéastes Claude Jutra et Michel Brault portaient, quelques années plus tard, au début des années 1960, sur la venue de touristes en provenance des Etats-Unis. Regardez le documentaire Québec-U.S.A. ou l'invasion pacifique, produit en 1962 par l’Office national du film (durée 27 minutes 42 secondes).
Cliquez sur l'image pour lancer le diaporama
Votre évaluation
1 = poor, 5 = excellent
L'évaluation actuelle : 2 (1 Évaluations)